mercredi, 04 mars 2009
Et maintenant...
 Et maintenant, je fondais mes rêves dans le bleu délavé de l’horizon, l’amas désordonné des nuages et ce bateau qui filait au milieu de tous ces cataclysmes. La pluie au loin traçait un rideau épais, en grandes orgues joufflues gonflées de nuit. Une trépidation de lames. Le ciel, une lutte, un amas de lances, un combat fratricide. Une symphonie du nouveau monde. Même si c’est vers l’ancien que je me dirigeais. Terrifiante cette immensité sauvage, encore plus que la Sierra, ces vagues dans le désordre de la nuit, remous effrayants, terrifiante et rassurante à la fois avec le bruit continu du bateau, les odeurs de machines, ce bloc de métal monstrueux, fumant et rugissant, traçant son sillon imperturbable à travers les flots déchaînés. Plaisir redoublé par le sentiment de sécurité, sur ce bâtiment sourd aux hurlements de la tempête. Rêvant que mon âme soit pareille, un bloc insubmersible. Tout ce chemin parcouru en si peu de temps. Comme au Mexique, malgré ou à cause de l’absurdité du lieu, je me sentais à ma place, au cœur de cette rhapsodie bleu nuit de la pluie et du vent.
Et maintenant, je fondais mes rêves dans le bleu délavé de l’horizon, l’amas désordonné des nuages et ce bateau qui filait au milieu de tous ces cataclysmes. La pluie au loin traçait un rideau épais, en grandes orgues joufflues gonflées de nuit. Une trépidation de lames. Le ciel, une lutte, un amas de lances, un combat fratricide. Une symphonie du nouveau monde. Même si c’est vers l’ancien que je me dirigeais. Terrifiante cette immensité sauvage, encore plus que la Sierra, ces vagues dans le désordre de la nuit, remous effrayants, terrifiante et rassurante à la fois avec le bruit continu du bateau, les odeurs de machines, ce bloc de métal monstrueux, fumant et rugissant, traçant son sillon imperturbable à travers les flots déchaînés. Plaisir redoublé par le sentiment de sécurité, sur ce bâtiment sourd aux hurlements de la tempête. Rêvant que mon âme soit pareille, un bloc insubmersible. Tout ce chemin parcouru en si peu de temps. Comme au Mexique, malgré ou à cause de l’absurdité du lieu, je me sentais à ma place, au cœur de cette rhapsodie bleu nuit de la pluie et du vent.
Raymond Alcovère, extrait de "Le Bonheur est un drôle de serpent", roman en recherche d'éditeur
Et maintenant, une pause de quelques jours, à bientôt...
00:15 Publié dans Le Bonheur est un drôle de serpent | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, roman, raymond alcovère, le bonheur est un drôle de serpent
jeudi, 26 février 2009
La nuit est tombée doucement...
 La nuit est tombée doucement, le temps ralenti, calme la ville. Là-haut, les bruits parviennent étouffés. Sourd mugissement du mistral, respiration, brusques surgissements, accalmies comme une eau plate au fond d’un bois puis souffle de forge, basse lancinante et rafales en trémolos, notes plus aiguës, plaintives, légères, fondantes, enfin le son du hautbois s’impose, les scories du monde s’effritent balayées, ils peuvent commencer de vivre tous les deux.
La nuit est tombée doucement, le temps ralenti, calme la ville. Là-haut, les bruits parviennent étouffés. Sourd mugissement du mistral, respiration, brusques surgissements, accalmies comme une eau plate au fond d’un bois puis souffle de forge, basse lancinante et rafales en trémolos, notes plus aiguës, plaintives, légères, fondantes, enfin le son du hautbois s’impose, les scories du monde s’effritent balayées, ils peuvent commencer de vivre tous les deux.
Raymond Alcovère, extrait du roman "Le Sourire de Cézanne", éditions n & b, 2007
Le Lac d'Annecy, Paul Cézanne, 1896
02:05 Publié dans Le Sourire de Cézanne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, raymond alcovère, le sourire de cézanne, cézanne
vendredi, 20 février 2009
Lectures/rencontres avec Pierre Autin-Grenier
17:08 Publié dans Evénements | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, pierre autin-grenier, eric pessan
mercredi, 18 février 2009
« ...je fore, je fore dans le gisement
04:05 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sollers, les voyageurs du temps
dimanche, 15 février 2009
Comme elle est vraiment
 Il n'y a que lui, le roman, pour l'affirmer, le temps, le retourner, le transformer, le retrouver, le faire respirer sous nos yeux comme une peau d'étalon de course, l'isoler, l'écouter, le dilater et le contracter, l'accélérer, le freiner, lui, et le cavalier qui l'écrit, qui le lit ; qui écrit et lit sa propre vie comme elle est vraiment.
Il n'y a que lui, le roman, pour l'affirmer, le temps, le retourner, le transformer, le retrouver, le faire respirer sous nos yeux comme une peau d'étalon de course, l'isoler, l'écouter, le dilater et le contracter, l'accélérer, le freiner, lui, et le cavalier qui l'écrit, qui le lit ; qui écrit et lit sa propre vie comme elle est vraiment.
Philippe Sollers, Grand beau temps
Manet
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sollers, roman, manet
jeudi, 29 janvier 2009
Le nerf de la guerre
 Je lis ces temps-ci les Mémoires de Saint-Simon. Il n’y a rien de plus urgent, à mon avis, à lire aujourd’hui. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration. Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité.
Je lis ces temps-ci les Mémoires de Saint-Simon. Il n’y a rien de plus urgent, à mon avis, à lire aujourd’hui. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration. Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité.
Philippe Sollers, extrait de "La littérature ou le nerf de la guerre", lire ici en entier
Watteau, L'indifférent
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, philippe sollers, saint-simon, guerre, watteau
mardi, 27 janvier 2009
La Fontaine de jouvence
 Quand je suis fatigué de mauvais langage, de français lourd, empesé, bref quand tout va mal, je m'administre un bain de jouvence avec les Fables de La Fontaine ; à mon sens, c'est un des sommets de notre langue, personne n'a été aussi précis et percutant à la fois...
Quand je suis fatigué de mauvais langage, de français lourd, empesé, bref quand tout va mal, je m'administre un bain de jouvence avec les Fables de La Fontaine ; à mon sens, c'est un des sommets de notre langue, personne n'a été aussi précis et percutant à la fois...
Ici (merci Gazelle !) ce sont des illustrations qui replongeront peut-être certains comme moi dans de lointains souvenirs...
Mais les textes eux, dont d'une fraîcheur exceptionnelle !
00:17 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, la fontaine, fables, calvet-rogniat
lundi, 26 janvier 2009
En boucle
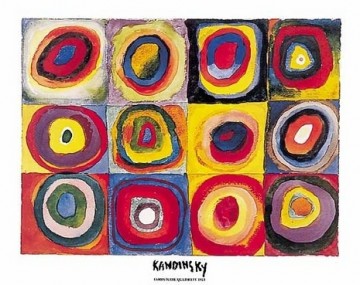 Ce qu’il y a de beau et de terrible, désormais, dans le Spectacle généralisé, c’est sa plasticité immédiate. Vous n’êtes jamais sûr d’avoir vu ce que vous avez vu, ni entendu ce que vous avez entendu. Le Spectacle est à la fois puissamment réel, permanent, passé, irréel, de plus en plus virtuel, et malgré tout réel. Hier est déjà très loin, demain a déjà eu lieu, tout se remplace et s’efface. Exemple : vous dites « Gaza », mais s’est-il vraiment passé quelque chose à Gaza ? Vous dites « Fatah », « Hamas », « Hezbollah », mais que recouvrent ces noms, quelle est leur signification profonde ? Vous dites : j’ai vu des ruines, des cadavres, des linceuls à répétition, des visages égarés de souffrance, et puis j’ai entendu des hurlements, des cris, des sirènes, des bombardements, mais ces morts existent-ils, ces bombardements ont-ils eu lieu ? Oui, aucun doute, mais tout disparaît aussitôt pour recommencer. Le film vous est diffusé en boucle, vous l’avez déjà vu, mais ça continue.
Ce qu’il y a de beau et de terrible, désormais, dans le Spectacle généralisé, c’est sa plasticité immédiate. Vous n’êtes jamais sûr d’avoir vu ce que vous avez vu, ni entendu ce que vous avez entendu. Le Spectacle est à la fois puissamment réel, permanent, passé, irréel, de plus en plus virtuel, et malgré tout réel. Hier est déjà très loin, demain a déjà eu lieu, tout se remplace et s’efface. Exemple : vous dites « Gaza », mais s’est-il vraiment passé quelque chose à Gaza ? Vous dites « Fatah », « Hamas », « Hezbollah », mais que recouvrent ces noms, quelle est leur signification profonde ? Vous dites : j’ai vu des ruines, des cadavres, des linceuls à répétition, des visages égarés de souffrance, et puis j’ai entendu des hurlements, des cris, des sirènes, des bombardements, mais ces morts existent-ils, ces bombardements ont-ils eu lieu ? Oui, aucun doute, mais tout disparaît aussitôt pour recommencer. Le film vous est diffusé en boucle, vous l’avez déjà vu, mais ça continue.
Philippe Sollers, Journal du Mois, janvier 2009, lire la suite ici
Kandinsky
02:18 Publié dans Société du spectacle | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, politique, sollers, journal du mois, kandinsky
dimanche, 25 janvier 2009
La Recherche du temps présent
 Longtemps, je me couche de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se ferment si vite que je n’ai pas le temps de me dire: Je m’endors. Et, une demi-heure après, la pensée qu’il est temps de chercher le sommeil m’éveille; je veux poser le volume que je crois avoir encore dans les mains et souffler ma lumière; je ne cesse pas en dormant de faire des réflexions sur ce que je viens de lire, mais ces réflexions prennent un tour un peu particulier; il me semble que je suis moi-même ce dont parle l’ouvrage: une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survit pendant quelques secondes à mon réveil; elle ne choque pas ma raison mais pèse comme des écailles sur mes yeux et les empêche de se rendre compte que le bougeoir n’est plus allumé. Puis elle commence à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d’une existence antérieure; le sujet du livre se détache de moi, je suis libre de m’y appliquer ou non; aussitôt je recouvre la vue et je suis bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demande quelle heure il peut être; j’entends le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrit l’étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine; et le petit chemin qu’il suit va être gravé dans son souvenir par l’excitation qu’il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour.
Longtemps, je me couche de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se ferment si vite que je n’ai pas le temps de me dire: Je m’endors. Et, une demi-heure après, la pensée qu’il est temps de chercher le sommeil m’éveille; je veux poser le volume que je crois avoir encore dans les mains et souffler ma lumière; je ne cesse pas en dormant de faire des réflexions sur ce que je viens de lire, mais ces réflexions prennent un tour un peu particulier; il me semble que je suis moi-même ce dont parle l’ouvrage: une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survit pendant quelques secondes à mon réveil; elle ne choque pas ma raison mais pèse comme des écailles sur mes yeux et les empêche de se rendre compte que le bougeoir n’est plus allumé. Puis elle commence à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d’une existence antérieure; le sujet du livre se détache de moi, je suis libre de m’y appliquer ou non; aussitôt je recouvre la vue et je suis bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demande quelle heure il peut être; j’entends le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrit l’étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine; et le petit chemin qu’il suit va être gravé dans son souvenir par l’excitation qu’il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour.
Marcel Proust # Arno Calleja
Arno Calleja traduit La Recherche du Temps Perdu au temps présent.
Felix Valloton, Environs de Cagnes, le soir
00:15 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, proust, calleja, felix valloton
samedi, 24 janvier 2009
La Comtesse de Chinchon
 Elle est là, dans un fauteuil dont elle ne sortira plus, dans sa robe de taffetas blanche, juste posée dans la soie, petit bout de soulier en bas, comme si elle tirait la langue. Duex bagues, des bras, un coude, une drôle de petite plante verte sur la tête. Ce n'est pas la duchesse d'Albe, dont la nudité peut encore faire rêver des adolescents avisés, mais une curieuse poule aristocratique, à la bêtise inébranlable et sympathique, vive, aigüe, méchante, innocente (petits yeux noirs lumineux tournés vers la gauche). Elle se laisse prendre par son peintre dont elle ignore absolument le génie, il entre dans son bonnet de dentelle, sa nacre, sa chasteté fade, bouclée. Cette comtesse va vieillir très vite, elle ressasse déjà les platitudes de son temps, elle va rejoindre les vieilles sorcières venimeuses et macabres, mais, pour l'instant, elle est sauvée par les conventions, le protocole. Que serait-elle aujourd'hui ? Une petite-bourgeoise, peut-être ministre. Là, elle vaut beaucoup, et elle ne vaut rien. Elle resplendit de son rien.
Elle est là, dans un fauteuil dont elle ne sortira plus, dans sa robe de taffetas blanche, juste posée dans la soie, petit bout de soulier en bas, comme si elle tirait la langue. Duex bagues, des bras, un coude, une drôle de petite plante verte sur la tête. Ce n'est pas la duchesse d'Albe, dont la nudité peut encore faire rêver des adolescents avisés, mais une curieuse poule aristocratique, à la bêtise inébranlable et sympathique, vive, aigüe, méchante, innocente (petits yeux noirs lumineux tournés vers la gauche). Elle se laisse prendre par son peintre dont elle ignore absolument le génie, il entre dans son bonnet de dentelle, sa nacre, sa chasteté fade, bouclée. Cette comtesse va vieillir très vite, elle ressasse déjà les platitudes de son temps, elle va rejoindre les vieilles sorcières venimeuses et macabres, mais, pour l'instant, elle est sauvée par les conventions, le protocole. Que serait-elle aujourd'hui ? Une petite-bourgeoise, peut-être ministre. Là, elle vaut beaucoup, et elle ne vaut rien. Elle resplendit de son rien.
Goya, La Comtesse de Chinchon
Sollers, Les Voyageurs du temps
17:56 Publié dans Peinture | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, art, peinture, goya, philippe sollers, la comtesse de chinchon, les voyageurs du temps
jeudi, 22 janvier 2009
L'Arétin et le Tintoret
 En rentrant par la place des Prêcheurs, les peintres défilent dans sa tête. Greco, l’émotion brute ; corps, visages étirés, tendus par la douleur, une forme d’humanité rarement atteinte. Vélasquez, Les Menines, phénoménal tableau, le plus extraordinaire de tous peut-être, et La Vénus au miroir, sa sensualité absolue, lisse, froide, brûlante. Rembrandt, ses autoportraits, l’ironie, la nature est une splendeur d’ironie. Caravage, les corps taillés, sculptés par la lumière. Poussin, l’harmonie ; là tout est résumé, compris, entré dans la peinture. Rubens, la perpétuité colorée du sang, écrira Cézanne. Fragonard, l’exaltation, le désir. Delacroix, le feu, la passion. Picasso, à lui seul tout le XX ème siècle, ses chocs, ses ruptures. Et Titien, si fascinant ; talent inouï de coloriste, énergie et raffinement, longévité hors du commun, et son art de déjouer tous les pièges, sa vie durant ; le seul devant qui Charles Quint se soit baissé, pour ramasser ses pinceaux. Et il était l’ami de l’Arétin.
En rentrant par la place des Prêcheurs, les peintres défilent dans sa tête. Greco, l’émotion brute ; corps, visages étirés, tendus par la douleur, une forme d’humanité rarement atteinte. Vélasquez, Les Menines, phénoménal tableau, le plus extraordinaire de tous peut-être, et La Vénus au miroir, sa sensualité absolue, lisse, froide, brûlante. Rembrandt, ses autoportraits, l’ironie, la nature est une splendeur d’ironie. Caravage, les corps taillés, sculptés par la lumière. Poussin, l’harmonie ; là tout est résumé, compris, entré dans la peinture. Rubens, la perpétuité colorée du sang, écrira Cézanne. Fragonard, l’exaltation, le désir. Delacroix, le feu, la passion. Picasso, à lui seul tout le XX ème siècle, ses chocs, ses ruptures. Et Titien, si fascinant ; talent inouï de coloriste, énergie et raffinement, longévité hors du commun, et son art de déjouer tous les pièges, sa vie durant ; le seul devant qui Charles Quint se soit baissé, pour ramasser ses pinceaux. Et il était l’ami de l’Arétin.
Raymond Alcovère, extrait du roman : Le Sourire de Cézanne
La Rencontre entre L'Arétin et le Tintoret
« On faisait circuler à Venise un sonnet injurieux pour le petit teinturier, qui résolut aussitôt d'imposer silence aux langues venimeuses.
Un jour qu'il aperçut l'Arétin dans les environs de la place Saint-Marc, Jacopo l'aborda poliment, et le pria de venir jeter un coup d'oeil sur ses ouvrages et lui donner une heure de séance, disant qu'il voulait faire d'un personnage si célèbre un portrait au crayon.
L'Arétin, entraîné par tant de courtoisie, et pensant que le jeune peintre n'avait pas connaissance du sonnet, se laissa conduire à San-Luca.
A peine entré dans l'atelier, il vit son hôte fermer la porte avec soin, courir vers un trophée d'armes, en décrocher une dague fort pointue, et s'avancer l'arme au poing.
Jacques Robusti portait bien son nom : ses épaules carrées, sa taille haute, ses bras nerveux, sa mine énergique et l'épaisse forêt de cheveux qui se dressait sur sa large tête, lui donnaient l'apparence d'un athlète solide et de mauvaise rencontre pour un homme qui l'avait offensé.
L'Arétin se repentit trop tard de son imprudence.
— Eh ! Seigneur Robusti, s'écria-t-il en changeant de visage, que voulez-vous faire de cette dague ?
— Tenez-vous droit et ne bougez pas, lui dit brusquement le Tintoret, sans quoi je ne réponds de rien.
L'Arétin, tremblant de tous ses membres, vit Jacopo s'approcher de lui, et le toiser des pieds à la tête avec la dague.
—Vous avez, poursuivit le peintre, deux fois et demie la longueur de cette lame. Ne fallait-il pas, pour faire de vous un portrait exact, que j'eusse la mesure de votre personne ?
Voilà qui est fini; mais n'oubliez pas que, s'il vous arrive de m'insulter dans vos sonnets, je prendrai avec cette dague la mesure de votre coeur et de vos entrailles.
A présent, asseyez-vous dans ce fauteuil, et causons ensemble sans nous fâcher, pendant que je mettrai sur ce papier le visage effaré de votre seigneurie.
Depuis ce moment, l'Arétin ne prononça jamais le nom du Tintoret, et s'abstint de blâme aussi bien que de louange.
Mais la coterie du Titien et de ses amis demeura toujours hostile à Jacques Robusti ; c'est pourquoi il eut l'avantage sur son rival, sinon par le talent, du moins par le caractère.
Jamais le Tintoret ne cessa de professer une égale admiration pour le Titien et Michel-Ange, comme l'attestaient ces deux noms inscrits dans son atelier, pour rappeler aux jeunes gens les deux grands modèles que, selon lui, tout peintre ambitieux se devait proposer.
Cet hommage et cette justice n'apaisèrent point ses ennemis; et lorsque Sansovino acheva les belles portes de bronze de la sacristie de Saint-Marc, il y plaça, parmi ses figurines gracieuses, les têtes de l'Arétin et du Titien à côté de la sienne, et il oublia celle du Tintoret, dont, assurément, le voisinage n'eût point fait tort aux trois autres.
Au contraire, Jacques Robusti, dans ses compositions, se plut, avec une généreuse obstination, à reproduire souvent la figure du grand maître, dont il ne put jamais adoucir la rancune. »
Paul de Musset - Voyage en Italie
00:15 Publié dans Le Sourire de Cézanne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman, raymond alcovère, tintoretto, le sourire de cézanne
lundi, 19 janvier 2009
Les Voyageurs du temps
 Voici un très bon papier sur "Les Voyageurs du temps" de Philippe Sollers, signé Yann Moix, dans Le Figaro littéraire :
Voici un très bon papier sur "Les Voyageurs du temps" de Philippe Sollers, signé Yann Moix, dans Le Figaro littéraire :
"On croit toujours qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui raconte. Non, désolé : un écrivain, c'est quelqu'un qui pense. Si on aime la fiction, pas la peine de lire : la réalité en est pleine. On aurait tort de laisser la pensée aux philosophes, qui ne sont finalement que des professeurs. Quand ils n'expliquent pas la pensée de leurs grands prédécesseurs, ils expliquent la leur : quelqu'un qui explique une pensée est quelqu'un qui ne pense pas. Seul, face au monde, se dresse donc l'écrivain, le vrai. De la vision du monde d'un philosophe, il ne reste que le monde, ce qui n'a aucun intérêt. De la vision du monde d'un écrivain, il reste avant tout la vision, ce qui n'a pas de prix. C'est là le sujet des Voyageurs du temps de Sollers : si aujourd'hui tout le monde vise la même chose, c'est parce que tout le monde vise de la même façon.
Dans une société où l'homme est de moins en moins capable de produire une œuvre d'art, il ne lui reste plus qu'une arme : se moquer des artistes - en particulier des écrivains. S'en moquer au sens de n'en avoir cure, mais aussi au sens de les tourner en dérision. Hier encore, l'écrivain était une bête curieuse, il est aujourd'hui une bête tout court, et même, nous dit Sollers : la Bête. « La Bête sait au moins une chose : les parasites veulent lui voler sa vie et la nier en bloc. » Les parasites, ce sont ceux qui glosent (universitaires, profs, exégètes), ceux qui ironisent (humoristes, présentateurs de télé), ceux qui jugent (critiques, journalistes), ceux qui jalousent (seconds couteaux, mauvais écrivains), ceux qui méprisent (hommes politiques, hommes d'affaires), bref, ceux qui sont tournés toute la journée, à toute vitesse, vers le « progrès » et qui, aveuglés par l'effet immédiat, le rendement rapide, le résultat instantané, ne connaîtront jamais ce pays magnifique dans lequel Sollers et les siens voyagent, savent, peuvent voyager : le Temps.
Le Temps avec une majuscule, parce que c'est un temps spécial, parallèle, qui est celui de la postérité bien sûr (celle de la Pléiade et non du Panthéon), mais aussi du véritable présent, un présent fait de toute la mort du passé et de toute la vie de l'avenir. Si je pouvais habiter, à l'année, dans une toile de Watteau, dans l'Embarquement pour Cythère par exemple, ou passer deux mois de vacances dans Anna Karénine, ou encore un week-end dans Satin Doll de Duke Ellington, je serais un voyageur du Temps tel que Sollers le définit. Mais je peux aussi habiter toute ma vie dans mon œuvre, afin de préparer mon voyage : comme les saints ont accès à l'éternité du Ciel, il existe une éternité équivalente pour les écrivains, les peintres, les musiciens qui ont marqué (changé ?) l'humanité. Tous les génies y deviennent contemporains de tous les génies : Breton et Dante peuvent converser d'égal à égal, comme dans le Talmud des rabbins séparés de plusieurs siècles dans le temps chronologique et scolaire de l'histoire, se chamaillent sur des versets ou des points de la Michna.
Le temps n'est plus un problème quand on a la même fluidité que lui, quand on est de même nature que lui. Il ne s'écoule plus puisque nous nous écoulons avec lui, au même rythme que lui. Qui se donnera la peine de lire « vraiment » Les Voyageurs du temps ? Sollers n'est pas dupe : « presque » personne.
C'est ce « presque » qui sert de Vercors au résistant qu'il est, à ceci près qu'il est seul dans son propre maquis. Sollers m'aura appris une chose, depuis que je le lis : que la solitude est un enfer qu'il s'agit de retourner, de détourner en paradis. C'est bien cela que la foule parasitaire ne supporte pas : l'homme seul. Or, la figure absolue de l'homme seul, c'est l'écrivain. Certes, quand je lis ici que Sollers conspue violemment (Sollers n'est jamais agressif : il est toujours violent) le « parti intellectuel », la Sorbonne, l'université, les temps modernes et les progressistes, je me demande pourquoi il a tant de réticences sur Péguy, mais je me rassure en me disant qu'il ne l'a pas lu. Le jour où le Bordelais charmeur rencontrera vraiment l'Orléanais colérique, ça risque de faire très mal.
En attendant, je voudrais juste attirer l'attention sur ce fait majeur : au milieu du brouhaha et des rires, du second degré et de la vulgarité ambiante, Philippe Sollers, qu'on le veuille ou non, vient de lancer, depuis la Dogana, une bouteille à la mer du temps : ce livre. Que vous l'achetiez ou pas, que vous le lisiez ou non, aucune importance. Il se trouve que c'est peut-être un chef-d'œuvre. J'en sors bouleversé."
Philippe Sollers, Les Voyageurs du temps. Éditions Gallimard, 244 p., 17, 90 €.
Giorgio de Chirico, La Conquête du philosophe
00:15 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sollers, les voyageurs du temps, yann moix
dimanche, 18 janvier 2009
Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes...
 Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes: on se sent mieux à l'abri des hommes.
Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes: on se sent mieux à l'abri des hommes.
Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées.
Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l'étang, et leur perchée à l'entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j'entrais en pleine possession des sympathies de ma nature. Rencontrai-je quelque laboureur au bout d'un guéret, je m'arrêtais pour regarder cet homme germé à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné, et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait sueurs brûlantes aux pluies glacées de l'automne : le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégante démone? Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrait la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère: je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines.
Le soir je m'embarquais sur l'étang, conduisant seul mon bateau au milieu des joncs et des larges feuilles flottantes du nénuphar. Là, se réunissaient les hirondelles prêtes à quitter nos climats. Je ne perdais pas un seul de leurs gazouillis : Tavernier enfant était moins attentif au récit d'un voyageur. Elles se jouaient sur l'eau au tomber du soleil, poursuivaient les insectes, s'élançaient ensemble dans les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la surface du lac, puis se venaient suspendre aux roseaux que leur poids courbait à peine, et qu'elles remplissaient de leur ramage confus.
Chateaubriand, Mémoires d'Outre-tombe
Picasso, Portrait de Dora Maar
00:19 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : picasso, dora maar, chateaubriand, littérature, peinture, art
samedi, 17 janvier 2009
Temps éternel de l'enfance

Kafka, Journal, 18 octobre 1921
Photo de Gildas Pasquet, Chine 2008, Nantong
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, kafka, gildas pasquet
mercredi, 14 janvier 2009
Ilya
 " Le matin, le soleil raccourcit les distances, les yeux portent loin et tout près, l’oeil est comme dans l’oeil de sa perle close. On tient le le globe. Et de même que, dans la nuit, le cercle se referme et se met à plat, chaque matin-perle roule dans sa nacre, dans sa cornée, comme un dé. Là-bas, je vais le toucher là-bas, l’horizon, avec la main, avec une main mentale, mais en même temps la fleur, devant moi, cette rose, s’enlève avec un fracas silencieux. Il y a un soir, il y a un matin. Une racine d’obscurité, une autre de clarté. Ilya . Les étoiles filantes sont comme des lys d’or. On est dans l’anticyclone sec, ami des poumons, des contours. La lutte pour l’espace et le temps ne s’arrête pas une seconde.
" Le matin, le soleil raccourcit les distances, les yeux portent loin et tout près, l’oeil est comme dans l’oeil de sa perle close. On tient le le globe. Et de même que, dans la nuit, le cercle se referme et se met à plat, chaque matin-perle roule dans sa nacre, dans sa cornée, comme un dé. Là-bas, je vais le toucher là-bas, l’horizon, avec la main, avec une main mentale, mais en même temps la fleur, devant moi, cette rose, s’enlève avec un fracas silencieux. Il y a un soir, il y a un matin. Une racine d’obscurité, une autre de clarté. Ilya . Les étoiles filantes sont comme des lys d’or. On est dans l’anticyclone sec, ami des poumons, des contours. La lutte pour l’espace et le temps ne s’arrête pas une seconde.
Je suis au sud. Je regarde au nord. A droite, rose léger. Le soir, à gauche, couchant rouge. Nuit d’ardoise. On voudrait écrire directement là-dessus, à la craie.
La lune, tôt, fond bleu, trace blanche : un peu de lait, empreinte du pouce nocturne, à demi effacé, au bas du passeport jour.
Dans la brume bleutée permanente, matin et soir finissent par coïncider. C’est le temps vertical, la grande paix. Du geste du matin au geste du soir, c’est comme s’il s’était écoulé d’abord une heure, ensuite une demi-heure, puis un quart d’heure, puis dix minutes, puis deux minutes, puis une minute, puis trente secondes, puis dix secondes — et bientôt c’est le poudroiement intime du temps, j’enchaîne à pic, sans mémoire, le moment vient où je n’aurai plus la possibilité de noter.
Expédition de l’instant, loin, à côté, en Chine, croisière jaune, empire du milieu, tout a disparu, mer sableuse.
Mais le bleu et le blanc, plus ou moins profonds, taches mouvantes, ciel et eau, sont bien comme dans les vases innombrables, moine et disciple sous les pommiers en fleur, " ce monde est un vase sacré, impossible de le façonner ".
Et aussi : " Connais le blanc, adhère au noir. "
Je ne dirai jamais assez de bien du chinois, Reine, chacun de ses caractères, même le plus banal, m’aide à vivre. Tch’ong : l’eau jaillissante et le vide, vase qui ne se remplit jamais, ou si vous voulez davantage, profondeur insondable où tous les phénomènes se réalisent. Pourtant, tch’ong suffit. Quant au Saint et au Sage, il s’assoit face au Sud, et voilà tout.
Voilà tout .
Vers trois heures et demie du matin, donc, avec pour seuls témoins les feux dispersés de la côte, je me lève, je vais dans le jardin, pierrot lunaire, je développe en moi mes photos de la journée. La nuit est bouclée. Elle est enceinte du vide. Le noir se referme avec la dernière cigarette écrasée dans le gravier. Le pin parasol est l’arbre conseil. Le vent se lève, les étoiles brillent un peu plus.
" L’espace peut être rempli au point que l’air semble ne plus y passer, tout en contenant des vides tels que les chevaux peuvent y gambader à l’aise. "
Ou encore : " Il faut que le vrai vide soit plus pleinement habité que le plein. "
Assemblage air-vent-mer-fleurs-oiseaux. Les phrases à l’écoute. "
Philippe Sollers, Le lys d’or, 1989, Gallimard, p. 133-134.
Le Temple bouddhique à la montagne, estampe du X ème siècle, Li Cheng
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, chine, philippe sollers, le lys d'or
dimanche, 11 janvier 2009
La lecture de connaissance
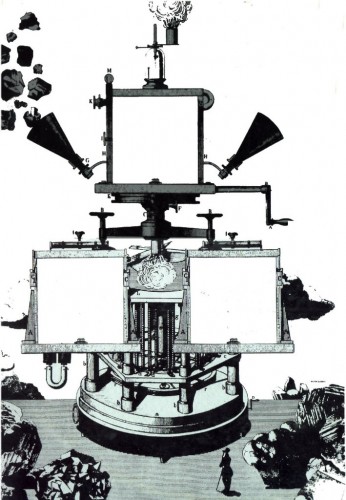 La gnose, dans son insistance sur le Temps, n'arrête pas de dire que toute lecture fondamentale est cognitive, c'est-à-dire qu'elle produit des effets de connaissance. Lisez, lisez bien, lisez encore, et vous ne verserez pas dans la mort. Il ne s'agit pas de répéter des formules magiques, des prières, des borborygmes abrutissants, il ne s'agit pas non plus de textes "sacrés", mais d'un effet d'intelligence. La lecture de connaissance vous tire du temps mort. Elle est donc une révélation que le contrôle doit empêcher par tous les moyens, en menant une guerre sans merci dans l'imprimerie (désormais, dans nos régions, surabondance de livres pour noyer certains livres), mais aussi directement dans les cerveaux qu'il faut sans cesse occuper à autre chose. Toute lecture vivante est donc suspecte, passéiste, élitiste, surtout si elle se dirige vers les temps anciens, lesquels ne sont plus autorisés que sous préservatifs religieux ou universitaire. On veille ainsi à une stricte surveillance du grec, de l'hébreu, du latin, du sanscrit, du chinois classique, le district le plus surveillé restant quand même le français : il est vif, imprévu, il traduit tout ce qu'il touche, sa tendance claire et révolutionnaire est connue.
La gnose, dans son insistance sur le Temps, n'arrête pas de dire que toute lecture fondamentale est cognitive, c'est-à-dire qu'elle produit des effets de connaissance. Lisez, lisez bien, lisez encore, et vous ne verserez pas dans la mort. Il ne s'agit pas de répéter des formules magiques, des prières, des borborygmes abrutissants, il ne s'agit pas non plus de textes "sacrés", mais d'un effet d'intelligence. La lecture de connaissance vous tire du temps mort. Elle est donc une révélation que le contrôle doit empêcher par tous les moyens, en menant une guerre sans merci dans l'imprimerie (désormais, dans nos régions, surabondance de livres pour noyer certains livres), mais aussi directement dans les cerveaux qu'il faut sans cesse occuper à autre chose. Toute lecture vivante est donc suspecte, passéiste, élitiste, surtout si elle se dirige vers les temps anciens, lesquels ne sont plus autorisés que sous préservatifs religieux ou universitaire. On veille ainsi à une stricte surveillance du grec, de l'hébreu, du latin, du sanscrit, du chinois classique, le district le plus surveillé restant quand même le français : il est vif, imprévu, il traduit tout ce qu'il touche, sa tendance claire et révolutionnaire est connue.
Philippe Sollers, Les Voyageurs du temps (vient de sortir)
13:58 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, connaissance, lecture, philippe sollers, les voyageurs du temps
mardi, 06 janvier 2009
Une pause de quelques jours...
Pour vous faire patienter, quelques textes... A bientôt
« La gravité est le plaisir des sots. » : Alexandre Vialatte.
 quand on s'éveille enfin a la claire compréhension
quand on s'éveille enfin a la claire compréhension
Et que l'on sent qu'il n'y a aucune frontière
Qu'il n'y en a jamais eu
On se rend compte qu’on est tout.
Les montagnes, les rivières,
L'herbe, les arbres, le soleil, la lune, les étoiles
Et l'univers enfin
Ne sont autres que nous-mêmes.
Rien ne nous distingue
Rien ne nous sépare les uns des autres
L'aliénation, la peur, la jalousie, la haine
Sont évanouies.
On sait en pleine lumière
Que rien n'existe en dehors de soi
Que par conséquent rien n'est a craindre.
Etre conscient de cet état
Engendre la compassion,
Les gens et les choses
Ne sont plus séparés de nous
Mais sont au contraire
Comme notre propre corps.
Genpo Sensei, Moine Zen japonais
 "... L'hiver au pays Rebeillard était toujours une saison étincelante. Chaque nuit la neige descendait serrée et lourde.... Les villes, les villages, les fermes du Rebeillard dormaient ensevelis dans ces épaisses nuits silencieuses. De temps en temps toutes les poutres d'un village craquaient, on s'éveillait, les épais nuages battaient des ailes au ras de terre en froissant les forêts. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante. A peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée ; le plus maigre buisson éclatait en coeur de flamme. Dans les forêts métalliques et solides le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau ; il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays.
"... L'hiver au pays Rebeillard était toujours une saison étincelante. Chaque nuit la neige descendait serrée et lourde.... Les villes, les villages, les fermes du Rebeillard dormaient ensevelis dans ces épaisses nuits silencieuses. De temps en temps toutes les poutres d'un village craquaient, on s'éveillait, les épais nuages battaient des ailes au ras de terre en froissant les forêts. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante. A peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée ; le plus maigre buisson éclatait en coeur de flamme. Dans les forêts métalliques et solides le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau ; il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays.
Jean Giono, Le Chant du Monde
 L’année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ç’avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie—il ne savait lui-même—qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique qu’il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d’impressions. Une impression de ce genre pendant un instant, est pour ainsi dire sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu’éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son «fondu» les motifs qui par instants en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu’ils donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables,—si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des fac-similés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que quand la même impression était tout d’un coup revenue, elle n’était déjà plus insaisissable. Il s’en représentait l’étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive; il avait devant lui cette chose qui n’est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l’architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois il avait distingué nettement une phrase s’élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières, dont il n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien autre qu’elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu.
L’année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ç’avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie—il ne savait lui-même—qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique qu’il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d’impressions. Une impression de ce genre pendant un instant, est pour ainsi dire sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu’éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son «fondu» les motifs qui par instants en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu’ils donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables,—si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des fac-similés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que quand la même impression était tout d’un coup revenue, elle n’était déjà plus insaisissable. Il s’en représentait l’étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive; il avait devant lui cette chose qui n’est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l’architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois il avait distingué nettement une phrase s’élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières, dont il n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien autre qu’elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu.
D’un rythme lent elle le dirigeait ici d’abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d’un coup au point où elle était arrivée et d’où il se préparait à la suivre, après une pause d’un instant, brusquement elle changeait de direction et d’un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l’entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui il eut besoin d’elle, il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu’il a aperçue un moment vient de faire entrer l’image d’une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu’il sache seulement s’il pourra revoir jamais celle qu’il aime déjà et dont il ignore jusqu’au nom.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann
Estampes de Hiroshige
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : pause, littérature, hiroshige, jean giono, proust, zen, vialatte
samedi, 03 janvier 2009
Toute ta présence...
(pour Giya Kancheli)
Toute ta présence dans l'attrait de ce village sous la neige.
Il s'agissait de trouer l'espace, de dissiper les ténèbres
mais l'intense mélodie, véhémente, s'effaçait,
niait le possible retour,
affirmait ses retards, ses motifs de soupir,
se répétait dans des volées de cuivre,
se déformait soudain en notes pantelantes.
Pour qui revenait au pays, tout n'était-il dés lors que contours,
approche austère et insoumise,
double travesti et dissonant ?
La plaine se révélait tantôt résignée,
tantôt revêche et inconstante.
Où étaient donc les couleurs de l'enfance ?
Celles de ta musique ne cessaient de s'altérer, de virer.
Tu l'avais dis Giya : " Le pays de couleur chagrin ".
Pourtant, tout près, le rire des enfants,
la démarche et la souplesse des femmes,
là, l'orange oblique du soleil sur les toits de neige,
plus loin les troupeaux silencieux, les hommes dans de grands gestes.
Cette fugitive et musicale avancée
d'un mirage qui bat dans la poitrine,
cette voix qui appelle entre plume et pierre,
résonnent aujourd'hui de ce que Delacroix avait su reconnaître
dans une autre " musique, tout à coup surgie de l'embuscade,
non plus comme un rapace s'élevant sous l'archet,
ni pour l'oreille où la béatitude
mais pour les muscles, pour les tempes palpitantes ".
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, pierre bouheret, l'instant du monde
lundi, 29 décembre 2008
Et cette illusion de bonheur finit par devenir bonheur...
 Envie de sortir, de marcher, je suis monté à San Martino. Ce genre de décor somptueux, chargé m’aurait déplu il y a quelques années. Dorures, stuc, marbres polychromes, couleurs fondues, motifs enlacés, anges virevoltants, tout est fait pour dérouter l’âme, qu’elle vacille, l’enlever des griffes du réel, la jeter dans un monde de miroirs corruscants, un crépitement de pierreries, de marbres roses. Les plafonds figurent des ouvertures vers le ciel, vers d’autres images, où rien ne finit jamais. Une illusion de bonheur qui n’a jamais de fin. Toujours plus de couleurs, de rondeurs, de trompe- l’oeil. Et cette illusion de bonheur finit par devenir bonheur...
Envie de sortir, de marcher, je suis monté à San Martino. Ce genre de décor somptueux, chargé m’aurait déplu il y a quelques années. Dorures, stuc, marbres polychromes, couleurs fondues, motifs enlacés, anges virevoltants, tout est fait pour dérouter l’âme, qu’elle vacille, l’enlever des griffes du réel, la jeter dans un monde de miroirs corruscants, un crépitement de pierreries, de marbres roses. Les plafonds figurent des ouvertures vers le ciel, vers d’autres images, où rien ne finit jamais. Une illusion de bonheur qui n’a jamais de fin. Toujours plus de couleurs, de rondeurs, de trompe- l’oeil. Et cette illusion de bonheur finit par devenir bonheur...
Raymond Alcovère, extrait de Fugue baroque, roman
Manet, pivoines
17:13 Publié dans Fugue baroque | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, raymond alcovère, fugue baroque, manet
dimanche, 28 décembre 2008
Eden caché
 En réalité, personne ne veut du paradis parce qu'il est gratuit. La joie, le bonheur, l'amour sont gratuits. Un amour qui n'est pas gratuit n'est pas de l'amour. C'est la raison pour laquelle le bonheur réel ne peut être que farouchement clandestin dans un monde livré au calcul.
En réalité, personne ne veut du paradis parce qu'il est gratuit. La joie, le bonheur, l'amour sont gratuits. Un amour qui n'est pas gratuit n'est pas de l'amour. C'est la raison pour laquelle le bonheur réel ne peut être que farouchement clandestin dans un monde livré au calcul.
Watteau, embarquement pour l'île de Cythère, détail
17:50 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ede, littérature, philippe sollers, watteau



















 [...] je trouve toujours quelque chose de nouveau ».
[...] je trouve toujours quelque chose de nouveau ».