vendredi, 03 octobre 2008
Une question d'honneur
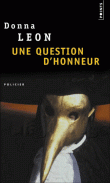 Une question d’honneur est le onzième roman de Donna Leon, de la série des enquêtes du Commissaire Brunetti. Tous ont pour cadre Venise. De part sa topographie si particulière, la Sérénissime est moins sujette au crime que les autres villes, il n'est pas simple de s'échapper a priori de l’entrelacs des ruelles et des canaux ; n'y vivent plus que cinquante ou soixante mille habitants qui se connaissent pour la plupart ; en clair tout le monde observe tout le monde ou est susceptible de le faire, ce qui décourage les vocations ! Rien n’est plus faux, nous dit Donna Leon, derrière les portes des palais, comme partout, le crime fleurit. La romancière est américaine, vit à Venise depuis très longtemps et décrit une autre ville cachée sous la première, ses secrets, ses mystères. Ce à travers un personnage atypique, le commissaire Brunetti, une sorte de Maigret, bourru, massif, opiniâtre, qui louvoie dans ce magma, sans cesse en train de confronter son éthique à la complexité du monde et à ses forces obscures. Un terrien, amateur de cuisine et de vin blanc, marié à une professeur de littérature spécialiste de Henry James, avec deux adolescents à la maison, et lui-même passionné de Thucydide. Il se fie à son instinct, mais aussi à sa connaissance de la ville, de ses familles, de ses codes, de son histoire, pour en déjouer les affaires les plus troubles, les plus sordides. Une question d’honneur nous plonge dans le monde interlope des marchands d’art dont certains ont acquis des fortunes considérables en pillant de riches juifs prêts à tout pour fuir le nazisme pendant la seconde guerre mondiale. Cette enquête comme d'habitude est remarquablement ficelée, et le regard sur Venise (d'où les touristes sont étrangement absents, sinon comme une gêne pour les vénitiens), inhabituel et décalé, est assez réussi. Et l'atmosphère de la ville est bien là, à la fois liquide et sensuelle, glauque et lumineuse.
Une question d’honneur est le onzième roman de Donna Leon, de la série des enquêtes du Commissaire Brunetti. Tous ont pour cadre Venise. De part sa topographie si particulière, la Sérénissime est moins sujette au crime que les autres villes, il n'est pas simple de s'échapper a priori de l’entrelacs des ruelles et des canaux ; n'y vivent plus que cinquante ou soixante mille habitants qui se connaissent pour la plupart ; en clair tout le monde observe tout le monde ou est susceptible de le faire, ce qui décourage les vocations ! Rien n’est plus faux, nous dit Donna Leon, derrière les portes des palais, comme partout, le crime fleurit. La romancière est américaine, vit à Venise depuis très longtemps et décrit une autre ville cachée sous la première, ses secrets, ses mystères. Ce à travers un personnage atypique, le commissaire Brunetti, une sorte de Maigret, bourru, massif, opiniâtre, qui louvoie dans ce magma, sans cesse en train de confronter son éthique à la complexité du monde et à ses forces obscures. Un terrien, amateur de cuisine et de vin blanc, marié à une professeur de littérature spécialiste de Henry James, avec deux adolescents à la maison, et lui-même passionné de Thucydide. Il se fie à son instinct, mais aussi à sa connaissance de la ville, de ses familles, de ses codes, de son histoire, pour en déjouer les affaires les plus troubles, les plus sordides. Une question d’honneur nous plonge dans le monde interlope des marchands d’art dont certains ont acquis des fortunes considérables en pillant de riches juifs prêts à tout pour fuir le nazisme pendant la seconde guerre mondiale. Cette enquête comme d'habitude est remarquablement ficelée, et le regard sur Venise (d'où les touristes sont étrangement absents, sinon comme une gêne pour les vénitiens), inhabituel et décalé, est assez réussi. Et l'atmosphère de la ville est bien là, à la fois liquide et sensuelle, glauque et lumineuse.
(La plupart des enquêtes du commissaire Brunetti sont disponibles en "poche" dans la collection points policiers)
08:48 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, critique, venise, donna leon
samedi, 06 septembre 2008
Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Françoise Renaud, par Hervé Pijac
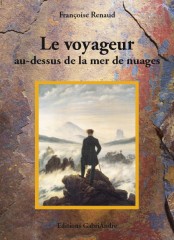 Ce roman — dont le titre judicieux est tiré de l’œuvre éponyme du peintre Caspar David Friedrich — nous invite dans une quête sensible de l’absolu au travers d’un retour, parfois douloureux, sur soi-même. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, pourtant, comme dans toute son œuvre, Françoise Renaud dévoile quelques pans de ses racines et la maîtrise de son émotivité est l’apanage des « vrais » écrivains, toujours à la recherche d’un inaccessible…
Ce roman — dont le titre judicieux est tiré de l’œuvre éponyme du peintre Caspar David Friedrich — nous invite dans une quête sensible de l’absolu au travers d’un retour, parfois douloureux, sur soi-même. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, pourtant, comme dans toute son œuvre, Françoise Renaud dévoile quelques pans de ses racines et la maîtrise de son émotivité est l’apanage des « vrais » écrivains, toujours à la recherche d’un inaccessible…
Cette fois elle se glisse dans une âme masculine.
Un homme aurait tout pour être heureux s’il n’était confronté au mal de vivre à cette période charnière de l’existence où l’on s’interroge, parfois en vain, parfois découvrant le chemin. Une rencontre avec une Cévenole va le conduire doucement à la sérénité.
Cet homme pourrait être vous, ou moi. En tout cas, je me retrouve en lui, aussi dans l’hommage rendu à cette femme à la fois guide et amie, transfigurée par la maladie et d’une grande force morale.
Que ce livre ait été récompensé du Prix Vallée Livres 2008 n’est pas le fruit du hasard. Les Cévennes y sont omniprésentes, tant dans les caractères des personnages que par la prégnance de la pierre (Il y avait le schiste à tessiture sombre, le granite en vigie, le calcaire fissuré. (…) Le schiste avait ma préférence.) et, peut-être surtout, des paysages (Ces montagnes sauvages (…) connaissent des matins d’azur et des nuits de neige, des chuchotements d’herbe et des hurlements de vent.). Tellurisme garanti, à fleur de granite.
Françoise Renaud, bretonne et géologue, nous offre l’enchantement d’un texte superbe à l’écriture épurée et d’une grande justesse, marquée de cette sensualité des mots qui lui est chère.
Éditions GabriAndre, 2008 – 16,95 €
http://www.editions-gabriandre.com
Voir ici le site de Françoise Renaud
15:44 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, critique, françoise renaud, le voyageur au-dessus de la mer de nuages
lundi, 28 juillet 2008
Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages, de Françoise Renaud
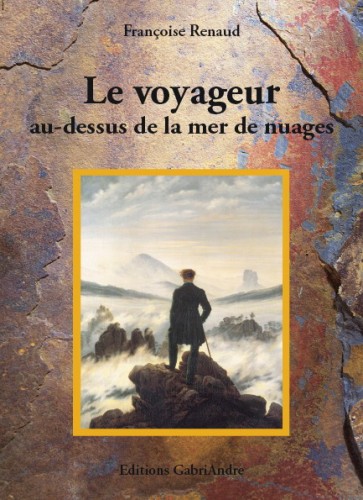 Voir la présentation du livre ici
Voir la présentation du livre ici
« La vie d’un homme ressemble à celle de la montagne. L’événement qui arrive noie les précédents dans le chaos, remanie les matériaux tout en les entraînant vers l’abîme. Mais un jour tout remonte à la surface. » La montagne que raconte le dernier livre de Françoise Renaud est la Cévenne, terre rude et sensuelle en même temps, massive et tendre, fermée en apparence mais où les cœurs s’ouvrent si fort. C’est l’histoire d’un homme aussi qui remonte le cours de sa vie et des ses amours. « Auprès d’Hélène, la matière du souffle se faisait plus dense, l’espace se tendait comme une voile au vent. » « Ce n’était pas qu’Hélène me remplissait les veines de feu et m’inspirait des sentiments inédits, non, c’était seulement que sa présence révélait en moi une vie secrète. » Et dans la vie de cet homme, la découverte du tableau de Friedrich : « Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages » va jouer un rôle clé. « Chez Friedrich, toujours des transparences et des lumières surnaturelles, du minéral déchiqueté : parois diaclasées, chaos, abîmes, sommets inaccessibles avec personnages minuscules dominés par la puissance des événements terrestres. » On se laisse d’abord envoûter par la beauté du style de l’écrivain, son amplitude, la sensualité et la pudeur qui en émanent, puis par la finesse des notations psychologiques. Françoise Renaud a le don d’alterner les phrases longues et belles avec des énoncés courts et concis qui arrêtent la lecture et imposent la réflexion, un peu comme la vie finalement faite de longs moments creux et de satoris fulgurants.
Editions GabriAndre, prix Vallélivre Cévennes 2008
00:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le voyageur au-dessus de la mer de nuages, françoise renaud, critique, cévennes
dimanche, 09 mars 2008
Les Bienveillantes
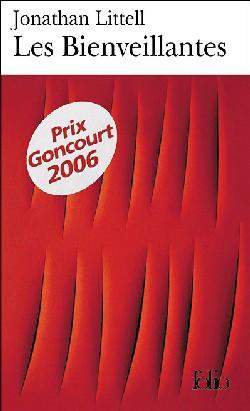 Les Bienveillantes sont les mémoires fictifs d'un officier SS durant la deuxième guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, il est plutôt observateur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa soeur, il devient homosexuel.
Les Bienveillantes sont les mémoires fictifs d'un officier SS durant la deuxième guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, il est plutôt observateur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa soeur, il devient homosexuel.
Une des raisons essentielles développée dans le roman pour expliquer l'Holocauste est la ressemblance, voire la symétrie entre les Allemands (au sens d’Allemands aryens) et les Juifs. On ne tue finalement l’autre que parce qu’il incarne ce que l’on ne supporte pas dans son propre être. D’ailleurs Turek, qui massacre les Juifs avec tant de sadisme, a pour le narrateur un physique typiquement Juif. La sœur du narrateur est d’avis qu’« en tuant les Juifs [les Allemands ont] voulu [se] tuer eux-mêmes, tuer le Juif en [eux]. Tuer […] le bourgeois pansu qui compte ses sous, qui court après les honneurs et rêve de pouvoir […], tuer l’obéissance, tuer la servitude du Knecht, tuer toutes ces belles vertus allemandes. »
Un des personnages du roman, le haut dignitaire nazi Mandelbrod – qui porte un nom juif – souligne que les Allemands ont une dette envers les Juifs : « Toutes nos grandes idées viennent des Juifs. Nous devons avoir la lucidité de le reconnaître. » Parmi ces idées, on trouve l’idéologie völkisch (« La Terre comme promesse et comme accomplissement, la notion du peuple choisi entre tous, le concept de la pureté du sang »). Or pour les nazis, il ne peut y avoir deux peuples élus.
Le meurtre de masse est problématique pour la plupart des soldats. Pour remédier à cet état de fait, la création de camps de concentration est un moyen de diluer la responsabilité des différents acteurs du génocide, chacun pouvant arguer n’avoir fait que son travail. A part quelques brutes sadiques, la plupart font ce qu'ils considèrent comme leur devoir avec dégoût, et surmonter ce dégoût est vécu par eux comme une victoire personnelle sur eux-mêmes, une forme de vertu.
Le livre, outre son intérêt historique, est passionnant par ce qu'il pose la question du mal : "J'en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique parce qu'il pense que le détenu n'est pas un être humain ; au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu'il s'aperçoit que le détenu, loin d'être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement, après tout, un homme, comme lui au fond, et c'est cette résistance, vous voyez que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l'autre, et donc le garde le frappe pour essayer de faire disparaître leur humanité commune. Bien entendu, cela ne marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaître comme un non-humain. A la fin, il ne lui reste plus comme solution qu'à le tuer, ce qui est un constat d'échec définitif."
Folio, 1 400 pages, 12 €
00:15 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, les bienveillantes, jonathan littell
lundi, 03 mars 2008
INDIGENTS DE DUBLIN
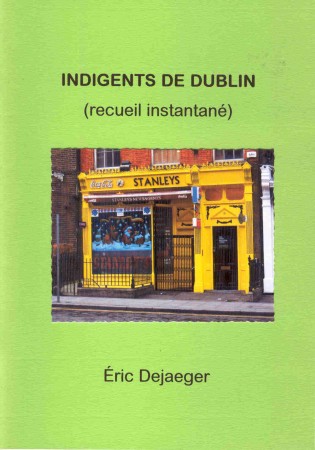 Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. De retour de Dublin, il propose ici dans ce recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Eric Dejaeger, avec son acuité habituelle, arrive à renouveler notre regard sur Dublin, pourtant maintenant décrite et racontée par les écrivains qui en ont fait une des villes les plus littéraires du monde (avec Paris, Lisbonne, Venise...). On découvre ici une ville, plus étrange, plus déroutante encore, plus décalée que ce qu'on avait imaginé. Il nous montre l'envers du décor, l'autre face du "miracle irlandais".
Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. De retour de Dublin, il propose ici dans ce recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Eric Dejaeger, avec son acuité habituelle, arrive à renouveler notre regard sur Dublin, pourtant maintenant décrite et racontée par les écrivains qui en ont fait une des villes les plus littéraires du monde (avec Paris, Lisbonne, Venise...). On découvre ici une ville, plus étrange, plus déroutante encore, plus décalée que ce qu'on avait imaginé. Il nous montre l'envers du décor, l'autre face du "miracle irlandais".
Carmelite Church
dans Aungier Street
est surchauffée.
Les bonnes soeurs
ne risquent pas
de se les geler.
Assez bizarrement,
les mendiants
et les clodos
restent dans la rue.
INDIGENTS DE DUBLIN : des textes écrits à et sur Dublin pendant une semaine de vacances, dactylographiés et mis en page par l’auteur dès son retour et ce en moins d’une journée, d’où le sous-titre : recueil instantané. Tirage strictement limité à 50 exemplaires numérotés et nominatifs.
Format A5 / Couverture 180gr avec photo en couleur ajoutée / 52 pages sur papier 100gr blanc / Textes imprimés en vert et illustrés de 12 photos en couleur.
Si intéressé par un exemplaire, contactez l’auteur : ericdejaeger@yahoo.fr
00:30 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, critique, eric dejaeger, indigents de dublin
samedi, 16 février 2008
Indigents de Dublin (recueil instantané) de Eric Dejaeger
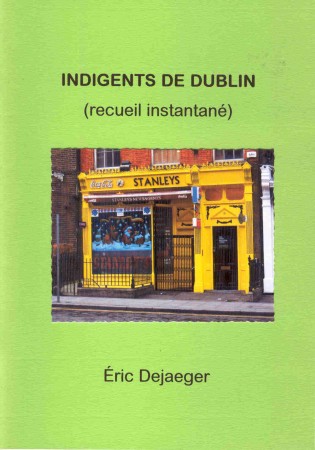 Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. Retour de Dublin, où il a passé quelques jours pendant les fêtes de fin d'année, il propose ici dans ce court recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Dublin est sans doute une des villes les plus "littéraires" du monde (personnellement je n'y suis jamais allé mais j'ai l'impression de bien la connaître), pourtant le regard de Eric Dejaeger nous offre une autre ville, plus étrange, plus déroutante encore que ce qu'on avait imaginé.
Un peu d'Eire, ça fait Dublin ! Eric Dejaeger est un "fondu", comme on dit, de Richard Brautigan, dont il a traduit d'ailleurs bon nombre de poèmes inédits. Retour de Dublin, où il a passé quelques jours pendant les fêtes de fin d'année, il propose ici dans ce court recueil (agrémenté de superbes photos) une suite de poèmes, où on retrouve sa plume, tour à tour légère, désabusée, caustique, grinçante mais toujours profondément humaine et bienveillante. Dublin est sans doute une des villes les plus "littéraires" du monde (personnellement je n'y suis jamais allé mais j'ai l'impression de bien la connaître), pourtant le regard de Eric Dejaeger nous offre une autre ville, plus étrange, plus déroutante encore que ce qu'on avait imaginé.
Dans la foule
sur O'Connell Street
une petite vieille
brandit une pancarte
anti I.V.G. :
"Think of all those children
murdered before being born !"
ou un truc approchant
Se rend-elle seulement compte
qu'elle n'a absolument
plus rien à craindre ?
Et voici le poème qui clôt le recueil :
Dublin
dit-on
est en pleine croissance
économique.
J'ai rarement vu
autant de clochards
et de mendiants
dans une ville
en pleine expansion.
Joyce pourrait écrire
Dublosers
ou
Indigents de Dublin
INDIGENTS DE DUBLIN : des textes écrits à et sur Dublin pendant une semaine de vacances, dactylographiés et mis en page par l’auteur dès son retour et ce en moins d’une journée, d’où le sous-titre : recueil instantané. Tirage strictement limité à 50 exemplaires numérotés et nominatifs.
Format A5 / Couverture 180gr avec photo en couleur ajoutée / 52 pages sur papier 100gr blanc / Textes imprimés en vert et illustrés de 12 photos en couleur.
Si intéressé par un exemplaire, contactez l’auteur : ericdejaeger@yahoo.fr
18:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, Eric Dejaeger, Indigents de Dublin
mercredi, 13 juin 2007
Un ogre dans la ville

Marseille est une ville sublime, étonnante. Onirique même. Au contraire de l'idée de ceux qui ne la connaissent que de loin, la ville qui vit naître Artaud et mourir Rimbaud est pleine de mystères, d'étrangeté. Cendrars en a parlé magnifiquement dans "L'homme foudroyé" : "Marseille, presque aussi ancienne que Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré sous terre, tout est secret." Mireille Disdero nous plonge dans une autre ville encore, loin de tous les clichés, tour à tour solaire et terrifiante. L'orage approchait, dans les aigus. L'orage ici c'est l'ogre. Il s'appelle Angelo. Il harcèle la narratrice, veut la dévorer, lui dévorer sa vie. Il est son double en quelque sorte. Tour à tour Marie et Angelo évoquent chacune des faces de l’histoire, la médaille et son envers. Cet ogre est un monstre affectueux et dangereux. Quelque chose bouge et se lève tout autour. Respiration haletante de fantômes sans au-delà des vies. Larmes rouges du tatoueur pour un amour de peau. Bruit des existences loin, autour, dans les rues. Battements d’ailes noires des secondes qui nous escortent. La ville s’éveille, grandit de ses tentatives sans apaisement. J’ai toujours peur.C’est une ville souvent crépusculaire, venteuse, presque vide (une atmosphère à la De Chirico) qui déroule ses méandres. Et si c’est à un suspens haletant que nous convie Mireille Disdero, rythmé par les encres de Catherine Carruggi, le vrai fil conducteur du roman c’est la poésie : Je m’allonge sur la pierre chaude, les yeux vers le ciel. J’écoute les vagues se jeter contre l’île. Shhhhhhhhuuuuuuuu… Des mouettes tournoient au-dessus de moi pour m’inviter au voyage. La lumière est presque palpable. Je la sens me toucher, m’aimer. Je suis bien. Aujourd’hui, il n’y a personne, pas un seul touriste. J’aime cet endroit. Je pense à la première fois que je suis arrivée à Marseille avec mes parents. On devait atterrir à Marignane mais l’avion est venu faire un demi-tour au-dessus de Marseille et du Frioul, en fin d’après-midi. L’ombre des ailes frôlait les vagues. Ce jour-là, j’ai été heureuse d’avoir des yeux capables de découvrir cette ville adossée à la mer. Je garde encore la marque de sa beauté, même des années après, en traversant ses quartiers aux murailles écorchées. J’aime Marseille, je l’ai dans les yeux, comme une couleur.
00:10 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, Mireille Disdero, Un ogre dans la ville
mercredi, 16 mai 2007
En lisant Le Sourire de Cézanne
21:10 Publié dans Le Sourire de Cézanne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, critique, Jean-Louis Kuffer, Le sourire de Cézanne
samedi, 05 mai 2007
A propos des "Nouvelles de la révolte"
09:36 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, nouvelles de la révolte, 1907, critique
mercredi, 15 novembre 2006
Sur "Le club des pantouflards"
06:00 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, critique, Christian Cottet-Emard, Jean-Jacques Marimbert
vendredi, 10 novembre 2006
Raphaëlle
 Voilà Raphaëlle, tu es à Florence, avec des gens, à un concert où je vais interpréter les plus belles mélodies pour toi. Où es-tu exactement ? Ici ? Ailleurs ? Nulle part. En toi ? Même pas. De toute façon, je vais t’emmener encore plus loin. Sais-tu qu’il y a un lieu tout proche auquel nous n’accédons jamais ? Une sorte de point aveugle de notre existence, vois-tu ? Il nous habite, nous n’y pouvons rien, c’est ainsi, nous lui appartenons, c’est notre bulle, et pourtant, faibles, nous nous tenons au dehors, le plus souvent. C’est ce point aveugle de l’existence que va poursuivre Raphaëlle. Une course éperdue. Elle a quitté sa ville, son compagnon, pour Nice, ville solaire. Au moment de rentrer, sur le quai de la gare, elle prend l’autre train, celui qui part vers l’Italie. Début du voyage.
Voilà Raphaëlle, tu es à Florence, avec des gens, à un concert où je vais interpréter les plus belles mélodies pour toi. Où es-tu exactement ? Ici ? Ailleurs ? Nulle part. En toi ? Même pas. De toute façon, je vais t’emmener encore plus loin. Sais-tu qu’il y a un lieu tout proche auquel nous n’accédons jamais ? Une sorte de point aveugle de notre existence, vois-tu ? Il nous habite, nous n’y pouvons rien, c’est ainsi, nous lui appartenons, c’est notre bulle, et pourtant, faibles, nous nous tenons au dehors, le plus souvent. C’est ce point aveugle de l’existence que va poursuivre Raphaëlle. Une course éperdue. Elle a quitté sa ville, son compagnon, pour Nice, ville solaire. Au moment de rentrer, sur le quai de la gare, elle prend l’autre train, celui qui part vers l’Italie. Début du voyage.
L’écriture est vive, alerte, prise dans son propre mouvement, les dialogues sont incorporés au texte, ils ne s’en démarquent pas. Ce texte c’est une seule pâte, et cette pâte c’est la chair du monde. On court mais on s’attarde aussi. Sur les couleurs, la lumière, les saveurs, les textures. L’action, les personnages sont racontés, décrits par ce qui les environne. Les émotions, sentiments, pensées deviennent chair. C’est cette présence qui rend la lecture si fluide et si vivante. Pas de différence entre l’intérieur et l’extérieur. L’attention du personnage éclaire et donne vie à ce qui l’entoure. Aussi l’univers est sans cesse en mouvement, coloré, sensuel, vibrant. L’écriture y puise son rythme, sa force propre. Comme en peinture, chez Chardin ou Manet par exemple, où l’expression “ nature morte ” est totalement dénuée de sens. Je me rappelle avoir lu quelque part que si nous pouvions voir la réalité telle qu’elle est, nous serions tous des artistes, et nous verrions des tableaux, des sculptures que la vie façonne dans la nature, sans voile. Et puis il y a Florence, un rêve de ville plutôt : A Florence, on étouffe toujours un peu, c’est écrasant à force, on baigne dans le liquide épais de l’imagination. Et bien sûr, en filigrane, Dante et La Divina Comedia. Et même si Raphaëlle dérive : Tu provoques le vide pour le remplir, car dans le vide on meurt, Raphaëlle, on n’a rien à quoi s’accrocher. Alors il faut bien saisir ce qui nous entraîne au fond comme la seule chose à aimer, n’est-ce pas ?, si elle oscille toujours entre l’errance et la rencontre, la solitude et l’amour, le tragique et le solaire, la passion la traverse toujours. Mais la vraie passion commence par tout détruire, âmes, corps, elle ronge tout, c’est le prix à payer pour voir le ciel et voler ! Passion pour le théâtre enfin. Raphaëlle est habitée par Antigone de Sophocle et par Yasmina, une amie comédienne : algérienne, elle revient de l’enfer. Résister, toujours résister, voilà la vie, et le monde vit parce qu’il nous résiste et que nous lui résistons.
Jean-Jacques Marimbert, Raphaëlle, Editions du Ricochet, 140p.
Article paru dans la revue Sol'Air n° 21, juin 2001
00:05 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, critique, Raphaëlle, Jean-Jacques Marimbert
lundi, 06 novembre 2006
J'aimais bien sa nonchalance
Les chroniques de Bernard Frank dans le Nouvel Obs, c'était la certitude d'une page bien écrite, un peu hors du temps, et ce mélange de nonchalance et de vivacité, de distance et de savoir-faire qu'il réussissait si bien, il y avait aussi ses références constantes à Stendhal, Proust, etc. Une manière d'élégance...
13:05 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, critique, Bernard Frank
vendredi, 03 novembre 2006
Un ogre dans la ville

Marseille est une ville sublime, étonnante. Onirique même. Au contraire de l'idée de ceux qui ne la connaissent que de loin, la ville qui vit naître Artaud et mourir Rimbaud est pleine de mystères, d'étrangeté. Cendrars en a parlé magnifiquement dans "L'homme foudroyé" : "Marseille, presque aussi ancienne que Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré sous terre, tout est secret." Mireille Disdero nous plonge dans une autre ville encore, loin de tous les clichés, tour à tour solaire et terrifiante. L'orage approchait, dans les aigus. L'orage ici c'est l'ogre. Il s'appelle Angelo. Il harcèle la narratrice, veut la dévorer, lui dévorer sa vie. Il est son double en quelque sorte. Tour à tour Marie et Angelo évoquent chacune des faces de l’histoire, la médaille et son envers. Cet ogre est un monstre affectueux et dangereux. Quelque chose bouge et se lève tout autour. Respiration haletante de fantômes sans au-delà des vies. Larmes rouges du tatoueur pour un amour de peau. Bruit des existences loin, autour, dans les rues. Battements d’ailes noires des secondes qui nous escortent. La ville s’éveille, grandit de ses tentatives sans apaisement. J’ai toujours peur.C’est une ville souvent crépusculaire, venteuse, presque vide (une atmosphère à la De Chirico) qui déroule ses méandres. Et si c’est à un suspens haletant que nous convie Mireille Disdero, rythmé par les encres de Catherine Carruggi, le vrai fil conducteur du roman c’est la poésie : Je m’allonge sur la pierre chaude, les yeux vers le ciel. J’écoute les vagues se jeter contre l’île. Shhhhhhhhuuuuuuuu… Des mouettes tournoient au-dessus de moi pour m’inviter au voyage. La lumière est presque palpable. Je la sens me toucher, m’aimer. Je suis bien. Aujourd’hui, il n’y a personne, pas un seul touriste. J’aime cet endroit. Je pense à la première fois que je suis arrivée à Marseille avec mes parents. On devait atterrir à Marignane mais l’avion est venu faire un demi-tour au-dessus de Marseille et du Frioul, en fin d’après-midi. L’ombre des ailes frôlait les vagues. Ce jour-là, j’ai été heureuse d’avoir des yeux capables de découvrir cette ville adossée à la mer. Je garde encore la marque de sa beauté, même des années après, en traversant ses quartiers aux murailles écorchées. J’aime Marseille, je l’ai dans les yeux, comme une couleur.
19:21 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, ogre, poésie, Mireille Disdero, critique
jeudi, 26 octobre 2006
Si écrire ne pouvait pas me servir à aimer, autant tout arrêter
 Je n'étais pas faite pour abattre des cartes, je n'étais pas stratège, je n'étais pas séductrice, je n'y arrivais pas. Ou je ne disais rien ou j'étais trop directe. La seule chose qui me convenait c'était le poker, écrire, tout écrire, et faire lire, ça je savais le faire, tout jouer d'un coup. Miser tout sur un seul chiffre qui a peu de chances de sortir, mais s'il sort c'est mieux que tout. C'était le chiffre que j'avais choisi.
Je n'étais pas faite pour abattre des cartes, je n'étais pas stratège, je n'étais pas séductrice, je n'y arrivais pas. Ou je ne disais rien ou j'étais trop directe. La seule chose qui me convenait c'était le poker, écrire, tout écrire, et faire lire, ça je savais le faire, tout jouer d'un coup. Miser tout sur un seul chiffre qui a peu de chances de sortir, mais s'il sort c'est mieux que tout. C'était le chiffre que j'avais choisi.
« Rendez-vous » de Christine Angot est un roman déroutant : vif, efficace, percutant. Dès les premières pages on est emporté. Son écriture ne ressemble à aucune autre, surtout, rarement on aura été aussi loin dans le regard au scalpel sur soi-même, dans le désir, le désir d'une vérité des choses. Sa quête est éperdue, elle déstabilise le lecteur, par moments on reste à l’extérieur, sur la défensive, puis on est bousculé, happé, l’émotion est là, la machine s’emballe: Si écrire ne pouvait pas me servir à aimer, autant tout arrêter. Elle va jusqu'au bout, la littérature et la vie, tout s'entrecroise, les époques, sa vie réelle. Le livre est circulaire, les personnages réapparaissent, au fur et à mesure le regard du lecteur se précise, s'affine. L'utilisation des temps est surprenante, celle de l'imparfait, à contretemps en apparence, mais qui questionne, transforme la lecture. Il y a de l’extrême, on est toujours à la limite de la folie, de l’inconcevable ici dans la relation amoureuse et le livre va toujours plus loin que ce qu’on avait imaginé : c’est sa force . On peut ne pas entrer dans cet univers, le refuser, mais une chose est sûre, il n’est pas ce qu’il semble être. Pas de stratégie d'évitement ici, de contournement, et pourtant (justement plus que jamais) on est dans la littérature, de celle qui bouscule, bouleverse, la seule vraie en quelque sorte.
Quand j’écris, je vois bien moi, la syntaxe n’a pas d’importance, les négations, les conditionnels, les conjonctions, ce n’est que des présentations pour masquer plus ou moins ce qu’on pense, les si, les bien que, pour amoindrir les mots, atténuer les valeurs. Ca ne change pas le contenu, le sens ni les images qui viennent avec. Il n’y a pas de conditions, pas de si dans la vérité.11:00 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman, Angot, critique
vendredi, 22 septembre 2006
Hasard ou nécessité ?
 Mercredi soir, la librairie Sauramps à Montpellier organisait une rencontre lecture avec quatre écrivains : Eric Chauvier, Héléna Marienské, Laurent Mauvignier et Lorette Nobécourt suivie d’une discussion avec Nelly Kapriélian et Emmanuel Favre.
Mercredi soir, la librairie Sauramps à Montpellier organisait une rencontre lecture avec quatre écrivains : Eric Chauvier, Héléna Marienské, Laurent Mauvignier et Lorette Nobécourt suivie d’une discussion avec Nelly Kapriélian et Emmanuel Favre.
http://www.sauramps.com/article.php3?id_article=2086
Ces quatre écrivains, pourtant différents, ont traduit, par leur livre ou les opinions qu’ils défendaient une certaine évolution de la littérature contemporaine française, évolution dessinée ou concrétisée il me semble par Michel Houellebecq, même si celui-ci est beaucoup décrié. Eric Chauvier est anthropologue, et son roman se situe à la limite, à la frange entre sciences humaines et littérature. Laurent Mauvignier, dont les précédents romans étaient plutôt classés dans la catégorie « intimistes » prend cette fois pour sujet un événement marquant de l’histoire contemporaine : la tragédie du Heysel. Lorette Nobécourt, pour la première fois aussi rompt avec le genre « autofiction ». Héléna Marienské dans son roman se moque du « nombrilisme » supposé des écrivains français contemporains et mêle leurs destins à l’histoire récente, en l’occurence de manière loufoque et fantasmée. Alors hasard ou nécessité ?
14:50 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, critique, Houellebecq
mercredi, 12 juillet 2006
La guitare
 Le narrateur, nain, laid et bossu, vit rejeté de tous, quelque part en Galice, dans ce pays de brumes et de pluie. Jusqu'au jour où il découvre la guitare, qui va changer sa vie. Un des premiers livres de Michel del Castillo, écrit en 1957 ; son écriture, sèche et précise, s'empare de toute une série de thèmes pourtant éculés : la laideur extrême, l'envie d'être aimé, le rejet de l'autre, l'absurdité de la condition humaine (les marins de Galice que la mer enlève...), sans jamais s'y perdre, et en tire une fable forte et poignante...
Le narrateur, nain, laid et bossu, vit rejeté de tous, quelque part en Galice, dans ce pays de brumes et de pluie. Jusqu'au jour où il découvre la guitare, qui va changer sa vie. Un des premiers livres de Michel del Castillo, écrit en 1957 ; son écriture, sèche et précise, s'empare de toute une série de thèmes pourtant éculés : la laideur extrême, l'envie d'être aimé, le rejet de l'autre, l'absurdité de la condition humaine (les marins de Galice que la mer enlève...), sans jamais s'y perdre, et en tire une fable forte et poignante...
(trouvé chez Joseph Gibert : 0,20 €en collection Presses pocket)
11:55 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Del Castillo, guitare, critique


















