jeudi, 07 mai 2020
Mémoires d'outre-tombe (Chateaubriand)
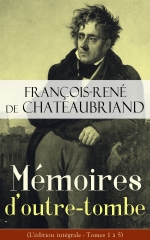 Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. »
Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. » 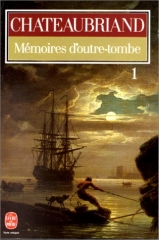 Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»
Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»  Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »
Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »
Raymond Alcovère
02:09 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, mémoires d'outre-tombe
mercredi, 06 mai 2020
Discours de Suède (Albert Camus)
 Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.
Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.  Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »
Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »
Raymond Alcovère
00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, discours de suède
mardi, 05 mai 2020
Le Temps retrouvé (Marcel Proust)
 La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;
La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;  parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. »
parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. » Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»
Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»
Raymond Alcovère
00:07 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, a la recherche du tems perdu, le temps retrouvé
lundi, 04 mai 2020
Les Trois Mousquetaires (Alexandre Dumas)
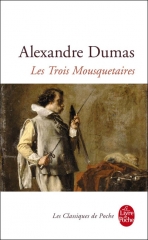
Les Trois Mousquetaires est le livre idéal pour fuir notre époque artificielle : bain de jouvence garanti. L’esprit français dans ce qu’il a de meilleur : fronde, énergie, humour et générosité. Quelle merveilleuse trouvaille que ces trois qui font quatre ; Aramis hésite sans cesse entre le sabre et le goupillon, et les aventures galantes et finalement choisit les trois « c’était un homme, comme on a déjà pu s’en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne » ; Porthos, cet Obélix avant la lettre et Athos, noble, taiseux, énigmatique ; on comprend vite qu’une blessure profonde le taraude à jamais ; voilà ce qui lui confère ce détachement et ce charme si particulier ; la vie lui importe peu, il est prêt à tous les risques, toutes les aventures, et surtout pour défendre ou aider ses amis. D’Artagnan a cette répartie magnifique à son propos : « Vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. » D’Artagnan lui (l’étroit mousquetaire ?), fier, bête et rusé en même temps, c’est la jeunesse éternelle ; son sens du devoir et sa fougue lui font le plus souvent oublier mesure et raison, mais avec lui on ne s’ennuie jamais et c’est l’essentiel ! Et il y a l’étonnant Tréville : « Avec un rare génie d'intrigue, qui le rendait l'égal des plus forts intrigants, il était resté honnête homme. » (tout est politique n’est-ce pas ?) Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »
Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »
Raymond Alcovère
00:04 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre dumas, les trois mousquetaires
dimanche, 03 mai 2020
Le vieil homme et la mer (Hemingway)
 Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »
Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »  Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».
Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».
Raymond Alcovère
01:24 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway
samedi, 02 mai 2020
Le Chancellor (Jules Verne)
 Prodigieux ; Verne n’a visité pratiquement aucun des lieux qu’il décrit, utilisant atlas, récits de voyage et manuels de géographie. Ensuite, le succès venant, il a pu voyager, mais dès les premiers Voyages Extraordinaires, on y est, les descriptions sont parfaites, le style rythmé, précis, varié, vif, et le vocabulaire d'une extrême richesse. Son œuvre, pour qui aime les mots, est un fabuleux dictionnaire. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre, on le sent dans sa façon de construire ses intrigues, développer sa narration, il ménage toujours effets de surprise et coups de théâtre. Verne est un enchanteur. Il a créé des personnages hors du commun, inoubliables, comme Phileas Fogg dans le fabuleux Tour du monde en 80 jours – dont J.M.G. Le Clézio dit « qu’il part parce qu’il a fait un pari contre lui-même » – des aventuriers fous mais si puissants, si justes, si vrais finalement comme le capitaine Nemo et sa fameuse devise : Mobilis in mobile (petite erreur rectifiée ensuite, il fallait écrire Mobilis in mobili, mais la première formule, plus musicale, est restée) qui est la base de toute stratégie. Outre ces archétypes, on trouve dans son œuvre des pépites méconnues, comme Le Chancellor. Atypique dans son œuvre, très noir. Il se présente comme le journal de bord d’un passager ordinaire pour une traversée banale. Au départ d’un cargo qui transporte des passagers entre l’Amérique et la France. Mais bien vite, c’est le cauchemar. Les catastrophes s’accumulent, un groupe de survivants se retrouve sur un radeau (réminiscence sans doute de l’épisode du Radeau de la Méduse qui marqua les esprits en 1816, à cause notamment du tableau de Géricault). Toute la fin du roman repose sur la question : peut-on, doit-on manger de la chair humaine pour survivre ? Verne l’aborde de front, sans sentimentalisme. Les personnages sonnent juste. On est sur ce radeau. Le suspense est bien mené et si l’on retrouve certains des défauts de Verne (personnages parfois un peu sommaires, taillés à la hache), Le Chancellor montre la diversité d’inspiration d’une œuvre dont on n’a pas sans doute encore découvert tous les aspects. Son point faible, c’est l’amour – là il est très XIXe – ses personnages manquent de chair.
Prodigieux ; Verne n’a visité pratiquement aucun des lieux qu’il décrit, utilisant atlas, récits de voyage et manuels de géographie. Ensuite, le succès venant, il a pu voyager, mais dès les premiers Voyages Extraordinaires, on y est, les descriptions sont parfaites, le style rythmé, précis, varié, vif, et le vocabulaire d'une extrême richesse. Son œuvre, pour qui aime les mots, est un fabuleux dictionnaire. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre, on le sent dans sa façon de construire ses intrigues, développer sa narration, il ménage toujours effets de surprise et coups de théâtre. Verne est un enchanteur. Il a créé des personnages hors du commun, inoubliables, comme Phileas Fogg dans le fabuleux Tour du monde en 80 jours – dont J.M.G. Le Clézio dit « qu’il part parce qu’il a fait un pari contre lui-même » – des aventuriers fous mais si puissants, si justes, si vrais finalement comme le capitaine Nemo et sa fameuse devise : Mobilis in mobile (petite erreur rectifiée ensuite, il fallait écrire Mobilis in mobili, mais la première formule, plus musicale, est restée) qui est la base de toute stratégie. Outre ces archétypes, on trouve dans son œuvre des pépites méconnues, comme Le Chancellor. Atypique dans son œuvre, très noir. Il se présente comme le journal de bord d’un passager ordinaire pour une traversée banale. Au départ d’un cargo qui transporte des passagers entre l’Amérique et la France. Mais bien vite, c’est le cauchemar. Les catastrophes s’accumulent, un groupe de survivants se retrouve sur un radeau (réminiscence sans doute de l’épisode du Radeau de la Méduse qui marqua les esprits en 1816, à cause notamment du tableau de Géricault). Toute la fin du roman repose sur la question : peut-on, doit-on manger de la chair humaine pour survivre ? Verne l’aborde de front, sans sentimentalisme. Les personnages sonnent juste. On est sur ce radeau. Le suspense est bien mené et si l’on retrouve certains des défauts de Verne (personnages parfois un peu sommaires, taillés à la hache), Le Chancellor montre la diversité d’inspiration d’une œuvre dont on n’a pas sans doute encore découvert tous les aspects. Son point faible, c’est l’amour – là il est très XIXe – ses personnages manquent de chair. Son humour le porte parfois au sublime, comme cette réflexion de Pencroff dans l’île mystérieuse : « Pourquoi serions-nous malades, puisqu’il n’y a pas de médecins dans l’île ? » Certes, l’analyse de Barthes dans Mythologies est judicieuse : « Verne appartient à la lignée progressiste de la bourgeoisie : son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l’homme, que le monde, même le plus lointain, est comme un objet dans sa main (…) Le geste profond de Jules Verne, c’est donc, incontestablement, l’appropriation. L’image du bateau, si importante dans la mythologie de Verne, ne le contredit nullement, bien au contraire : le bateau peut bien être symbole du départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement, de tenir sous sa main le plus grand nombre possible d’objets. De disposer d’un espace absolument fini : aimer les navires, c’est d’abord aimer une maison superlative parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues ; le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport. Or tous les bateaux de Jules Verne sont bien des coins du feu parfaits, et l’énormité de leur périple ajoute encore au bonheur de leur clôture, à la perfection de leur humanité intérieure. Le Nautilus est à cet égard la caverne adorable : la jouissance de l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, au sein de cette intériorité sans fissure, il est possible de voir par une grande vitre le vague extérieur des eaux, et de définir ainsi dans un même geste l’intérieur par son contraire (…) L’imagination du voyage correspond chez Verne à une exploration de la clôture, et l’accord de Verne et de l’enfance ne vient pas d’une mystique banale de l’aventure, mais au contraire d’un bonheur commun du fini, que l’on retrouve dans la passion enfantine des cabanes et des tentes : s’enclore et s’installer, tel est le rêve existentiel de l’enfance et de Verne. L’archétype de ce rêve est ce roman presque parfait : L’Île mystérieuse, où l’homme-enfant réinvente le monde, l’emplit, l’enclot, s’y enferme, et couronne cet effort encyclopédique par la posture bourgeoise de l’appropriation : pantoufles, pipe et coin du feu, pendant que dehors la tempête, c’est-à-dire l’infini, fait rage inutilement. » Mais on aurait tort de le résumer à cette analyse.
Son humour le porte parfois au sublime, comme cette réflexion de Pencroff dans l’île mystérieuse : « Pourquoi serions-nous malades, puisqu’il n’y a pas de médecins dans l’île ? » Certes, l’analyse de Barthes dans Mythologies est judicieuse : « Verne appartient à la lignée progressiste de la bourgeoisie : son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l’homme, que le monde, même le plus lointain, est comme un objet dans sa main (…) Le geste profond de Jules Verne, c’est donc, incontestablement, l’appropriation. L’image du bateau, si importante dans la mythologie de Verne, ne le contredit nullement, bien au contraire : le bateau peut bien être symbole du départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement, de tenir sous sa main le plus grand nombre possible d’objets. De disposer d’un espace absolument fini : aimer les navires, c’est d’abord aimer une maison superlative parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues ; le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport. Or tous les bateaux de Jules Verne sont bien des coins du feu parfaits, et l’énormité de leur périple ajoute encore au bonheur de leur clôture, à la perfection de leur humanité intérieure. Le Nautilus est à cet égard la caverne adorable : la jouissance de l’enfermement atteint son paroxysme lorsque, au sein de cette intériorité sans fissure, il est possible de voir par une grande vitre le vague extérieur des eaux, et de définir ainsi dans un même geste l’intérieur par son contraire (…) L’imagination du voyage correspond chez Verne à une exploration de la clôture, et l’accord de Verne et de l’enfance ne vient pas d’une mystique banale de l’aventure, mais au contraire d’un bonheur commun du fini, que l’on retrouve dans la passion enfantine des cabanes et des tentes : s’enclore et s’installer, tel est le rêve existentiel de l’enfance et de Verne. L’archétype de ce rêve est ce roman presque parfait : L’Île mystérieuse, où l’homme-enfant réinvente le monde, l’emplit, l’enclot, s’y enferme, et couronne cet effort encyclopédique par la posture bourgeoise de l’appropriation : pantoufles, pipe et coin du feu, pendant que dehors la tempête, c’est-à-dire l’infini, fait rage inutilement. » Mais on aurait tort de le résumer à cette analyse.  Pour J.M.G. Le Clézio, « Ses romans sont des livres de héros plus que d’aventures technique. » « Et en plus, ce qui séduit les enfants qui ne s’intéressent pas au style, mais qui cherchent une pâture pour leur imagination, c’est cette véracité de ton qui vient de ce que Jules Verne vivait ses aventures en les écrivant. » Et pourtant, précise-t-il plus loin : « Je me souviens qu’enfant je reconnaissais les phrases de Jules Verne. C’est là que j’ai senti pour la première fois ce qu’est le style. » Et : « Mais le génie de Verne c’est de donner à la fois une description du monde étonnante et une réduction des grands drames de l’humanité en symboles tels qu’ils peuvent déjà être sentis par un enfant. » Michel Foucault, dans un numéro de l’Arc (1966) pointe un aspect très particulier la construction de ses récits : « Les récits de Jules Verne sont merveilleusement pleins de ces discontinuités dans le mode de la fiction. Sans cesse le rapport établi entre narrateur, discours et fable se dénoue et se reconstitue selon un nouveau dessin. Le texte qui raconte, à chaque instant se rompt ; il change de signe, s’inverse, prend distance, vient d’ailleurs comme d’une autre voix. Des parleurs, surgis on ne sait d’où, s’introduisent, font taire ceux qui le précédaient, tiennent un instant leur discours propre, et puis soudain, cèdent la parole à un autre de ces visages anonymes, de ces silhouettes grises. » On pourrait multiplier les exemples : « Ce soir, un étranger qui se fût trouvé à Baltimore n’eût pas obtenu, même à prix d’or de pénétrer dans la grande salle. » Ou : « On s’étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons si peu soucieux de l’avenir… » Exemple de son style sec et précis, sans sentimentalisme : « Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n’était pas dit. Un combat terrible s’engagea. » Selon Claude Santelli, il est le plus grand et le seul romancier épique français.
Pour J.M.G. Le Clézio, « Ses romans sont des livres de héros plus que d’aventures technique. » « Et en plus, ce qui séduit les enfants qui ne s’intéressent pas au style, mais qui cherchent une pâture pour leur imagination, c’est cette véracité de ton qui vient de ce que Jules Verne vivait ses aventures en les écrivant. » Et pourtant, précise-t-il plus loin : « Je me souviens qu’enfant je reconnaissais les phrases de Jules Verne. C’est là que j’ai senti pour la première fois ce qu’est le style. » Et : « Mais le génie de Verne c’est de donner à la fois une description du monde étonnante et une réduction des grands drames de l’humanité en symboles tels qu’ils peuvent déjà être sentis par un enfant. » Michel Foucault, dans un numéro de l’Arc (1966) pointe un aspect très particulier la construction de ses récits : « Les récits de Jules Verne sont merveilleusement pleins de ces discontinuités dans le mode de la fiction. Sans cesse le rapport établi entre narrateur, discours et fable se dénoue et se reconstitue selon un nouveau dessin. Le texte qui raconte, à chaque instant se rompt ; il change de signe, s’inverse, prend distance, vient d’ailleurs comme d’une autre voix. Des parleurs, surgis on ne sait d’où, s’introduisent, font taire ceux qui le précédaient, tiennent un instant leur discours propre, et puis soudain, cèdent la parole à un autre de ces visages anonymes, de ces silhouettes grises. » On pourrait multiplier les exemples : « Ce soir, un étranger qui se fût trouvé à Baltimore n’eût pas obtenu, même à prix d’or de pénétrer dans la grande salle. » Ou : « On s’étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons si peu soucieux de l’avenir… » Exemple de son style sec et précis, sans sentimentalisme : « Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n’était pas dit. Un combat terrible s’engagea. » Selon Claude Santelli, il est le plus grand et le seul romancier épique français.
Raymond Alcovère
02:09 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules verne, le chancellor
vendredi, 01 mai 2020
Madame Bovary (Gustave Flaubert)
 Il est géant, à tous points de vue, et double : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit. » D’une intelligence prodigieuse : « Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. » « Il y a de par le monde une conjuration générale contre deux choses, à savoir la poésie et la liberté. » Sa Correspondance témoigne de sa lucidité, de son désenchantement. Et puis il y a ces fameuses leçons de littérature, qui ont hanté des générations d’écrivains : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet, ou du moins le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. » Il est un de ceux qui a le mieux parlé de l’écriture, un de ceux qui l’a vécue le plus intensément, qui est allé au bout de quelque chose. Lettre à Louise Colet, du 1er février 1852 : « Je suis un homme-plume. Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Le 23 décembre 1853 : « N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! Que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entrefermer leurs paupières noyées d'amour.»
Il est géant, à tous points de vue, et double : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit. » D’une intelligence prodigieuse : « Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. » « Il y a de par le monde une conjuration générale contre deux choses, à savoir la poésie et la liberté. » Sa Correspondance témoigne de sa lucidité, de son désenchantement. Et puis il y a ces fameuses leçons de littérature, qui ont hanté des générations d’écrivains : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet, ou du moins le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. » Il est un de ceux qui a le mieux parlé de l’écriture, un de ceux qui l’a vécue le plus intensément, qui est allé au bout de quelque chose. Lettre à Louise Colet, du 1er février 1852 : « Je suis un homme-plume. Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Le 23 décembre 1853 : « N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! Que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entrefermer leurs paupières noyées d'amour.»  Quelques mois plus tôt (le 26 août 1853) : « Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! » Madame Bovary est un roman parfait (trop ?), merveilleusement équilibré. Charles Dantzig : « À mon sens le seul chef-d’œuvre construit de tous les chefs-d’œuvre. » En effet, la plupart des chefs-d’œuvre sont souvent brouillons, brinquebalants ; pas celui-ci. Et puis, scandale ; le procureur Pinard (qui deviendra ensuite ministre de l’Intérieur) ne parviendra pas à le faire condamner malgré un réquisitoire de une heure trente (il se rattrapera peu après avec Baudelaire). Flaubert avait bien raison de dire : « Je crois à la haine inconsciente du style. » En effet : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. » ou encore : « Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber tous ses vêtements ; – et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine avec un long frisson. » Et aussi : « Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne... Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée ? » Ou : « L’église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d’elle les voûtes s’inclinaient pour recueillir dans l’ombre la confession de son amour ; les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu’elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. »
Quelques mois plus tôt (le 26 août 1853) : « Ce qui me semble à moi, le plus haut dans l’Art (et le plus difficile), ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles. Quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’Océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m’apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures on aperçoit des précipices ; il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant quelque chose de singulièrement doux plane sur l’ensemble ! C’est l’éclat de la lumière, le sourire du soleil, et c’est calme ! C’est calme ! » Madame Bovary est un roman parfait (trop ?), merveilleusement équilibré. Charles Dantzig : « À mon sens le seul chef-d’œuvre construit de tous les chefs-d’œuvre. » En effet, la plupart des chefs-d’œuvre sont souvent brouillons, brinquebalants ; pas celui-ci. Et puis, scandale ; le procureur Pinard (qui deviendra ensuite ministre de l’Intérieur) ne parviendra pas à le faire condamner malgré un réquisitoire de une heure trente (il se rattrapera peu après avec Baudelaire). Flaubert avait bien raison de dire : « Je crois à la haine inconsciente du style. » En effet : « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. » ou encore : « Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber tous ses vêtements ; – et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine avec un long frisson. » Et aussi : « Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne... Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée ? » Ou : « L’église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d’elle les voûtes s’inclinaient pour recueillir dans l’ombre la confession de son amour ; les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu’elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. » 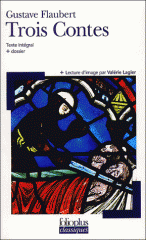 Dans une lettre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, du 18 mars 1857, ceci : « Avec une lectrice telle que vous, Madame, et aussi sympathique, la franchise est un devoir. Je vais donc répondre à vos questions : Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée ; je n'y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. L'illusion (s'il y en a une) vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voie pas. Et puis, l'Art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques ! La difficulté capitale, pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon. »
Dans une lettre de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, du 18 mars 1857, ceci : « Avec une lectrice telle que vous, Madame, et aussi sympathique, la franchise est un devoir. Je vais donc répondre à vos questions : Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée ; je n'y ai rien mis ni de mes sentiments ni de mon existence. L'illusion (s'il y en a une) vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voie pas. Et puis, l'Art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques ! La difficulté capitale, pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le Beau indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait Platon. »  L’Éducation sentimentale me semble plus faible ; trop de longueurs, cette histoire d’amour est lassante ; Proust était fasciné par ceci : « À mon avis, la chose la plus belle de L’Éducation sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc. Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal : » Ici, un blanc, un énorme blanc et, sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades ; je reprends les derniers mots que j’ai cités pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il revint. » Flaubert a-t-il été traumatisé par le procureur Pinard ?
L’Éducation sentimentale me semble plus faible ; trop de longueurs, cette histoire d’amour est lassante ; Proust était fasciné par ceci : « À mon avis, la chose la plus belle de L’Éducation sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc. Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal : » Ici, un blanc, un énorme blanc et, sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades ; je reprends les derniers mots que j’ai cités pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse : « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il revint. » Flaubert a-t-il été traumatisé par le procureur Pinard ?  Salammbô (souvent éreinté comme par Roberto Calasso : « Ah l’étincelant naufrage de Salammbô ») est fascinant, notamment la fantastique scène initiale du festin. Les Trois comtes sont une de ses grandes réussites, Hérodias en particulier ; manifestement l’Orient a bien inspiré le Maître. On trouve, en appendice à Bouvard et Pécuchet, le délicieux Dictionnaire des idées reçues. Sous-titré : Le catalogue des opinions chic. Exemples : « Littérature : Occupation des oisifs. Lion : Est généreux – Joue toujours avec une boule. Avocats : ont le jugement faussé à force de plaider le pour et le contre. Échafaud : S'arranger quand on y monte pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. Exception : Dites qu'elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment. Génie : inutile de l'admirer c'est une névrose ! » Flaubert avait souvent la dent dure ; à propos de Thiers, toujours dans sa Correspondance, à George Sand : « Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croûtard plus abject, un plus étroniforme bourgeois ! Non rien ne peut donner l’idée du vomissement que m’inspire ce vieux melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la bourgeoisie !… Il me semble éternel comme la médiocrité ! » Misanthrope aussi ; à George Sand : « Ah comme je suis las de l’ignoble ouvrier, de l’inepte bourgeois, du stupide paysan et de l’odieux ecclésiastique ! C’est pourquoi je me perds, tant que je peux, dans l’Antiquité. Actuellement, je fais parler tous ses dieux, à l’état d’agonie. » Il se plaignait beaucoup, de son époque, des autres : « J’ai le don d’ahurir la critique. La bêtise humaine, actuellement, m’écrase si fort que je me fais l’effet d’une mouche portant sur son dos l’Himalaya. »
Salammbô (souvent éreinté comme par Roberto Calasso : « Ah l’étincelant naufrage de Salammbô ») est fascinant, notamment la fantastique scène initiale du festin. Les Trois comtes sont une de ses grandes réussites, Hérodias en particulier ; manifestement l’Orient a bien inspiré le Maître. On trouve, en appendice à Bouvard et Pécuchet, le délicieux Dictionnaire des idées reçues. Sous-titré : Le catalogue des opinions chic. Exemples : « Littérature : Occupation des oisifs. Lion : Est généreux – Joue toujours avec une boule. Avocats : ont le jugement faussé à force de plaider le pour et le contre. Échafaud : S'arranger quand on y monte pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. Exception : Dites qu'elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment. Génie : inutile de l'admirer c'est une névrose ! » Flaubert avait souvent la dent dure ; à propos de Thiers, toujours dans sa Correspondance, à George Sand : « Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croûtard plus abject, un plus étroniforme bourgeois ! Non rien ne peut donner l’idée du vomissement que m’inspire ce vieux melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la bourgeoisie !… Il me semble éternel comme la médiocrité ! » Misanthrope aussi ; à George Sand : « Ah comme je suis las de l’ignoble ouvrier, de l’inepte bourgeois, du stupide paysan et de l’odieux ecclésiastique ! C’est pourquoi je me perds, tant que je peux, dans l’Antiquité. Actuellement, je fais parler tous ses dieux, à l’état d’agonie. » Il se plaignait beaucoup, de son époque, des autres : « J’ai le don d’ahurir la critique. La bêtise humaine, actuellement, m’écrase si fort que je me fais l’effet d’une mouche portant sur son dos l’Himalaya. » « Pour moi, voilà le principe : on a toujours affaire à des canailles. On est toujours trompé, dupé, calomnié, bafoué. Mais il faut s’y attendre. Et quand l’exception se présente, remercier le ciel. » Il y a ce mot terrible et assez juste de Jules Renard dans son Journal : « L’œuvre de Flaubert sent un peu l’ennui. » Il a écrit lui-même dans Madame Bovary : « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. »
« Pour moi, voilà le principe : on a toujours affaire à des canailles. On est toujours trompé, dupé, calomnié, bafoué. Mais il faut s’y attendre. Et quand l’exception se présente, remercier le ciel. » Il y a ce mot terrible et assez juste de Jules Renard dans son Journal : « L’œuvre de Flaubert sent un peu l’ennui. » Il a écrit lui-même dans Madame Bovary : « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. »
Raymond Alcovère
10:21 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : madame bovary, gustave flaubert
Le Rouge et le Noir (Stendhal)
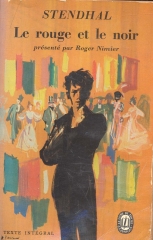 « Je regarde et j'ai toujours regardé mes ouvrages comme des billets de loterie » a-t-il écrit. Gagné ! Il est sans doute le plus paradoxal des écrivains, et par là le plus écrivain des écrivains. Sa vie – et son œuvre, elles sont semblables et à ce point-là aussi c’est rare – est pleine de détours, de mystères et de fulgurances. « Nous tenons la plume d’un côté et l’épée de l’autre. » Mérimée, son ami a écrit : « Personne n’a jamais su exactement quels gens il voyait, quels livres il avait écrit, quels voyages il avait fait. » Philippe Sollers note : « Stendhal est très renseigné sur l’argent et la politique. Il a manié plus d’affaires qu’on ne croit. » Vivacité, intelligence, audace, il résume l’esprit français, lui qui aimait par-dessus tout l’Italie, mais il y a plus que des liens entre ces deux pays. « Pas un mot qui s’endorme », écrit Roger Nimier dans sa préface à Le Rouge et le Noir. Et en effet : « Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. » Ou encore : « Après une conversation savante de deux grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l’emporta sur la finesse de l’homme riche, qui n’en a pas besoin pour vivre. » « Je suis petit, Madame, mais je ne suis pas bas. » « Si vous songez à faire la cour aux hommes qui ont la puissance, votre perte éternelle est assurée. » « Rien n'était laid comme cet homme important, ayant de l'humeur et croyant pouvoir la montrer. » Claude Roy remarque dans son Stendhal par lui-même, que « Un roman de Stendhal est écrit à l’inverse de la façon dont écrivaient neuf sur dix des grands romanciers qui l’ont précédé. Le récit progresse autant par ce qui est dit que par ce qui est escamoté. Il y a deux romans dans Le Rouge et le Noir, le roman des faits imprimés et le roman des faits éludés qui ont une égale importance. On pourrait écrire une autre version de l’histoire de Julien Sorel, qui se situerait tout entière dans les blancs du récit. On imagine un autre écrivain ayant à raconter la première nuit que passe Julien avec Mathilde. Tout ce qu’il aurait à dire, Stendhal l’a mis dans un point-virgule : « La vertu de Julien fut égale à son bonheur ; il faut que je descende par l’échelle, dit-il à Mathilde quand il vit l’aube du jour paraître… » Un point-virgule nous rend compte, et lui seul, d’une nuit entière, de deux amants dans les bras l’un de l’autre, de leurs transports, de leurs propos dans l’amour, de leur plaisir, etc. Ailleurs, dans Vanina Vanini, tout se conclut en une scène de deux minutes contée en trois pages de dialogue. Puis, deux lignes : « Vanina resta anéantie. Elle revint à Rome ; et le journal annonce qu’elle vient d’épouser le prince Savelli. » La vie de Stendhal a été romanesque.
« Je regarde et j'ai toujours regardé mes ouvrages comme des billets de loterie » a-t-il écrit. Gagné ! Il est sans doute le plus paradoxal des écrivains, et par là le plus écrivain des écrivains. Sa vie – et son œuvre, elles sont semblables et à ce point-là aussi c’est rare – est pleine de détours, de mystères et de fulgurances. « Nous tenons la plume d’un côté et l’épée de l’autre. » Mérimée, son ami a écrit : « Personne n’a jamais su exactement quels gens il voyait, quels livres il avait écrit, quels voyages il avait fait. » Philippe Sollers note : « Stendhal est très renseigné sur l’argent et la politique. Il a manié plus d’affaires qu’on ne croit. » Vivacité, intelligence, audace, il résume l’esprit français, lui qui aimait par-dessus tout l’Italie, mais il y a plus que des liens entre ces deux pays. « Pas un mot qui s’endorme », écrit Roger Nimier dans sa préface à Le Rouge et le Noir. Et en effet : « Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. » Ou encore : « Après une conversation savante de deux grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l’emporta sur la finesse de l’homme riche, qui n’en a pas besoin pour vivre. » « Je suis petit, Madame, mais je ne suis pas bas. » « Si vous songez à faire la cour aux hommes qui ont la puissance, votre perte éternelle est assurée. » « Rien n'était laid comme cet homme important, ayant de l'humeur et croyant pouvoir la montrer. » Claude Roy remarque dans son Stendhal par lui-même, que « Un roman de Stendhal est écrit à l’inverse de la façon dont écrivaient neuf sur dix des grands romanciers qui l’ont précédé. Le récit progresse autant par ce qui est dit que par ce qui est escamoté. Il y a deux romans dans Le Rouge et le Noir, le roman des faits imprimés et le roman des faits éludés qui ont une égale importance. On pourrait écrire une autre version de l’histoire de Julien Sorel, qui se situerait tout entière dans les blancs du récit. On imagine un autre écrivain ayant à raconter la première nuit que passe Julien avec Mathilde. Tout ce qu’il aurait à dire, Stendhal l’a mis dans un point-virgule : « La vertu de Julien fut égale à son bonheur ; il faut que je descende par l’échelle, dit-il à Mathilde quand il vit l’aube du jour paraître… » Un point-virgule nous rend compte, et lui seul, d’une nuit entière, de deux amants dans les bras l’un de l’autre, de leurs transports, de leurs propos dans l’amour, de leur plaisir, etc. Ailleurs, dans Vanina Vanini, tout se conclut en une scène de deux minutes contée en trois pages de dialogue. Puis, deux lignes : « Vanina resta anéantie. Elle revint à Rome ; et le journal annonce qu’elle vient d’épouser le prince Savelli. » La vie de Stendhal a été romanesque.
 Il écrit avec une vitesse hallucinante : Souvenirs d’égotisme, en 3 semaines (270 pages), La Chartreuse, en 53 jours. Personne n’a écrit aussi vite sa pensée : « Ce n’est point par égotisme que je dis je, c’est qu’il n’y a pas d’autre moyen de raconter vite. » Dans Souvenirs d’égotisme : « J’abhorre la description matérielle. L’ennui de la faire m’empêche de faire des romans. » Il changera d’avis et naîtront des chefs-d’œuvre. Ses romans seront en effet, sur ce point, à l’opposé de ceux de Balzac par exemple (lequel sera néanmoins un des seuls à reconnaître son talent). Souvenirs d’égotisme est peut-être la quintessence de Stendhal, il s’y livre vraiment : « Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels Je que l’auteur va écrire, c’est une parfaite sincérité. » Et ces Souvenirs se terminent par un véritable feu d’artifice, un des textes les plus étonnants jamais écrits : Les Privilèges. Comme l’a noté Philippe Sollers, à propos de son exergue de Trésor d’amour, consacré à Stendhal : « L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule.» : On a l’impression avec lui d’une improvisation permanente, que sa pensée va plus vite que son écriture, il éprouve le besoin de se corriger. » Un paradoxe de plus avec Stendhal, lui qui a connu tant d’échecs amoureux, fait parler les femmes comme personne : ici c’est Gina : « Le comte Mosca a du génie, tout le monde le dit, et je le crois, de plus il est mon amant. Mais quand je suis avec Fabrice et que rien ne le contrarie, qu’il peut me dire tout ce qu’il pense, je n’ai plus de jugement, je n’ai plus la conscience du moi humain pour porter un jugement de son mérite, je suis dans le ciel avec lui, et quand il me quitte, je suis morte de fatigue et incapable de tout, excepté de me dire : c’est un Dieu pour moi, et il n’est qu’ami. » Sollers continue : « Stendhal a été malheureux, repoussé, trompé, écarté à cause de sa « sensibilité folle, de son âme sensible jusqu’à l’anéantissement et à la folie » mais il ne s’est jamais résigné, il a maintenu que l’amour devait exister, sinon tout serait d’un ennui mortel. » Il se trouvait laid : « Cette tête de boucher italien. » Et il fut souvent victime de fiascos. Il n’aimait pas beaucoup la France : « Malgré les malheurs de mon ambition, je ne crois point les hommes méchants ; je les regarde comme des machines poussées, en France, par la vanité et, ailleurs, par toutes les passions, la vanité comprise. » Stendhal parle aussi beaucoup de politique : « La politique dans une œuvre littéraire, c’est un coup de pistolet au milieu d’un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n’est pas possible de refuser son attention. Nous allons parler de fort vilaines choses. » Ou « Les peuples n’ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur. »
Il écrit avec une vitesse hallucinante : Souvenirs d’égotisme, en 3 semaines (270 pages), La Chartreuse, en 53 jours. Personne n’a écrit aussi vite sa pensée : « Ce n’est point par égotisme que je dis je, c’est qu’il n’y a pas d’autre moyen de raconter vite. » Dans Souvenirs d’égotisme : « J’abhorre la description matérielle. L’ennui de la faire m’empêche de faire des romans. » Il changera d’avis et naîtront des chefs-d’œuvre. Ses romans seront en effet, sur ce point, à l’opposé de ceux de Balzac par exemple (lequel sera néanmoins un des seuls à reconnaître son talent). Souvenirs d’égotisme est peut-être la quintessence de Stendhal, il s’y livre vraiment : « Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels Je que l’auteur va écrire, c’est une parfaite sincérité. » Et ces Souvenirs se terminent par un véritable feu d’artifice, un des textes les plus étonnants jamais écrits : Les Privilèges. Comme l’a noté Philippe Sollers, à propos de son exergue de Trésor d’amour, consacré à Stendhal : « L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule.» : On a l’impression avec lui d’une improvisation permanente, que sa pensée va plus vite que son écriture, il éprouve le besoin de se corriger. » Un paradoxe de plus avec Stendhal, lui qui a connu tant d’échecs amoureux, fait parler les femmes comme personne : ici c’est Gina : « Le comte Mosca a du génie, tout le monde le dit, et je le crois, de plus il est mon amant. Mais quand je suis avec Fabrice et que rien ne le contrarie, qu’il peut me dire tout ce qu’il pense, je n’ai plus de jugement, je n’ai plus la conscience du moi humain pour porter un jugement de son mérite, je suis dans le ciel avec lui, et quand il me quitte, je suis morte de fatigue et incapable de tout, excepté de me dire : c’est un Dieu pour moi, et il n’est qu’ami. » Sollers continue : « Stendhal a été malheureux, repoussé, trompé, écarté à cause de sa « sensibilité folle, de son âme sensible jusqu’à l’anéantissement et à la folie » mais il ne s’est jamais résigné, il a maintenu que l’amour devait exister, sinon tout serait d’un ennui mortel. » Il se trouvait laid : « Cette tête de boucher italien. » Et il fut souvent victime de fiascos. Il n’aimait pas beaucoup la France : « Malgré les malheurs de mon ambition, je ne crois point les hommes méchants ; je les regarde comme des machines poussées, en France, par la vanité et, ailleurs, par toutes les passions, la vanité comprise. » Stendhal parle aussi beaucoup de politique : « La politique dans une œuvre littéraire, c’est un coup de pistolet au milieu d’un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n’est pas possible de refuser son attention. Nous allons parler de fort vilaines choses. » Ou « Les peuples n’ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur. »  Quel que soit le sujet qu’il aborde, il est vif, virevoltant, pénétrant. La magie surgit en le lisant dans cette impression de vérité et de liberté. « Son style dont il dit lui-même qu’il est horriblement difficile à imiter car il n’est qu’une suite de nuances vraies. Il ne vit d’autre chose que d’une suite de nuances vraies. » : Philippe Sollers. Il est en effet et un des seuls dans ce cas, impossible à imiter. Son écriture virevolte et pétille sans cesse. D’où l’ennui qu’il éprouvait en société : « Le grand drawback (inconvénient) d’avoir de l’esprit c’est qu’il faut avoir l’œil fixé sur les demi-sots qui vous entourent, et se pénétrer de leurs plates sensations. » Vide qu’il a comblé avec l’art, la peinture, la musique et l’écriture. Mais pas seulement : « J’aimais et j’aime encore les mathématiques pour elles-mêmes, comme n’admettant pas l’hypocrisie et le vague, mes deux bêtes d’aversion. » « En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil, afin d’être toujours naturel. » Il savait qu’il serait lu et compris plus tard (il l’a écrit) et se moquait de l’avis de ses contemporains : « Tout bon raisonnement offense. » Michel Crouzet, un des meilleurs spécialistes de Stendhal, a eu cette phrase merveilleuse, à son propos : « L’esprit est un luxe spirituel, une grâce, et cette grâce c’est la gaieté ». Claude Roy dans son Stendhal par lui-même écrit : « La perfection de Le Rouge et le Noir et de La Chartreuse de Parme me semble cependant démontrable. Ces deux ouvrages, par leurs données, les caractères qui y sont présentés, la construction des intrigues qui s’y développent, le charme de leurs descriptions, la curiosité et la bonté que l’auteur y exerce, l’intelligence qu’il y manifeste, ont ce caractère de nécessité qui rend parfaitement heureux, – propre aux véritables chefs-d’œuvre (...) La prose de Stendhal n’est jamais une draperie posée sur un quelconque contenu, elle est le contenu même de sa pensée, un mouvement qui nous est transmis sans aucune déperdition d’énergie. » Énergie, un des mots les plus chers à Stendhal : « Je ne conçois pas un homme sans un peu de mâle énergie, de constance et de profondeur dans les idées. » Intelligence et vision de l’avenir aussi : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation : elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. » Sa célèbre épitaphe : « Visse, scrisse, amò : il a vécu, il a écrit, il a aimé. » que Sollers commente ainsi : « Il y a la vie, l’écriture, l’amour. Ou encore : l’amour naît de la vie qui s’écrit. » Parmi ses devises, celle-ci : « Intelligenti pauca. » : Peu de mots suffisent à ceux qui comprennent. Et « Songez à ne passer votre vie à haïr et à avoir peur. »
Quel que soit le sujet qu’il aborde, il est vif, virevoltant, pénétrant. La magie surgit en le lisant dans cette impression de vérité et de liberté. « Son style dont il dit lui-même qu’il est horriblement difficile à imiter car il n’est qu’une suite de nuances vraies. Il ne vit d’autre chose que d’une suite de nuances vraies. » : Philippe Sollers. Il est en effet et un des seuls dans ce cas, impossible à imiter. Son écriture virevolte et pétille sans cesse. D’où l’ennui qu’il éprouvait en société : « Le grand drawback (inconvénient) d’avoir de l’esprit c’est qu’il faut avoir l’œil fixé sur les demi-sots qui vous entourent, et se pénétrer de leurs plates sensations. » Vide qu’il a comblé avec l’art, la peinture, la musique et l’écriture. Mais pas seulement : « J’aimais et j’aime encore les mathématiques pour elles-mêmes, comme n’admettant pas l’hypocrisie et le vague, mes deux bêtes d’aversion. » « En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil, afin d’être toujours naturel. » Il savait qu’il serait lu et compris plus tard (il l’a écrit) et se moquait de l’avis de ses contemporains : « Tout bon raisonnement offense. » Michel Crouzet, un des meilleurs spécialistes de Stendhal, a eu cette phrase merveilleuse, à son propos : « L’esprit est un luxe spirituel, une grâce, et cette grâce c’est la gaieté ». Claude Roy dans son Stendhal par lui-même écrit : « La perfection de Le Rouge et le Noir et de La Chartreuse de Parme me semble cependant démontrable. Ces deux ouvrages, par leurs données, les caractères qui y sont présentés, la construction des intrigues qui s’y développent, le charme de leurs descriptions, la curiosité et la bonté que l’auteur y exerce, l’intelligence qu’il y manifeste, ont ce caractère de nécessité qui rend parfaitement heureux, – propre aux véritables chefs-d’œuvre (...) La prose de Stendhal n’est jamais une draperie posée sur un quelconque contenu, elle est le contenu même de sa pensée, un mouvement qui nous est transmis sans aucune déperdition d’énergie. » Énergie, un des mots les plus chers à Stendhal : « Je ne conçois pas un homme sans un peu de mâle énergie, de constance et de profondeur dans les idées. » Intelligence et vision de l’avenir aussi : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation : elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. » Sa célèbre épitaphe : « Visse, scrisse, amò : il a vécu, il a écrit, il a aimé. » que Sollers commente ainsi : « Il y a la vie, l’écriture, l’amour. Ou encore : l’amour naît de la vie qui s’écrit. » Parmi ses devises, celle-ci : « Intelligenti pauca. » : Peu de mots suffisent à ceux qui comprennent. Et « Songez à ne passer votre vie à haïr et à avoir peur. »  Comme l'écrit Philippe Sollers dans Trésor d'amour : « Tout cela se passe sans raisonnements superflus, à l'intuition, à l'instinct, au goût. » Et : « Il est très informé, il se tait. Mérimée écrit faussement : « Personne n'a jamais su exactement quels gens il voyait, quels livres il avait écrits, quels voyages il avait faits. » Mais si on sait, à moins de ne pas vouloir savoir. Cela dit, bien des choses restent dans l'ombre, à cause de son appartenance maçonnique qui lui a valu des soutiens mais aussi beaucoup d'ennuis surveillés et de courriers interceptés. La vie de Stendhal est cent fois plus romanesque que ce que disent les apparences. » Et aussi, du même : « Ce Beyle doit tout au règne de l'Usurpateur qui a conduit la France à s'agenouiller en Europe (ce qui ne l'empêche pas d'écrire dans les journaux anglais). Beyle n'a retrouvé une situation qu'avec peine, on l'a cantonné dans un bled où il effectue son travail avec retard, puisqu’il est le plus souvent à Rome, on se demande pourquoi. Attention, il a gardé un réseau de relations, c'est un brillant causeur à l'esprit acide, on le voit ici ou là, il peut être reçu au plus haut niveau (là encore on se demande pourquoi). La police autrichienne l'a identifié comme libéral dangereux. On lui prête des maîtresses, notamment italiennes. Célibataire, athée, familier des bordels. Quoique sous surveillance constante, inexplicablement accrédité par le Saint-Siège. » Laissons-lui le mot de la fin : « Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur. »
Comme l'écrit Philippe Sollers dans Trésor d'amour : « Tout cela se passe sans raisonnements superflus, à l'intuition, à l'instinct, au goût. » Et : « Il est très informé, il se tait. Mérimée écrit faussement : « Personne n'a jamais su exactement quels gens il voyait, quels livres il avait écrits, quels voyages il avait faits. » Mais si on sait, à moins de ne pas vouloir savoir. Cela dit, bien des choses restent dans l'ombre, à cause de son appartenance maçonnique qui lui a valu des soutiens mais aussi beaucoup d'ennuis surveillés et de courriers interceptés. La vie de Stendhal est cent fois plus romanesque que ce que disent les apparences. » Et aussi, du même : « Ce Beyle doit tout au règne de l'Usurpateur qui a conduit la France à s'agenouiller en Europe (ce qui ne l'empêche pas d'écrire dans les journaux anglais). Beyle n'a retrouvé une situation qu'avec peine, on l'a cantonné dans un bled où il effectue son travail avec retard, puisqu’il est le plus souvent à Rome, on se demande pourquoi. Attention, il a gardé un réseau de relations, c'est un brillant causeur à l'esprit acide, on le voit ici ou là, il peut être reçu au plus haut niveau (là encore on se demande pourquoi). La police autrichienne l'a identifié comme libéral dangereux. On lui prête des maîtresses, notamment italiennes. Célibataire, athée, familier des bordels. Quoique sous surveillance constante, inexplicablement accrédité par le Saint-Siège. » Laissons-lui le mot de la fin : « Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur. »
Raymond Alcovère
10:20 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stendhal
mardi, 28 avril 2020
Candide (Voltaire)
 S’il fallait donner un nom à l’intelligence, ce serait sans doute le sien. Un monstre de lucidité. Son récit de bataille dans Candide est jubilatoire : « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. » Ou encore : « Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé : il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à vif, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler (…) Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable ». Roland Barthes a brillamment analysé l’ironie voltairienne : « Nul mieux que lui n’a donné au combat de la Raison l’allure d’une fête. Tout était spectacle dans ses batailles : le nom de l’adversaire, toujours ridicule, la doctrine combattue, réduite à une proposition (l’ironie voltairienne est toujours la mise en évidence d’une disproportion) ; la multiplication des coups, fusant dans toutes les directions, au point d’en paraître un jeu, ce qui dispense de tout respect et de toute pitié. » Dans les Lettres philosophiques écrites lors de son premier voyage à Londres, Voltaire note : « J’ai toujours préféré la liberté à tout le reste ». Il a été beaucoup attaqué, détesté. « Dès que j’eus l’air d’un homme heureux, tous mes confrères les beaux esprits de Paris se déchaînèrent contre moi ». Ses épigrammes pouvaient être venimeuses : « L’autre jour au fond d’un vallon/ Un serpent piqua Jean Fréron/ Que pensez-vous qu’il arriva ?/ C’est le serpent qui creva. » Tout en lui est détours, esquive, subtilité et humour : « Je crois que j’étais né plaisant, et que c’est dommage que je me sois adonné parfois au sérieux. » Ou encore : « Je crois que la meilleure manière de tomber sur l’Infâme est de paraître n’avoir nulle envie de l’attaquer, de faire voir combien on nous a trompé en tout, combien ce qu’on nous a donné comme respectable est ridicule ; de laisser le lecteur tirer lui-même les conséquences. » Et enfin : « Je vais vite parce que la vie est courte et que j’ai bien des choses à faire. » Dans Le Mondain, il écrit : « J'aime le luxe, et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce. La propreté, le goût, les ornements: Tout honnête homme a de tels sentiments (…) Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde. Ah! Le bon temps que ce siècle de fer ! Le superflu, chose très nécessaire. » Ironie encore dans cette lettre à Rousseau, du 30 août 1755 : « J'ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain ; je vous en remercie ; vous plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, et vous ne les corrigerez pas. Vous peignez avec des couleurs bien vraies les horreurs de la société humaine dont l'ignorance et la faiblesse se promettent tant de douceurs. On n'a jamais tant employé d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. Et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. Je ne peux non plus m'embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada, premièrement parce que les maladies auxquelles je suis condamné me rendent un médecin d'Europe nécessaire, secondement parce que la guerre est portée dans ce pays-là, et que les exemples de nos nations ont rendu les sauvages presque aussi méchants que nous. Je me borne à être un sauvage paisible dans la solitude que j'ai choisie auprès de votre patrie où vous devriez être. » La réponse de Rousseau n’est pas moins intéressante : « C'est à moi, Monsieur, de vous remercier à tous égards. En vous offrant l'ébauche de mes tristes rêveries, je n'ai point cru vous faire un présent digne de vous, mais m'acquitter d'un devoir et vous rendre un hommage que nous vous devons tous comme à notre chef. Sensible, d'ailleurs, à l'honneur que vous faites à ma patrie, je partage la reconnaissance de mes Concitoyens, et j'espère qu'elle ne fera qu'augmenter encore, lorsqu'ils auront profité des instructions que vous pouvez leur donner. Embellissez l'asile que vous avez choisi : éclairez un Peuple digne de vos leçons ; et, vous qui savez si bien peindre les vertus de la liberté, apprenez-nous à les chérir dans nos murs comme dans vos Écrits. Tout ce qui vous approche doit apprendre de vous le chemin de la gloire. Vous voyez que je n'aspire pas à nous rétablir dans notre bêtise, quoique je regrette beaucoup, pour ma part, le peu que j'en ai perdu. À votre égard, Monsieur, ce retour serait un miracle, si grand à la fois et si nuisible, qu'il n'appartiendrait qu'à Dieu de le faire et qu'au Diable de le vouloir. Ne tentez donc pas de retomber à quatre pattes ; personne au monde n'y réussirait moins que vous. Vous nous redressez trop bien sur nos deux pieds pour cesser de vous tenir sur les vôtres. » : Voilà comment on écrivait au XVIIIe ! Voltaire a su jouer de tous les pouvoirs, il incarne les Lumières. Sublime Correspondance. Au duc de Richelieu « Vous savez très bien que les hommes ne méritent pas qu’on recherche leur suffrage ; cependant, on a la faiblesse de le désirer, ce suffrage qui n’est que du vent. L’essentiel est d’être bien avec soi-même et de regarder le public comme des chiens qui tantôt vous mordent, tantôt vous lèchent. » « La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux. » Et ce magnifique : « Le paradis terrestre est où je suis. » Et même : « Je ne sais comment j’ai fait pour être aussi heureux. » Son œuvre est beaucoup plus diverse qu’on ne l’entend en général. Il s’est donné les moyens de s’exprimer, on lui a beaucoup reproché de s’être enrichi : « J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés, que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre. » Il avait compris que pour mener les combats qu’il voulait, il avait besoin de cette indépendance ; et des combats, il en a menés et avec succès, mettant sa notoriété au service de l’affaire Calas ou du chevalier de la Barre notamment. Son ennemi était le fanatisme, et le détachement son arme, comme ici dans Candide : « Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris : d’abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu’on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance ; on parla même de livres nouveaux. » À Madame du Deffand : « Quand je vous aurai bien répété que la vie est un enfant qu’il faut bercer jusqu’à ce qu’il s’endorme, j’aurais dit tout ce que je sais. » Paul Morand : «Tachez donc de n'avoir pas toujours raison», écrit, en 1752, Voltaire à Frédéric II. C'est ce qu'on a envie de dire à Voltaire, dont chacune des trois mille lettres est si convaincante. » Nietzsche le vénérait au-delà de tout : « Voltaire était avant tout, au contraire de tout ce qui a tenu la plume après lui, un grand seigneur de l’intelligence. »
S’il fallait donner un nom à l’intelligence, ce serait sans doute le sien. Un monstre de lucidité. Son récit de bataille dans Candide est jubilatoire : « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. » Ou encore : « Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé : il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à vif, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler (…) Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable ». Roland Barthes a brillamment analysé l’ironie voltairienne : « Nul mieux que lui n’a donné au combat de la Raison l’allure d’une fête. Tout était spectacle dans ses batailles : le nom de l’adversaire, toujours ridicule, la doctrine combattue, réduite à une proposition (l’ironie voltairienne est toujours la mise en évidence d’une disproportion) ; la multiplication des coups, fusant dans toutes les directions, au point d’en paraître un jeu, ce qui dispense de tout respect et de toute pitié. » Dans les Lettres philosophiques écrites lors de son premier voyage à Londres, Voltaire note : « J’ai toujours préféré la liberté à tout le reste ». Il a été beaucoup attaqué, détesté. « Dès que j’eus l’air d’un homme heureux, tous mes confrères les beaux esprits de Paris se déchaînèrent contre moi ». Ses épigrammes pouvaient être venimeuses : « L’autre jour au fond d’un vallon/ Un serpent piqua Jean Fréron/ Que pensez-vous qu’il arriva ?/ C’est le serpent qui creva. » Tout en lui est détours, esquive, subtilité et humour : « Je crois que j’étais né plaisant, et que c’est dommage que je me sois adonné parfois au sérieux. » Ou encore : « Je crois que la meilleure manière de tomber sur l’Infâme est de paraître n’avoir nulle envie de l’attaquer, de faire voir combien on nous a trompé en tout, combien ce qu’on nous a donné comme respectable est ridicule ; de laisser le lecteur tirer lui-même les conséquences. » Et enfin : « Je vais vite parce que la vie est courte et que j’ai bien des choses à faire. » Dans Le Mondain, il écrit : « J'aime le luxe, et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce. La propreté, le goût, les ornements: Tout honnête homme a de tels sentiments (…) Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde. Ah! Le bon temps que ce siècle de fer ! Le superflu, chose très nécessaire. » Ironie encore dans cette lettre à Rousseau, du 30 août 1755 : « J'ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain ; je vous en remercie ; vous plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, et vous ne les corrigerez pas. Vous peignez avec des couleurs bien vraies les horreurs de la société humaine dont l'ignorance et la faiblesse se promettent tant de douceurs. On n'a jamais tant employé d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. Et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. Je ne peux non plus m'embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada, premièrement parce que les maladies auxquelles je suis condamné me rendent un médecin d'Europe nécessaire, secondement parce que la guerre est portée dans ce pays-là, et que les exemples de nos nations ont rendu les sauvages presque aussi méchants que nous. Je me borne à être un sauvage paisible dans la solitude que j'ai choisie auprès de votre patrie où vous devriez être. » La réponse de Rousseau n’est pas moins intéressante : « C'est à moi, Monsieur, de vous remercier à tous égards. En vous offrant l'ébauche de mes tristes rêveries, je n'ai point cru vous faire un présent digne de vous, mais m'acquitter d'un devoir et vous rendre un hommage que nous vous devons tous comme à notre chef. Sensible, d'ailleurs, à l'honneur que vous faites à ma patrie, je partage la reconnaissance de mes Concitoyens, et j'espère qu'elle ne fera qu'augmenter encore, lorsqu'ils auront profité des instructions que vous pouvez leur donner. Embellissez l'asile que vous avez choisi : éclairez un Peuple digne de vos leçons ; et, vous qui savez si bien peindre les vertus de la liberté, apprenez-nous à les chérir dans nos murs comme dans vos Écrits. Tout ce qui vous approche doit apprendre de vous le chemin de la gloire. Vous voyez que je n'aspire pas à nous rétablir dans notre bêtise, quoique je regrette beaucoup, pour ma part, le peu que j'en ai perdu. À votre égard, Monsieur, ce retour serait un miracle, si grand à la fois et si nuisible, qu'il n'appartiendrait qu'à Dieu de le faire et qu'au Diable de le vouloir. Ne tentez donc pas de retomber à quatre pattes ; personne au monde n'y réussirait moins que vous. Vous nous redressez trop bien sur nos deux pieds pour cesser de vous tenir sur les vôtres. » : Voilà comment on écrivait au XVIIIe ! Voltaire a su jouer de tous les pouvoirs, il incarne les Lumières. Sublime Correspondance. Au duc de Richelieu « Vous savez très bien que les hommes ne méritent pas qu’on recherche leur suffrage ; cependant, on a la faiblesse de le désirer, ce suffrage qui n’est que du vent. L’essentiel est d’être bien avec soi-même et de regarder le public comme des chiens qui tantôt vous mordent, tantôt vous lèchent. » « La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux. » Et ce magnifique : « Le paradis terrestre est où je suis. » Et même : « Je ne sais comment j’ai fait pour être aussi heureux. » Son œuvre est beaucoup plus diverse qu’on ne l’entend en général. Il s’est donné les moyens de s’exprimer, on lui a beaucoup reproché de s’être enrichi : « J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés, que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre. » Il avait compris que pour mener les combats qu’il voulait, il avait besoin de cette indépendance ; et des combats, il en a menés et avec succès, mettant sa notoriété au service de l’affaire Calas ou du chevalier de la Barre notamment. Son ennemi était le fanatisme, et le détachement son arme, comme ici dans Candide : « Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris : d’abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu’on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance ; on parla même de livres nouveaux. » À Madame du Deffand : « Quand je vous aurai bien répété que la vie est un enfant qu’il faut bercer jusqu’à ce qu’il s’endorme, j’aurais dit tout ce que je sais. » Paul Morand : «Tachez donc de n'avoir pas toujours raison», écrit, en 1752, Voltaire à Frédéric II. C'est ce qu'on a envie de dire à Voltaire, dont chacune des trois mille lettres est si convaincante. » Nietzsche le vénérait au-delà de tout : « Voltaire était avant tout, au contraire de tout ce qui a tenu la plume après lui, un grand seigneur de l’intelligence. »
Raymond Alcovère
10:20 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire, Roman de romans | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voltaire, candide
Les Fleurs du mal (Charles Baudelaire)
 Travailleur acharné, ce qu’on oublie souvent, il a laissé dix volumes, bien que mort à quarante-sept ans, avec bien peu de déchets. « Ce qui est inouï en Baudelaire, écrit Claude Roy dans sa préface aux Œuvres complètes, c’est la superposition et la fusion méditée d’harmoniques jamais assemblés avant lui ». En effet, Baudelaire, à partir d’une première version du poème, assez classique, parnassienne, enrichit au fur et à mesure son texte par l’ajout de nouvelles images, plus riches, plus fouillées, plus étranges, et ce travail par couches successives, – comme un sculpteur qui peu à peu met à jour son œuvre à partir d’une masse informe – a accouché des chefs-d’œuvre qu’on connaît, intemporels. Il est la volupté même, lui qui a écrit : « La Révolution a été faite par des voluptueux. » « Le parti le plus difficile ou le plus gai est toujours celui que je prends ; et je ne me reproche pas une bonne action, pourvu qu’elle m’exerce ou m’amuse. »
Travailleur acharné, ce qu’on oublie souvent, il a laissé dix volumes, bien que mort à quarante-sept ans, avec bien peu de déchets. « Ce qui est inouï en Baudelaire, écrit Claude Roy dans sa préface aux Œuvres complètes, c’est la superposition et la fusion méditée d’harmoniques jamais assemblés avant lui ». En effet, Baudelaire, à partir d’une première version du poème, assez classique, parnassienne, enrichit au fur et à mesure son texte par l’ajout de nouvelles images, plus riches, plus fouillées, plus étranges, et ce travail par couches successives, – comme un sculpteur qui peu à peu met à jour son œuvre à partir d’une masse informe – a accouché des chefs-d’œuvre qu’on connaît, intemporels. Il est la volupté même, lui qui a écrit : « La Révolution a été faite par des voluptueux. » « Le parti le plus difficile ou le plus gai est toujours celui que je prends ; et je ne me reproche pas une bonne action, pourvu qu’elle m’exerce ou m’amuse. »  Le vrai paradis artificiel de Baudelaire, c’est la peinture » écrit encore Claude Roy. Son jugement est infaillible, il reconnaîtra, souvent avant tout le monde, les grands écrivains, peintres et musiciens de son temps. En réalité, tout l’intéresse, le nourrit. Proust a dit de lui : « Comme c’est plus audacieux que tout ce qu’on trouve audacieux ». Il est le poète des Correspondances qu’il n’a cessés de chercher « entre la nature et l’esprit, entre l’espace visuel et l’espace du dedans, entre les images et les sons, entre la peinture et la poésie ». D’un foudroyant pessimisme aussi : « L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu ». Mais lucide aussi : dans l’édition originale des Fleurs du mal (1857), on trouve cette exergue de Théodore Agrippa d’Aubigné : « Mais le vice n’a point pour mère la science. Et la vertu n’est pas fille de l’ignorance. » Et pourtant, le jugement sur Les fleurs du mal n’a été définitivement cassé qu’en 1949. Son œuvre est parsemée d’éclairs : « L’aube grelottante en robe rose et verte. » « Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large, / Chargé de toile et va roulant / Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent. » « Mais le vert paradis des amours enfantines. » « Valse mélancolique et langoureux vertige. » « J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre. » « Ta tête, ton geste, ton air / Sont beaux comme un beau paysage / Le rire joue en ton visage / Comme un vent frais dans un ciel clair. » « Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre ! » Et quelle trouvaille extraordinaire que : « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d’aller là-bas vivre ensemble… »
Le vrai paradis artificiel de Baudelaire, c’est la peinture » écrit encore Claude Roy. Son jugement est infaillible, il reconnaîtra, souvent avant tout le monde, les grands écrivains, peintres et musiciens de son temps. En réalité, tout l’intéresse, le nourrit. Proust a dit de lui : « Comme c’est plus audacieux que tout ce qu’on trouve audacieux ». Il est le poète des Correspondances qu’il n’a cessés de chercher « entre la nature et l’esprit, entre l’espace visuel et l’espace du dedans, entre les images et les sons, entre la peinture et la poésie ». D’un foudroyant pessimisme aussi : « L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu ». Mais lucide aussi : dans l’édition originale des Fleurs du mal (1857), on trouve cette exergue de Théodore Agrippa d’Aubigné : « Mais le vice n’a point pour mère la science. Et la vertu n’est pas fille de l’ignorance. » Et pourtant, le jugement sur Les fleurs du mal n’a été définitivement cassé qu’en 1949. Son œuvre est parsemée d’éclairs : « L’aube grelottante en robe rose et verte. » « Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large, / Chargé de toile et va roulant / Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent. » « Mais le vert paradis des amours enfantines. » « Valse mélancolique et langoureux vertige. » « J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre. » « Ta tête, ton geste, ton air / Sont beaux comme un beau paysage / Le rire joue en ton visage / Comme un vent frais dans un ciel clair. » « Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre ! » Et quelle trouvaille extraordinaire que : « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d’aller là-bas vivre ensemble… »  Quant aux Bijoux, il faudrait le citer en entier… Même s’il a écrit « Bien qu’on ait du cœur à l’ouvrage, l’art est long et le temps est court. » il nous laisse en héritage tant de chefs-d’œuvre et son étonnante lucidité : « En somme, devant l’histoire et devant le peuple français, la grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le premier venu peut, en s’emparant du télégraphe et de l’Imprimerie nationale, gouverner une grande nation. Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s’accomplir sans la permission du peuple, et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. » Ou encore : « Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l’unique chose importante. » Il projetait d’ajouter à la liste des droits de l’homme, celui de se contredire et celui de s’en aller.
Quant aux Bijoux, il faudrait le citer en entier… Même s’il a écrit « Bien qu’on ait du cœur à l’ouvrage, l’art est long et le temps est court. » il nous laisse en héritage tant de chefs-d’œuvre et son étonnante lucidité : « En somme, devant l’histoire et devant le peuple français, la grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le premier venu peut, en s’emparant du télégraphe et de l’Imprimerie nationale, gouverner une grande nation. Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s’accomplir sans la permission du peuple, et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. » Ou encore : « Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l’unique chose importante. » Il projetait d’ajouter à la liste des droits de l’homme, celui de se contredire et celui de s’en aller.
Raymond Alcovère
10:19 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : baudelaire, les fleurs du mal
Sur la route (Jack Kerouac)
 « On était dans les montagnes ; il y avait une merveille de soleil levant, des fraîcheurs mauves, des pentes rougeoyantes, l’émeraude des pâturages dans les vallées, la rosée et les changeants nuages d’or (…) Bientôt ce fut l’obscurité, une obscurité de raisins, une obscurité pourprée sur les plantations de mandariniers et les champs de melons ; le soleil couleur de raisins écrasés, avec des balafres rouge bourgogne, les champs couleur de l’amour et des mystères hispaniques. Je passais ma tête par la fenêtre et aspirais à longs traits l’air embaumé. C’étaient les plus magnifiques de tous les instants. » Rarement sans doute un livre a aussi bien collé à une génération, servi de révélateur à une époque : Sur la route, écrit en 1951 (publié en 1957) sera un phénomène. Il va incarner la Beat Generation, mouvement né de la rencontre en 1943-44 entre Jack Kerouac, Allan Ginsberg et William Burroughs, tous trois écrivains et poètes. Beat au départ signifie vagabond, puis renvoie au rythme de l’écriture, proche de celle du jazz, et même à béatitude (Kerouac sera très influencé par sa rencontre avec Gary Snyder qui l’initiera au bouddhisme et à la spiritualité, expérience qu’il racontera dans Les clochards célestes). Ainsi vont naître les beatniks. Une déferlante que Kerouac incarnera malgré lui et qui le dépassera. Mais c’est une autre histoire. Reste le livre. Et sa force, sa puissance, la sincérité qui s’en dégage. Ecrit en trois semaines, sur un unique rouleau de papier. On y croise des centaines de personnages, de lieux, poussés par une écriture rythmée, endiablée, frénétique. Une écriture comme un souffle, une pulsation, un battement, un beat. « Je veux être considéré comme un poète de jazz soufflant un long blues au cours d’une jam-session un dimanche après-midi », écrira-t-il. Comme le souligne Yves Le Pellec (Jack Kerouac. Le verbe vagabond) : « Kerouac est nettement plus préoccupé de rythme, de relief, d’intensité que de pensée. (…) Son texte laisse toujours une large place au hasard et à l’arbitraire. » En effet, son écriture est physique. Il mouillait sa chemise, au sens propre du terme. Comme un musicien se sert de son corps, il utilisait les mots comme des notes. Avant tout, Sur la route, c’est le portrait d’un personnage invraisemblable et pourtant bien réel, Neal Cassady (Dean dans le roman), qui fut l’ami et l’inspirateur de Kerouac : « Un gars de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi comme copain et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ?… Quelque part sur le chemin je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare. » En pleine période du maccarthysme, d’Einsenhower, une autre Amérique se dessine : « Un soir de lilas, je marchais, souffrant de tous mes muscles, parmi les lumières de la Vingt-septième Rue et de la Welton, dans le quartier noir de Denver, souhaitant être un nègre, avec le sentiment que ce qu’il y avait de mieux dans le monde blanc ne m’offrait pas assez d’extase, ni assez de vie, de joie, de frénésie, de ténèbres, de musique, pas assez de nuit. Je m’arrêtais devant une petite baraque où un homme vendait des poivrons tout chauds dans des cornets de papier ; j’en achetai et tout en mangeant, je flânai dans les rues obscures et mystérieuses. J’avais envie d’être un mexicain de Denver, ou même un pauvre Jap accablé de boulot, n’importe quoi sauf ce que j’étais si lugubrement, un homme blanc désabusé. » Une Amérique dont les lieux mythiques sont le Mississippi : « Une argile délavée dans la nuit pluvieuse, le bruit mat d’écroulements le long des berges inclinées du Missouri, un être qui se dissout, la chevauchée du Mascaret remontant le lit du fleuve éternel, de brunes écumes, un être naviguant sans fin par les vallons les forêts et les digues » et San Francisco bien sûr : « Soudain, parvenus au sommet d’une crête, on vit se déployer devant nous la fabuleuse ville blanche de San Francisco, sur ces onze collines mystiques et le Pacifique bleu, et au-delà son mur de brouillard comme au-dessus de champs de pommes de terre qui s’avançait, et la fumée et l’or répandu sur cette fin d’après-midi. » Cette Amérique-là ne peut trouver son point d’orgue qu’au Mexique, la terre promise : « Derrière nous s’étalait toute l’Amérique et tout ce que Dean et moi avions auparavant appris de la vie, et de la vie sur la route. Nous avions enfin trouvé la terre magique au bout de la route et jamais nous n’avions imaginé le pouvoir de cette magie. » Un peu plus loin : « Chacun ici est en paix, chacun te regarde avec des yeux bruns si francs et ils ne disent mot, ils regardent juste, et dans ce regard toutes les qualités humaines sont tamisées et assourdies et toujours présentes. » Même si la frustration, le désespoir ne sont jamais absents, un sentiment de jubilation, de frénésie traverse tout le livre. Tout semble toujours possible, et cette route qui défile et ne s’arrête jamais (à l’image de ce rouleau de papier lui aussi ininterrompu), c’est le grand courant de la vie qui la traverse de part en part. Le plus étonnant dans tout ça, c’est que tout est vrai, rien n’est inventé. Kerouac a bourlingué (comme Cendrars), observé et il a une mémoire extraordinaire. Yves Le Pellec le résume bien : « Kerouac est un prodigieux badaud, il est obsédé de la totalité, il voudrait tout faire entrer dans ses phrases tentaculaires, entêtées ». Il a expliqué lui-même sa technique : « Ne pars pas d’une idée préconçue de ce qu’il y a à dire sur l’image mais du joyau au cœur de l’intérêt pour le sujet de l’image au moment d’écrire et écris vers l’extérieur en nageant dans la mer du langage jusqu’au relâchement et à l’épuisement périphérique. » Kerouac est avant tout un écrivain. Avant son succès foudroyant, il venait d’écrire douze livres en sept ans (1950-1957), sans répit, sans aide, sans confort, sans argent et sans reconnaissance. Aussi il vivra mal le succès, le vedettariat qui l’assailliront d’un coup. Il sombrera dans la paranoïa. « Toute ma vie, écrira-t-il en 1957 dans un bref résumé autobiographique à la demande d’un éditeur, je me suis arraché le cœur à écrire. » Lucide : « Soyez conscient que l’envie règne, mais que le destin juge. » et dans une lettre à Neal Cassady en 1950 : « Je renonce à toute fiction. J’espère que je deviendrai moins littéraire et plus intéressant à mesure que je progresse dans la vérité effective de ma vie. Il n’y a rien d’autre à faire que d’écrire la vérité. Il n’y a pas d’autre raison d’écrire. L’Église est le dernier sanctuaire de ce monde, le premier et le dernier. »
« On était dans les montagnes ; il y avait une merveille de soleil levant, des fraîcheurs mauves, des pentes rougeoyantes, l’émeraude des pâturages dans les vallées, la rosée et les changeants nuages d’or (…) Bientôt ce fut l’obscurité, une obscurité de raisins, une obscurité pourprée sur les plantations de mandariniers et les champs de melons ; le soleil couleur de raisins écrasés, avec des balafres rouge bourgogne, les champs couleur de l’amour et des mystères hispaniques. Je passais ma tête par la fenêtre et aspirais à longs traits l’air embaumé. C’étaient les plus magnifiques de tous les instants. » Rarement sans doute un livre a aussi bien collé à une génération, servi de révélateur à une époque : Sur la route, écrit en 1951 (publié en 1957) sera un phénomène. Il va incarner la Beat Generation, mouvement né de la rencontre en 1943-44 entre Jack Kerouac, Allan Ginsberg et William Burroughs, tous trois écrivains et poètes. Beat au départ signifie vagabond, puis renvoie au rythme de l’écriture, proche de celle du jazz, et même à béatitude (Kerouac sera très influencé par sa rencontre avec Gary Snyder qui l’initiera au bouddhisme et à la spiritualité, expérience qu’il racontera dans Les clochards célestes). Ainsi vont naître les beatniks. Une déferlante que Kerouac incarnera malgré lui et qui le dépassera. Mais c’est une autre histoire. Reste le livre. Et sa force, sa puissance, la sincérité qui s’en dégage. Ecrit en trois semaines, sur un unique rouleau de papier. On y croise des centaines de personnages, de lieux, poussés par une écriture rythmée, endiablée, frénétique. Une écriture comme un souffle, une pulsation, un battement, un beat. « Je veux être considéré comme un poète de jazz soufflant un long blues au cours d’une jam-session un dimanche après-midi », écrira-t-il. Comme le souligne Yves Le Pellec (Jack Kerouac. Le verbe vagabond) : « Kerouac est nettement plus préoccupé de rythme, de relief, d’intensité que de pensée. (…) Son texte laisse toujours une large place au hasard et à l’arbitraire. » En effet, son écriture est physique. Il mouillait sa chemise, au sens propre du terme. Comme un musicien se sert de son corps, il utilisait les mots comme des notes. Avant tout, Sur la route, c’est le portrait d’un personnage invraisemblable et pourtant bien réel, Neal Cassady (Dean dans le roman), qui fut l’ami et l’inspirateur de Kerouac : « Un gars de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi comme copain et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ?… Quelque part sur le chemin je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare. » En pleine période du maccarthysme, d’Einsenhower, une autre Amérique se dessine : « Un soir de lilas, je marchais, souffrant de tous mes muscles, parmi les lumières de la Vingt-septième Rue et de la Welton, dans le quartier noir de Denver, souhaitant être un nègre, avec le sentiment que ce qu’il y avait de mieux dans le monde blanc ne m’offrait pas assez d’extase, ni assez de vie, de joie, de frénésie, de ténèbres, de musique, pas assez de nuit. Je m’arrêtais devant une petite baraque où un homme vendait des poivrons tout chauds dans des cornets de papier ; j’en achetai et tout en mangeant, je flânai dans les rues obscures et mystérieuses. J’avais envie d’être un mexicain de Denver, ou même un pauvre Jap accablé de boulot, n’importe quoi sauf ce que j’étais si lugubrement, un homme blanc désabusé. » Une Amérique dont les lieux mythiques sont le Mississippi : « Une argile délavée dans la nuit pluvieuse, le bruit mat d’écroulements le long des berges inclinées du Missouri, un être qui se dissout, la chevauchée du Mascaret remontant le lit du fleuve éternel, de brunes écumes, un être naviguant sans fin par les vallons les forêts et les digues » et San Francisco bien sûr : « Soudain, parvenus au sommet d’une crête, on vit se déployer devant nous la fabuleuse ville blanche de San Francisco, sur ces onze collines mystiques et le Pacifique bleu, et au-delà son mur de brouillard comme au-dessus de champs de pommes de terre qui s’avançait, et la fumée et l’or répandu sur cette fin d’après-midi. » Cette Amérique-là ne peut trouver son point d’orgue qu’au Mexique, la terre promise : « Derrière nous s’étalait toute l’Amérique et tout ce que Dean et moi avions auparavant appris de la vie, et de la vie sur la route. Nous avions enfin trouvé la terre magique au bout de la route et jamais nous n’avions imaginé le pouvoir de cette magie. » Un peu plus loin : « Chacun ici est en paix, chacun te regarde avec des yeux bruns si francs et ils ne disent mot, ils regardent juste, et dans ce regard toutes les qualités humaines sont tamisées et assourdies et toujours présentes. » Même si la frustration, le désespoir ne sont jamais absents, un sentiment de jubilation, de frénésie traverse tout le livre. Tout semble toujours possible, et cette route qui défile et ne s’arrête jamais (à l’image de ce rouleau de papier lui aussi ininterrompu), c’est le grand courant de la vie qui la traverse de part en part. Le plus étonnant dans tout ça, c’est que tout est vrai, rien n’est inventé. Kerouac a bourlingué (comme Cendrars), observé et il a une mémoire extraordinaire. Yves Le Pellec le résume bien : « Kerouac est un prodigieux badaud, il est obsédé de la totalité, il voudrait tout faire entrer dans ses phrases tentaculaires, entêtées ». Il a expliqué lui-même sa technique : « Ne pars pas d’une idée préconçue de ce qu’il y a à dire sur l’image mais du joyau au cœur de l’intérêt pour le sujet de l’image au moment d’écrire et écris vers l’extérieur en nageant dans la mer du langage jusqu’au relâchement et à l’épuisement périphérique. » Kerouac est avant tout un écrivain. Avant son succès foudroyant, il venait d’écrire douze livres en sept ans (1950-1957), sans répit, sans aide, sans confort, sans argent et sans reconnaissance. Aussi il vivra mal le succès, le vedettariat qui l’assailliront d’un coup. Il sombrera dans la paranoïa. « Toute ma vie, écrira-t-il en 1957 dans un bref résumé autobiographique à la demande d’un éditeur, je me suis arraché le cœur à écrire. » Lucide : « Soyez conscient que l’envie règne, mais que le destin juge. » et dans une lettre à Neal Cassady en 1950 : « Je renonce à toute fiction. J’espère que je deviendrai moins littéraire et plus intéressant à mesure que je progresse dans la vérité effective de ma vie. Il n’y a rien d’autre à faire que d’écrire la vérité. Il n’y a pas d’autre raison d’écrire. L’Église est le dernier sanctuaire de ce monde, le premier et le dernier. »
Raymond Alcovère
10:18 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sur la route, jack kerouac
Le Secret (Philippe Sollers)
 On s’en rendra compte probablement plus tard, mais c’est l’écrivain français le plus important de la période. Il propose une vision du monde complète et homogène, sans rien laisser de côté, en rassemblant et harmonisant des univers aussi vastes et divers que la Chine, la Grèce, le 18ᵉ, la peinture, la poésie, la musique, la religion catholique, la sexualité ou la politique. Toujours sous forme d’ouverture, il offre à lire ou regarder, notamment grâce à un sens consommé de la citation, nombre d’écrivains, penseurs et artistes : « Il n’y a qu’une seule expérience fondamentale à travers le Temps. Formes différentes, noms différents, mais une même chose. Et c’est là, précisément le roman. » Audace de pensée, originalité, esprit critique, sens de la formule, de l’esquive et de l’attaque. Avec lui, la poésie n’est pas séparée de la pensée, ni de l’action. Il ajoute, provoquant : « La poésie, c’est la guerre. » S’inspirant de Sun Tzu : « Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, mille batailles ne pourront venir à bout de vous. » Sa stratégie est clairement posée : « Ce que l’ennemi attaque, je le défends, ce qu’il défend je l’attaque. » Le difficile bien sûr est de connaître l’ennemi. Il le décrit dans Éloge de l’Infini : « Car l’Adversaire est inquiet. Ses réseaux de renseignement sont mauvais, sa police débordée, ses agents corrompus, ses amis peu sûrs, ses espions souvent retournés, ses femmes infidèles, sa toute-puissance ébranlée par la première guérilla venue. Il dépense des sommes considérables en contrôle, parle sans cesse en termes de calendrier ou d’images, achète tout, investit tout, vend tout, perd tout. Le temps lui file entre les doigts, l’espace est pour lui de moins en moins un refuge. Les mots « siècle » ou « millénaire » perdent leur sens dans sa propagande. Il voudrait bien avoir pour lui cinq ou dix ans, l’Adversaire, alors qu’il ne voit pas plus loin que le mois suivant. On pourrait dire ici, comme dans la Chine des Royaumes combattants, que « même les comédiens de Ts’in servent d’observateurs à Houei Ngan ». Le Maître est énorme et nu, sa carapace est sensible au plus petit coup d’épingle, c’est un Goliath à la merci du moindre frondeur, un Cyclope qui ne sait toujours pas qui s’appelle Personne, un Big Brother dont les caméras n’enregistrent que ses propres fantasmes, un Pavlov dont le chien n’obéit qu’une fois sur deux. Il calcule et communique beaucoup pour ne rien dire, l’Adversaire, il tourne en rond, il s’énerve, il ne comprend pas comment le langage a pu le déserter à ce point, il multiplie les informations, oublie ses rêves, fabrique des films barbants à la chaîne, s’endort devant ses films, croit toujours dur comme fer que l’argent, le sexe et la drogue mènent le monde, sent pourtant le sol se dérober sous ses pieds, est pris de vertige, en vient secrètement à préférer mourir. » Son livre fondateur, outre Paradis, est Femmes, avec cette fameuse phrase : « Le monde appartient aux femmes. C’est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. » Le Cœur absolu, Le Secret, Les Voyageurs du temps, l’Étoile des amants, Guerres secrètes sont les autres sommets de son œuvre. Ses recueils d’articles : La Guerre du goût, Éloge de l’infini, Discours parfait et Fugues, permettent d’explorer son univers et la diversité de ses sources d’inspiration. Son écriture déborde de légèreté et d’ironie quand il écrit pour la presse (textes regroupés pour certains dans Littérature et politique). Son but, toujours, inciter à lire : « Mauvais rapport avec le langage, mauvais rapport avec l’Être : c’est la même chose. » La question est centrale : « C’est dans les textes que s’opèrent les identifications décisives. » « Savoir lire, c’est aussi pouvoir tout lire sans rejets et sans préjugés : Claudel et Céline, Artaud et Proust, Sade et la Bible, Joyce et Mme de Sévigné. Prouvez-le, montrez que vous n’êtes pas un esprit religieux. Savoir lire, c’est vivre le monde l’histoire et sa propre existence comme un déchiffrement permanent. Savoir lire, c’est la liberté ». Il n'a de cesse de bousculer les idées reçues, ce qui lui vaut tant d'ennemis, notamment avec « le catholicisme comme négation de la religion » que Jean-Hugues Larché commente ainsi : « L'écrivain maintient que le catholicisme est un athéisme et que la religion catholique est celle qui contient le moins de religion. » Ces mots dans Le Secret le résument bien : « J’aime écrire, tracer les lettres et les mots, l’intervalle toujours changeant entre les lettres et les mots, seule façon de laisser filer, de devenir silencieusement et à chaque instant le secret du monde. N’oublie pas, se dit avec ironie ce fantôme penché, que tu dois rester réservé, calme, olympien, lisse, détaché ; tibétain en somme… Tu respires, tu fermes les yeux, tu planes, tu es en même temps ce petit garçon qui court avec son cerf-volant dans le jardin et le sage en méditation quelque part dans les montagnes vertes et brumeuses, en Grèce ou en Chine… Socrate debout toute la nuit contre son portique, ou plutôt Parménide sur sa terrasse, ou encore Lao-Tseu passant, à dos de mulet, au-delà de la grande muraille, un soir… Les minutes se tassent les unes sur les autres, la seule question devient la circulation du sang, rien de voilé qui ne sera dévoilé, rien de caché qui ne sera révélé, la lumière finira bien par se lever au cœur du noir labyrinthe. Le roman se fait tout seul, et ton roman est universel si tu veux, ta vie ne ressemble à aucune autre dans le sentiment d’être là, maintenant, à jamais, pour rien, en détail. Ils aimeraient tellement qu’on soit là pour. Qu’on existe et qu’on agisse pour. Qu’on pense en fonction d’eux et pour. Tu dois refuser, et refuser encore. Non, non et non. Ce que tu sais, tu es le seul à le savoir. » Il exalte la poésie, la gratuité, l’amour pour s’opposer à l’Adversaire : « La règle générale est de raconter des amours impossibles, des impasses, des drames, des récriminations, des échecs, et moi je fais le contraire. » Comme il l’a écrit lui-même dans Passion fixe, ses livres ressemblent à des tableaux cubistes, où la réalité est montrée sous des angles différents qui se multiplient avant de se rassembler de sorte que l’apparent désordre laisse peu à peu place à une savante construction. Selon une technique chinoise très ancienne : « Quand on le déroule, ce livre remplit l’univers dans toutes ses directions, et, quand on l’enroule, il se retire et s’enfouit dans son secret. Sa saveur est inépuisable, tout y est réelle étude. Le bon lecteur, en l’explorant pour son plaisir, y a accès ; dès lors, jusqu’à la fin de ses jours, il en fait usage, sans jamais pouvoir en venir à bout. » Dans un entretien avec Philippe Lejeune en 2009, il précise : « Il est fort possible – mais le temps seul le dira – qu'il s'agisse d'une entreprise métaphysique portant sur une expérience très singulière, dont les rapports avec la littérature seraient tangents, épisodiques, dépendant des situations historiques et en tout cas où l'essentiel ne serait pas là. Il ne s'agirait pas de littéraire à proprement parler et peut-être même pas de littérature. » Roland Barthes l'a noté dans Sollers écrivain : « celui-ci, pratique, de toute évidence, une écriture de vie. »
On s’en rendra compte probablement plus tard, mais c’est l’écrivain français le plus important de la période. Il propose une vision du monde complète et homogène, sans rien laisser de côté, en rassemblant et harmonisant des univers aussi vastes et divers que la Chine, la Grèce, le 18ᵉ, la peinture, la poésie, la musique, la religion catholique, la sexualité ou la politique. Toujours sous forme d’ouverture, il offre à lire ou regarder, notamment grâce à un sens consommé de la citation, nombre d’écrivains, penseurs et artistes : « Il n’y a qu’une seule expérience fondamentale à travers le Temps. Formes différentes, noms différents, mais une même chose. Et c’est là, précisément le roman. » Audace de pensée, originalité, esprit critique, sens de la formule, de l’esquive et de l’attaque. Avec lui, la poésie n’est pas séparée de la pensée, ni de l’action. Il ajoute, provoquant : « La poésie, c’est la guerre. » S’inspirant de Sun Tzu : « Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, mille batailles ne pourront venir à bout de vous. » Sa stratégie est clairement posée : « Ce que l’ennemi attaque, je le défends, ce qu’il défend je l’attaque. » Le difficile bien sûr est de connaître l’ennemi. Il le décrit dans Éloge de l’Infini : « Car l’Adversaire est inquiet. Ses réseaux de renseignement sont mauvais, sa police débordée, ses agents corrompus, ses amis peu sûrs, ses espions souvent retournés, ses femmes infidèles, sa toute-puissance ébranlée par la première guérilla venue. Il dépense des sommes considérables en contrôle, parle sans cesse en termes de calendrier ou d’images, achète tout, investit tout, vend tout, perd tout. Le temps lui file entre les doigts, l’espace est pour lui de moins en moins un refuge. Les mots « siècle » ou « millénaire » perdent leur sens dans sa propagande. Il voudrait bien avoir pour lui cinq ou dix ans, l’Adversaire, alors qu’il ne voit pas plus loin que le mois suivant. On pourrait dire ici, comme dans la Chine des Royaumes combattants, que « même les comédiens de Ts’in servent d’observateurs à Houei Ngan ». Le Maître est énorme et nu, sa carapace est sensible au plus petit coup d’épingle, c’est un Goliath à la merci du moindre frondeur, un Cyclope qui ne sait toujours pas qui s’appelle Personne, un Big Brother dont les caméras n’enregistrent que ses propres fantasmes, un Pavlov dont le chien n’obéit qu’une fois sur deux. Il calcule et communique beaucoup pour ne rien dire, l’Adversaire, il tourne en rond, il s’énerve, il ne comprend pas comment le langage a pu le déserter à ce point, il multiplie les informations, oublie ses rêves, fabrique des films barbants à la chaîne, s’endort devant ses films, croit toujours dur comme fer que l’argent, le sexe et la drogue mènent le monde, sent pourtant le sol se dérober sous ses pieds, est pris de vertige, en vient secrètement à préférer mourir. » Son livre fondateur, outre Paradis, est Femmes, avec cette fameuse phrase : « Le monde appartient aux femmes. C’est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. » Le Cœur absolu, Le Secret, Les Voyageurs du temps, l’Étoile des amants, Guerres secrètes sont les autres sommets de son œuvre. Ses recueils d’articles : La Guerre du goût, Éloge de l’infini, Discours parfait et Fugues, permettent d’explorer son univers et la diversité de ses sources d’inspiration. Son écriture déborde de légèreté et d’ironie quand il écrit pour la presse (textes regroupés pour certains dans Littérature et politique). Son but, toujours, inciter à lire : « Mauvais rapport avec le langage, mauvais rapport avec l’Être : c’est la même chose. » La question est centrale : « C’est dans les textes que s’opèrent les identifications décisives. » « Savoir lire, c’est aussi pouvoir tout lire sans rejets et sans préjugés : Claudel et Céline, Artaud et Proust, Sade et la Bible, Joyce et Mme de Sévigné. Prouvez-le, montrez que vous n’êtes pas un esprit religieux. Savoir lire, c’est vivre le monde l’histoire et sa propre existence comme un déchiffrement permanent. Savoir lire, c’est la liberté ». Il n'a de cesse de bousculer les idées reçues, ce qui lui vaut tant d'ennemis, notamment avec « le catholicisme comme négation de la religion » que Jean-Hugues Larché commente ainsi : « L'écrivain maintient que le catholicisme est un athéisme et que la religion catholique est celle qui contient le moins de religion. » Ces mots dans Le Secret le résument bien : « J’aime écrire, tracer les lettres et les mots, l’intervalle toujours changeant entre les lettres et les mots, seule façon de laisser filer, de devenir silencieusement et à chaque instant le secret du monde. N’oublie pas, se dit avec ironie ce fantôme penché, que tu dois rester réservé, calme, olympien, lisse, détaché ; tibétain en somme… Tu respires, tu fermes les yeux, tu planes, tu es en même temps ce petit garçon qui court avec son cerf-volant dans le jardin et le sage en méditation quelque part dans les montagnes vertes et brumeuses, en Grèce ou en Chine… Socrate debout toute la nuit contre son portique, ou plutôt Parménide sur sa terrasse, ou encore Lao-Tseu passant, à dos de mulet, au-delà de la grande muraille, un soir… Les minutes se tassent les unes sur les autres, la seule question devient la circulation du sang, rien de voilé qui ne sera dévoilé, rien de caché qui ne sera révélé, la lumière finira bien par se lever au cœur du noir labyrinthe. Le roman se fait tout seul, et ton roman est universel si tu veux, ta vie ne ressemble à aucune autre dans le sentiment d’être là, maintenant, à jamais, pour rien, en détail. Ils aimeraient tellement qu’on soit là pour. Qu’on existe et qu’on agisse pour. Qu’on pense en fonction d’eux et pour. Tu dois refuser, et refuser encore. Non, non et non. Ce que tu sais, tu es le seul à le savoir. » Il exalte la poésie, la gratuité, l’amour pour s’opposer à l’Adversaire : « La règle générale est de raconter des amours impossibles, des impasses, des drames, des récriminations, des échecs, et moi je fais le contraire. » Comme il l’a écrit lui-même dans Passion fixe, ses livres ressemblent à des tableaux cubistes, où la réalité est montrée sous des angles différents qui se multiplient avant de se rassembler de sorte que l’apparent désordre laisse peu à peu place à une savante construction. Selon une technique chinoise très ancienne : « Quand on le déroule, ce livre remplit l’univers dans toutes ses directions, et, quand on l’enroule, il se retire et s’enfouit dans son secret. Sa saveur est inépuisable, tout y est réelle étude. Le bon lecteur, en l’explorant pour son plaisir, y a accès ; dès lors, jusqu’à la fin de ses jours, il en fait usage, sans jamais pouvoir en venir à bout. » Dans un entretien avec Philippe Lejeune en 2009, il précise : « Il est fort possible – mais le temps seul le dira – qu'il s'agisse d'une entreprise métaphysique portant sur une expérience très singulière, dont les rapports avec la littérature seraient tangents, épisodiques, dépendant des situations historiques et en tout cas où l'essentiel ne serait pas là. Il ne s'agirait pas de littéraire à proprement parler et peut-être même pas de littérature. » Roland Barthes l'a noté dans Sollers écrivain : « celui-ci, pratique, de toute évidence, une écriture de vie. »
Raymond Alcovère
10:18 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philippe sollers, le secret
mardi, 14 janvier 2020
Anton Chekhov photographed by his brother Alexander, 1891

09:55 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tchekhov
jeudi, 03 octobre 2019
Ernest Hemingway : "Lettre à Ezra Pound"

"J'espère que tu accepteras ma médaille de prix Nobel. Je te l'envoie d'après le vieux principe chinois, principe que tu connais bien, selon lequel personne ne possède quelque chose avant de l'avoir donné à un autre." Ernest Hemingway : "Lettre à Ezra Pound"
10:44 Publié dans Chine, Histoire littéraire, illuminations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway, ezra pound
dimanche, 29 avril 2018
Ernest Hemingway in an ambulance of the Red Cross in Italy.

22:32 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway
vendredi, 09 mars 2018
Homère, ce féministe ! Andrea Marcolongo (Article du Point d'hier)
 Hélène, Andromaque, Nausicaa... Andrea Marcolongo, auteure de « La Langue géniale », évoque la profonde modernité des femmes de l'« Iliade » et de l'« Odyssée ».
Hélène, Andromaque, Nausicaa... Andrea Marcolongo, auteure de « La Langue géniale », évoque la profonde modernité des femmes de l'« Iliade » et de l'« Odyssée ».
Par Andrea Marcolongo (traduit par Anna Pia Filotico)
Il nous faudrait Proust, peut-être, pour nous expliquer combien nous sont contemporaines les femmes d'Homère. Car, quand on relit aujourd'hui l'Iliade et l'Odyssée, ce ne sont pas seulement Hélène, Andromaque ou Nausicaa qui renaissent sous nos yeux, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler la synchronie du féminin : toutes les femmes qui habitent en nous chaque jour – la fille, la mère, l'épouse, l'amante, l'amie – et que les femmes d'Homère savent incarner à la perfection. Ces femmes, c'est nous. Grâce à Homère, nous pouvons rassembler les fragments épars de notre féminité et redevenir la femme dans sa totalité ancestrale, comme le jour où nous sommes venues au monde.
Dans les poèmes homériques, c'est d'ailleurs la femme qui transforme le héros en être humain, l'ennemi en homme ; et elle le fait à travers l'amour. Je ne parle pas de la force et des passions surhumaines de divinités comme Athéna ou Aphrodite, mais de l'amour féminin dans toutes ses nuances – de la jalousie à la sagesse, de l'équilibre à l'éros, de la cruauté à la liberté. Les sentiments d'Hécube, l'épouse de Priam, de Circé, de Calypso sont réels, exactement comme les nôtres, et donc susceptibles de produire des effets aussi réels sur les hommes qu'elles aiment.
C'est donc la puissance de réalité des femmes d'Homère qui humanise – entre faiblesses, amours, fragilités, regrets – Hector, Pâris, Achille, Ulysse, et permettent aux poèmes homériques d'échapper au temps, parce qu'ils chantent tous les hommes et de tous les temps. Aujourd'hui, plus que tout, ils nous chantent nous, femmes et hommes si perdus dans notre présent. N'est-ce pas Virginia Woolf, encore une femme, qui a écrit que c'est vers le grec que « nous nous tournons quand nous en avons assez de l'imprécision, [et] de la confusion [...] de notre propre époque » (1) ?
Vie et honneur
Hécube, c'est la mère prévenante, comme les mères que nous avons connues et comme les mères que nous avons voulu devenir. Dans le livre VI de l'Iliade, elle exhorte son fils Hector à se reposer en lui offrant du vin. Le héros le refuse et court de nouveau au combat, ce que par ailleurs nous avons toujours fait, enfants, souvent gênés par la douceur des attentions maternelles. Hécube pleurera sa mort dans le livre XXIV, en l'appelant « de tous ses enfants le plus cher », et c'est en louant sa piété que la vieille mère trouve un peu de réconfort sur le cadavre de son fils, beau « comme une fleur qu'on vient de couper » (2).
Andromaque, c'est la femme et la mère complexes, aux sentiments intenses. Nous avons tous à l'esprit son effusion déchirante devant son mari Hector aux portes Scées, affligée par l'avenir de leur fils Astyanax, encore dans les langes et déjà destiné à grandir orphelin. Néanmoins, certains détails racontés par Homère font d'Andromaque une femme fière et absolument contemporaine. C'est elle, par exemple, qui suggère à Hector les meilleures tactiques à adopter dans la guerre, pour sauver la vie et l'honneur, démontrant ainsi une compétence militaire et une indépendance intellectuelle rares, mais aussi la nécessité d'avoir une relation de complicité avec son mari, pour qui elle est une amie et une conseillère. Hector et Andromaque représentent l'harmonie du couple, cette intimité pure que les Grecs exprimaient avec cette particularité grammaticale qu'est le duel [qui n'est ni le singulier ni le pluriel, et qui signale que les éléments dont on parle vont par deux, NDLR], qui fait de notre partenaire non seulement un père et un mari, mais avant tout un compagnon de vie et un allié dans ce monde. Dans le chant XXIV de l'Iliade, Andromaque pleure d'ailleurs la mort d'Hector en l'appelant simplement anêr, ce qui signifie d'abord « homme » – le sien, pour toujours.
Les tourments intérieurs d'Hélène
Sincère, ravissante, aimante et furieuse, Hélène est responsable de la chute de Troie. Sa guerre n'est cependant ni celle de Pâris, qui l'a enlevée, ni celle de son mari Ménélas, qui la réclame : son conflit est intérieur. Dans l'Iliade, loin de l'image de femme fatale qui l'a flétrie pour la postérité, Hélène maudit sa beauté dans les affres d'une fragilité toute féminine, jusqu'à se désigner sous le nom de « chienne ». Son attirance pour Pâris, cet amour aveugle et fou que chaque femme a vécu au moins une fois dans sa vie, se dissipe peu à peu, comme lorsque le feu de la passion s'éteint : Hélène reconnaît toute la médiocrité de son amant puéril, cet homme trop jeune à cause duquel elle a déclenché une guerre de dix ans. La capacité d'analyse psychologique d'Homère est profonde et le jugement d'Hélène à l'égard de Pâris implacable, comme lorsque nous nous demandons comment nous avons pu tomber amoureuse d'un homme qui ne vaut désormais plus rien à nos yeux.
« Que vous faites pitié, dieux jaloux, entre tous ! Ô vous qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit, au grand jour, le mortel que leur cœur a choisi comme compagnon de vie ! » (3). Ainsi la nymphe Calypso, dans l'Odyssée, vit l'inadmissibilité de son abandon par Ulysse, déterminé à la quitter, après sept ans d'amour, pour reprendre son voyage en direction d'Ithaque. Calypso est la femme trahie au plus profond d'elle-même, qui arrive à offrir tout ce qu'elle possède – jusqu'au don même de l'immortalité – à un homme qui ne la considère désormais que comme un problème, une pleurnicheuse qu'il va bientôt oublier – comme il a oublié sa femme Pénélope pendant toutes ces années. Calypso, c'est la douleur de la fin de l'amour ; ses larmes sont les nôtres et nous rappellent chacune des fois où nous avons été blessées, refusées, abandonnées.
Extraordinaire marquise de Merteuil semble en revanche être Circé, la magicienne, avec qui, pour la deuxième fois, Ulysse oublie Pénélope. Circé est peut-être la femme la plus transgressive d'Homère : après avoir ensorcelé les compagnons d'Ulysse, elle n'hésite pas à les transformer en porcs (hautement symbolique) pour vivre sans gêne sa passion, toute charnelle, pour le protagoniste de l'Odyssée. Circé est la séductrice que toutes les femmes savent être et sa solitude est le prix à payer pour un moment de sexe scandaleux, inavouable. Le sexe pour combler le vide d'une vie dans un somptueux palais, en attendant le prochain voyageur de passage... Aucune trace de l'amour sincère éprouvé par Calypso : c'est avec désinvolture et inconstance que Circé se débarrasse d'Ulysse.
Attraction
Pour conclure, un mot sur Nausicaa, la vierge, fille du roi des Phéaciens, qui accueille Ulysse le naufragé. Elle est la plus jeune des femmes chantées par Homère, et en même temps celle qui montre la plus grande maîtrise de soi, peut-être parce qu'elle n'est pas encore tombée amoureuse, mais vit dans l'attente poignante de ce premier amour. En Ulysse, l'étranger, elle voit l'homme qu'elle voudrait un jour à ses côtés ; mais elle sait aussi déchiffrer les dangers de cette attraction qui pourrait lui causer des regrets éternels. « Moi-même, je n'aurais que blâme pour la fille ayant cette conduite : quand on a père et mère, aller à leur insu courir avec les hommes, sans attendre le jour des noces célébrées ! » (4). Depuis toujours, Nausicaa a été considérée par les lecteurs comme une fille craintive à l'idée de décevoir père et mère. Mais la jeune fille d'Homère, en reconnaissant l'impossibilité de tomber amoureuse d'Ulysse, alourdi d'un passé qu'elle ne peut pas partager, est d'abord fidèle à elle-même et à la plénitude de l'amour qu'elle désire et prétend vivre.
Une grande femme contemporaine, la philosophe Simone Weil, a écrit sur la révélation grecque. Pour elle, le fil narratif des poèmes homériques est exclusivement celui de la force, qui transforme l'ennemi en vaincu, l'assiégé en conquis, le faible en esclave. Mais Simone Weil reconnaît également que, « dans une œuvre vraiment épique, la force obscure, le sort aveugle et le hasard gouvernent tout, à l'exception de ces rares instants où brillent, dans leur pureté, le courage et l'amour ». Et si cet amour est épique, il est aussi profondément humain, car exclusivement incarné par les femmes de l'Iliade et de l'Odyssée.
C'est donc la mémoire de nous-mêmes en tant que femmes qu'Homère nous a laissée en héritage. Un héritage mystérieux, jamais dissipé, mais qui, au contraire, redevient toujours contemporain et présent. Chaque jour, nous sommes à la fois Hécube, Andromaque, Hélène, Calypso, Circé ou Nausicaa. Synchroniquement.
« La Langue géniale. 9 bonnes raisons d'aimer le grec », d'Andrea Marcolongo, éd. Les Belles Lettres, 202 p., 16,90 euros.
(1) « De l'ignorance du grec », Virginia Woolf, in « Le commun des lecteurs » (L'Arche, p. 36-53).
(2) « Iliade », texte établi et traduit par Paul Mazon (Les Belles Lettres, XXIV, v. 748, p. 167).
(3) « Odyssée », texte établi et traduit par Victor Bérard (Les Belles Lettres, V, v. 116-120, p. 148-149).
(4) « Odyssée », op. cit., VI, v. 286-288, p. 179.
Andrea Marcolongo
Née en 1987 à Milan, diplômée de lettres classiques, tourne le dos à une carrière universitaire pour étudier les techniques de narration. Plume de Matteo Renzi pendant deux ans, elle étudie ensuite l'évolution des langues de l'ex-Yougoslavie.
Avec quinze rééditions, 200 000 exemplaires vendus dans la péninsule et des traductions dans dix langues, son ouvrage La langue géniale. 9 raisons pour aimer le grec est un phénomène d'édition. La version française est publiée par Les Belles Lettres. Son nouveau livre, La dimension héroïque vient de sortir en Italie.
09:19 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea marcolongo, homère
dimanche, 04 février 2018
Premier manuscrit d'Ulysse de Joyce
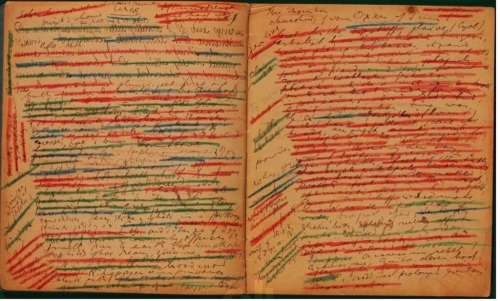
16:18 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, ulysse
lundi, 25 septembre 2017
George Orwell holds a puppy during the Spanish Civil War in 1937. Ernest Hemmingway can be seen in the background.

20:42 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges orwell, hemingway
dimanche, 02 juillet 2017
Hemingway
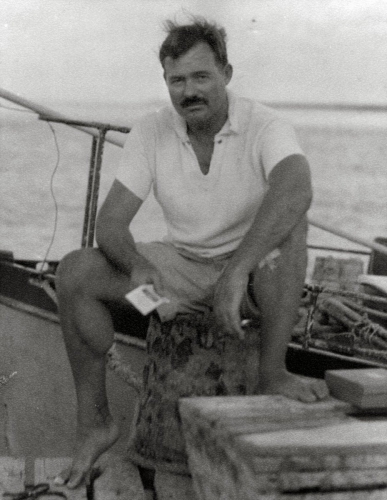 Il embrassa la mer d'un seul regard, et il se rendit compte de son infinie solitude.
Il embrassa la mer d'un seul regard, et il se rendit compte de son infinie solitude.
Ernest Hemingway (disparu le 2 juillet 1961)
14:16 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway
dimanche, 02 octobre 2016
Day of genius
 "Le 29 décembre 1819 est pour Stendhal un "day of genius". Il vient d'avoir l'idée de De l'amour."
"Le 29 décembre 1819 est pour Stendhal un "day of genius". Il vient d'avoir l'idée de De l'amour."
Philippe Sollers, Trésor d'amour, p. 29
18:45 Publié dans Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stendhal


















