samedi, 30 mai 2020
Reprise des ateliers d'écriture
 Les conditions sont maintenant réunies pour une reprise des ateliers d'écriture à mon domicile, en respectant les consignes sanitaires : dans le jardin, avec quatre personnes maximum par groupe.
Les conditions sont maintenant réunies pour une reprise des ateliers d'écriture à mon domicile, en respectant les consignes sanitaires : dans le jardin, avec quatre personnes maximum par groupe.12:30 Publié dans Atelier d'écriture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : atelier d'écriture
jeudi, 28 mai 2020
De grands arbres Cézanne dans le fond...
 Puis, après Marseille, j'ai essayé de faire du stop à travers la Provence, près d'Aix, où Cézanne a peint, ai fini par marcher pendant 30 kilomètres, mais ça valait le coup... me suis assis sur la pente des collines et j'ai fait des esquisses au crayon du pays de Cézanne, toits rouges rouille poussiéreux, collines bleues, pierres blanches, champs verts, n'a pas changé pendant toutes ces années... des fermes mauves et beiges dans de paisibles vallées fertiles de fermiers, rustiques, avec tuiles des toits d'un rose poudré délavé, une douceur verdâtre et grise, les voix de filles, des meules de foin grises, un jardin crayeux fertilisé de crottin de cheval, un cerisier blanc en fleurs (avril), un coq chantant doucement au milieu du jour, de grands arbres Cézanne dans le fond... etc.
Puis, après Marseille, j'ai essayé de faire du stop à travers la Provence, près d'Aix, où Cézanne a peint, ai fini par marcher pendant 30 kilomètres, mais ça valait le coup... me suis assis sur la pente des collines et j'ai fait des esquisses au crayon du pays de Cézanne, toits rouges rouille poussiéreux, collines bleues, pierres blanches, champs verts, n'a pas changé pendant toutes ces années... des fermes mauves et beiges dans de paisibles vallées fertiles de fermiers, rustiques, avec tuiles des toits d'un rose poudré délavé, une douceur verdâtre et grise, les voix de filles, des meules de foin grises, un jardin crayeux fertilisé de crottin de cheval, un cerisier blanc en fleurs (avril), un coq chantant doucement au milieu du jour, de grands arbres Cézanne dans le fond... etc.08:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul cézanne, jack kerouac
mardi, 26 mai 2020
Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête
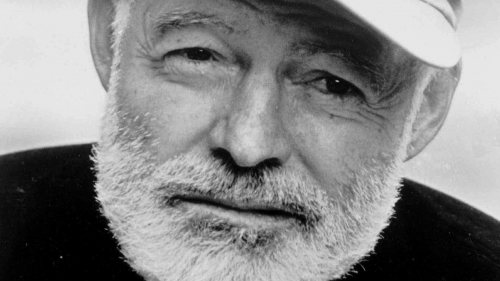 Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.
Pour les faits marquants de mon existence reportez-vous donc au Who’s’ Who. J’habite Finca Vigia, dans le village de San Francisco de Paula, à Cuba. Le travail ? J’écris là où je me trouve, à l’hôtel, dans ma chambre, sur une table de café, les premières heures de la matinée étant toujours les plus favorables. Debout à l’aube, je me mets au travail aussitôt. Black Dog, un épagneul importé de Ketchum, dans l’Idaho, dressé à faire lever le gibier, est le plus vigilant gardien de mes horaires. Trois chats l’assistent dans cette tâche, Boise A -, Friendless’s Brother, Ecstazy. Princessa, pur persan gris, m’a souvent été d’un grand secours ; elle est morte voici trois semaines. Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait si Black Dog ou Boise venaient à disparaître. Je me ferais une raison, sans doute, et tout continuerait comme avant.
Vers midi, je m’arrête. Je prends un verre et plonge dans la piscine. Après le repas, si le travail de la matinée a été assez fructueux pour me laisser la conscience tranquille, je m’offre une sortie en mer et passe l’après-midi à pêcher dans le Gulf Stream.
Dans ma jeunesse, je m’en souviens, je pouvais avaler n’importe quel bouquin. J’ai vieilli, les policiers m’assomment sauf quand ils sont de Raymond Chandler. Je lis surtout des biographies, des récits de voyages, à condition qu’ils offrent un certain caractère d’authenticité, et des textes consacrés à la science militaire. Qu’ils soient bons ou mauvais, vous n’aurez pas perdu votre temps et leur lecture vous apprendra toujours quelque chose.
Ces derniers temps, ce n’était pas une mince affaire que de dénicher des nouveaux romans qui ne vous tombent pas des mains. J’en ai lu quelques-uns, malgré tout. Cette rentrée, espérons-le, sera le signal d’une année plus faste. Je lis aussi le Morning Telegraph, si je le trouve, le New York Times et le Herald Tribune. Je suis abonné à trois publications françaises, à quelques hebdomadaires italiens, à une revue mexicaine, Cancha. Je lis la presse tauromachique lorsque mes amis espagnols songent à me l’envoyer. Je feuillette un tas de choses, depuis Harpers jusqu’à The Atlantic, en passant par Holiday, Field and Stream, Sports Airfield, True, Time, Newsweek, Southern Jesuit. Je lis aussi le Saturday Evening Post lorsqu’il publie un feuilleton d’Ernest W. Haycox, deux ou trois journaux cubains, quelques revues littéraires d’Amérique latine. Il convient d’ajouter à cette pile deux revues anglaises : Sport and Country et The Field.. N’oublions pas les quelques livres français que m’envoie Jean-Paul Sartre, et les italiens. J’en lis plusieurs tous les ans, parfois même à l’état de manuscrits, afin de repérer ceux qui me paraissent publiables.
Venons-en à la correspondance ; j’entretiens des relations épistolaires suivies avec un officier supérieur en activité, ainsi qu’avec un général anglais à la retraite que j’ai connu en Italie lorsque nous étions, lui et moi, beaucoup plus jeunes. J’ai, avec trois de mes amis, un échange de lettres régulier. Pour le reste, ce n’est que courrier professionnel ou administratif.
Je ne joue jamais, si ce n’est pour gagner.
Invités par Mary, maçons, peintres et plâtriers ont envahi la maison. Voilà un excellent prétexte pour passer le plus clair de mon temps en mer, en attendant que le calme revienne. Conséquence indirecte de ce qui précède, je me remets d’une mauvaise chute, sur un pont glissant un jour de mer démontée. Le résultat fut une vilaine blessure derrière la tête, un traumatisme crânien, une artère sectionnée. J’ai attendu cinq ou six heures avant de pouvoir être conduit à l’hôpital. Par bonheur, naviguant dans les parages, se trouvait Roberto Herrera, un vieil ami qui a fait cinq années de médecine. Alerté par nos signaux de détresse, il nous a rejoints en toute hâle. Aidé de Mary, il a pu arrêter l’hémorragie ; son frère José Luis a terminé le travail. Cette année encore, il me faut renoncer au ski. Il me reste la natation, la marche, la chasse, la pêche, et le travail. Autant de plaisirs que José Luis m’a vivement déconseillés.
Soit dit en passant, je commence à être fatigué de prendre des coups sur la tête. Ça a débuté en 1918 puis recommencé en 1944-1945 et je me garderais d’oublier deux blessures vénielles en 1943. Si j’ai le malheur de me plaindre, je m’entends répliquer que ces désagréments sont le résultat de mon imprudence. Rien n’est plus faux, pour autant que je m’en souvienne...
Hemingway, Autoportrait 1950
19:18 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway
Humour proustien
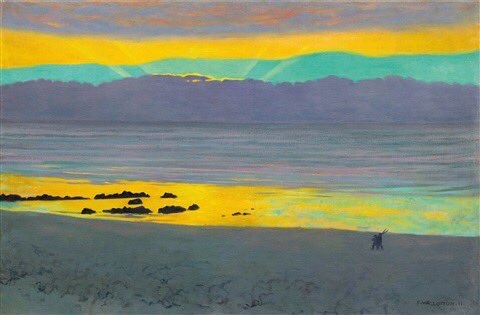 —«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»
—«Ah! est-ce que vous connaissez quelqu’un à Balbec? dit mon père. Justement ce petit-là doit y aller passer deux mois avec sa grand’mère et peut-être avec ma femme.»
Legrandin pris au dépourvu par cette question à un moment où ses yeux étaient fixés sur mon père, ne put les détourner, mais les attachant de seconde en seconde avec plus d’intensité—et tout en souriant tristement—sur les yeux de son interlocuteur, avec un air d’amitié et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversé la figure comme si elle fût devenue transparente, et voir en ce moment bien au delà derrière elle un nuage vivement coloré qui lui créait un alibi mental et qui lui permettrait d’établir qu’au moment où on lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un à Balbec, il pensait à autre chose et n’avait pas entendu la question. Habituellement de tels regards font dire à l’interlocuteur: «A quoi pensez-vous donc?» Mais mon père curieux, irrité et cruel, reprit:
—«Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là, que vous connaissez si bien Balbec?»
Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction, mais, pensant sans doute qu’il n’y avait plus qu’à répondre, il nous dit:
—«J’ai des amis partout où il y a des groupes d’arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique un ciel inclément qui n’a pas pitié d’eux.
—«Ce n’est pas cela que je voulais dire, interrompit mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel. Je demandais pour le cas où il arriverait n’importe quoi à ma belle-mère et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissez du monde?»
—«Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, répondit Legrandin qui ne se rendait pas si vite; beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les choses elles-mêmes y semblent des personnes, des personnes rares, d’une essence délicate et que la vie aurait déçues. Parfois c’est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin où il s’est arrêté pour confronter son chagrin au soir encore rose où monte la lune d’or et dont les barques qui rentrent en striant l’eau diaprée hissent à leurs mâts la flamme et portent les couleurs; parfois c’est une simple maison solitaire, plutôt laide, l’air timide mais romanesque, qui cache à tous les yeux quelque secret impérissable de bonheur et de désenchantement. Ce pays sans vérité, ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, ce pays de pure fiction est d’une mauvaise lecture pour un enfant, et ce n’est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami déjà si enclin à la tristesse, pour son cœur prédisposé. Les climats de confidence amoureuse et de regret inutile peuvent convenir au vieux désabusé que je suis, ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n’est pas formé. Croyez-moi, reprit-il avec insistance, les eaux de cette baie, déjà à moitié bretonne, peuvent exercer une action sédative, d’ailleurs discutable, sur un cœur qui n’est plus intact comme le mien, sur un cœur dont la lésion n’est plus compensée. Elles sont contre-indiquées àvotre âge, petit garçon. Bonne nuit, voisins», ajouta-t-il en nous quittant avec cette brusquerie évasive dont il avait l’habitude et, se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation: «Pas de Balbec avant cinquante ans et encore cela dépend de l’état du cœur», nous cria-t-il.
Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions, ce fut peine inutile: comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes un labeur et une science dont la centième partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable, M. Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous avouer qu’à deux kilomètres de Balbec habitait sa propre sœur, et d’être obligé à nous offrir une lettre d’introduction qui n’eût pas été pour lui un tel sujet d’effroi s’il avait été absolument certain,—comme il aurait dû l’être en effet avec l’expérience qu’il avait du caractère de ma grand’mère—que nous n’en aurions pas profité.
Du côté de chez Swann
Felix Vallotton
08:58 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, félix vallotton
lundi, 18 mai 2020
La Comédie humaine (Balzac)
 « Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...
« Nous sommes tous des personnages balzaciens », a écrit Scutenaire ; peut-on lui faire un plus bel hommage ? Il a conçu le principe de la Comédie humaine comme unité alors que la moitié était déjà écrite. Son rythme d’écriture et de vie était hallucinant : « je me couche à six heures du soir ou à sept heures comme les poules ; on me réveille à une heure du matin et je travaille jusqu’à huit heures ; à huit heures, je dors encore une heure et demie ; puis je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur et je m’attelle à mon fiacre jusqu’à quatre heures ; je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. » Et aussi : « Comment voulez-vous que j’ai le temps d’observer, j’ai à peine le temps d’écrire. » Ses amours avec Mme Hanska sont désolantes. Même après la mort de son mari, elle le fait attendre encore neuf ans. Il meurt tout de suite après leur mariage. Et elle s’est servie de lui après sa mort. Il n’empêche, son œuvre est un défi au temps, à tous les temps : « Toute personne qui pense fortement fait scandale. » « Un homme qui se vante de ne jamais changer d’opinion est un homme qui se charge d’aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibilité. Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances : l’homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S’il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n’en changeraient pas comme nous changeons de chemises. » « La charité doit être aussi savante que le vice. » Et aussi : « Vouloir bien élever un enfant, c'est se condamner à n'avoir que des idées justes. » Le début de Sarrasine est somptueux : « J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l’horloge de l’Elysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse Danse des morts. Puis, en me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! Un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de diamants ! Des fleurs sur la tête, sur le sein, dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à leurs pieds. C’était de légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants, et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu, le retentissement de l’or se mêlaient à la musique, au murmure des conversations ; pour achever d’étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séductions, une vapeur de parfums et l’ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi à ma droite la sombre et silencieuse image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si disparates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique, je faisais une macédoine morale, moitié plaisante, moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. » « Oh ! Errer dans Paris ! Adorable et délicieuse existence ! Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil. » Sa statue par Rodin, boulevard Raspail, est un des points focaux autour desquels tourne Paris...
Raymond Alcovère
19:21 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac, comédie humaine
dimanche, 17 mai 2020
Tragique vendredi 13
 Au temps de la marine à voile, aucun capitaine n’aurait eu l’idée d’appareiller un vendredi 13, mais nous sommes en 2012, et ces vieilles superstitions sont dépassées. On commémore cette année-là le centenaire du naufrage du Titanic, mais ça aussi c’est le hasard.
Au temps de la marine à voile, aucun capitaine n’aurait eu l’idée d’appareiller un vendredi 13, mais nous sommes en 2012, et ces vieilles superstitions sont dépassées. On commémore cette année-là le centenaire du naufrage du Titanic, mais ça aussi c’est le hasard.
Pourtant, ce vendredi 13 janvier 2012, au moment où le paquebot Costa Concordia quitte le port de Civitavecchia, comme le Titanic en son temps, il accumule les superlatifs et les chiffres vertigineux. Un des plus grands bateaux de croisière d’Europe, surnommé « le temple du luxe et du divertissement ». Haut de treize étages, il emporte 4 252 passagers. 1 500 cabines, quatre piscines, cinq restaurants, treize bars et un centre thermal parmi les plus fastueux au monde, un casino, un atrium de huit ou neuf étages, de quoi donner le vertige…
Et puis, nous sommes bien loin de l’Atlantique nord, pas d’iceberg en vue en Méditerranée occidentale, de plus le paquebot suivra le plus souvent les côtes. Sept escales en sept jours, départ de Civitavecchia en Italie pour atteindre Savona, puis ce seront Marseille, Barcelone, Palma de Majorque, Cagliari, Palerme et retour.
Il a fière allure ce Concordia et il est presque neuf, baptisé en 2006. La cérémonie, il est vrai, avait été marquée par un incident : la bouteille de champagne, lancée par la top-modèle Eva Herzigova, ne s’est pas brisée, un signe de mauvais sort pour les marins mais bien vite oublié.
Le navire a quitté Civitavecchia à 19 H. Il est 21 h, Francesco Schettino se mêle aux passagers. A 51 ans, il est un des plus jeunes capitaines naviguant pour les croisières Costa. Tout le monde le trouve avenant et sympathique.
Des exercices d’évacuation sont effectués toutes les deux semaines. Les règlements internationaux imposent en outre que les passagers participent à un exercice de sécurité dans les 24 heures qui suivent leur embarquement. Afin de montrer les lieux où, en cas d’urgence, se trouvent les canaux de sauvetage. Sur le Concordia, ils sont disposés sur le côté du pont 4, sur toute la longueur. Le prochain exercice est prévu pour le lendemain.
Il est 21 H 40 ; après avoir dîné, le capitaine est présent sur le pont. Le navire suit un cap nord ouest entre l’île de Giglio et la côte, sa route prévue doit le faire passer au milieu du chenal d’une vingtaine de kilomètres, où l’eau est la plus profonde. Mais en s’approchant de Giglio, le navire change de cap pour se diriger vers l’île.
Le 14 août 2011, le même Concordia est passé à proximité de l’île, à environ 250 mètres de la côte. Il s’agissait d’une dérogation exceptionnelle à la règle de la compagnie, qui interdit à ses commandants de naviguer à moins de 500 mètres du littoral. Le paquebot devait saluer le festival : cette manœuvre appelée « inchino » (révérence ou salut d’honneur) a été effectuée en concertation avec les garde-côtes. Elle a été encore plus spectaculaire d’ailleurs pour les habitants de l’île que pour les passagers du bateau, celui-ci naviguant tous feux allumés et faisant résonner sa corne de brume.
Ce vendredi 13 janvier 2012, Francesco Schettino décide de faire un nouvel « inchino » devant Giglio. Le temps est superbe, et la route semble sûre puisque le Concordia l’a déjà empruntée.
Mais contrairement au 14 août, le bateau s’approche de beaucoup plus près de la côte, à la frôler. Il la frôle tellement qu’à 21 H 42, il heurte un rocher par bâbord, provoquant une déchirure sur la coque. A bord, le choc est immédiatement ressenti. Les passagers entendent une détonation, un bang, un grincement sinistre. Le bateau se met à vibrer, les chaises glissent, des passagers s’agrippent aux tables. Des verres, des bouteilles tombent, toutes les portes s’ouvrent. Début de panique. Dans la salle de restaurant, les serveurs courent après leurs chariots renversés.
Et puis surtout le bateau se met à pencher. En cas de gros temps, ou de tempête, c’est fréquent, mais il se rétablit tout de suite puis penche de l’autre côté. Là il reste du même côté, et puis il y a eu ce bruit inquiétant. Les personnels d’animation (danseurs et musiciens), eux ont l’habitude du navire, se regardent : ça a l’air étrange. Ils ont reçu l’instruction de ne pas bouger sans l’ordre du capitaine. Certains appellent leurs proches à terre. D’autres attendent, on ne leur a pas dit d’enfiler leurs gilets de sauvetage
Puis dix minutes après le choc, toutes les lumières s’éteignent. Tout de suite, un message rassurant est diffusé par les hauts-parleurs : Il s’agit d’une panne d’électricité, aucune allusion à un quelconque choc, les techniciens sont en train de réparer, on demande à chacun de rester calme. Aussi beaucoup de passagers, rassérénés, attendent tranquillement.
15 minutes après le choc, le bateau continue d’avancer en s’éloignant de l’île de Giglio. Le capitaine Schettino par radio prévient sa compagnie qu’il y a un problème, sans préciser lequel. Pendant ce temps, l’équipage ne reste pas inactif bien sûr, il tente d’évaluer les dégâts.
Ils sont gravissimes ! Les rochers ont ouvert une entaille gigantesque de 50 mètres dans le flanc bâbord du navire. Les ponts inférieurs d’un paquebot moderne sont divisés en 7 compartiments étanches ; les bateaux sont conçus pour rester à flot, même si deux compartiments sont ouverts ; mais comme si on revivait la tragédie du Titanic, ce ne sont pas deux mais trois compartiments qui sont éventrés.
Danger : la brèche laisse entrer l’eau dans la salle des machines. Alors, le bateau vire vers la côte pour réduire la distance qui le sépare de la terre ferme, et faciliter le sauvetage. Dans toute crise, les premières secondes sont importantes. Le commandant, dès l’impact, aurait dû diriger les passagers vers les canots. Or personne n’est informé de l’imminence d’une procédure d’urgence. Le bateau s’incline de plus en plus. Des gens commencent à descendre les escaliers avec leurs gilets de sauvetage. Car les ascenseurs sont en panne.
Pourtant, le problème est jugé si sérieux que, à 22 H le navire fait demi-tour pour se diriger vers l’île de Giglio, terre la plus proche alors que le continent est plus éloigné.
A 150 kilomètres de là, sur la côte italienne, les garde-côtes sont prévenus de la situation, mais pas par le capitaine. Par des passagers inquiets qui appellent avec leurs téléphone portables leur famille, des proches, certains la police. Les informations sont immédiatement transmises aux garde-côtes de Livourne.
La confusion s’installe à bord. Des centaines de passagers commencent à se rassembler sur le pont 4, là où on accède aux canots de sauvetage. Arrivés là, le message que leur délivre l’équipage est : « Nous avons une annonce de la part de notre capitaine : nous vous demandons de retourner dans vos cabines ou si vous préférez, vous pouvez rester dans les salons. Une fois que nous aurons arrangé le problème électrique de notre génératrice, tout ira bien. C’est la raison pour laquelle les éclairages de sécurité sont allumés. Tout est sous contrôle. »
En réalité, la situation est très loin d’être sous contrôle. Or, comme de nombreuses études l’ont montré, dans une circonstance comme celle-là, si on cache des informations fondamentales, cela ne peut mener qu’à la confusion et rendre les passagers trop sûrs d’eux.
Le navire s’approche de l’île. Problème, le Concordia est beaucoup trop grand pour entrer dans le port. Les garde-côtes appellent le navire. « Avez-vous des problèmes à bord ? » « Oui, affirmatif, nous avons une panne de courant. Nous vérifions ce qui se passe. » « Un proche d’un membre de l’équipage a appelé la police pour leur dire que plein de choses étaient tombées pendant le dîner. » « Non, négatif, nous avons une panne de courant et nous vérifions la situation à bord. Nous vous tiendrons informés. » Les garde-côtes appellent alors le capitaine. Même réponse : « la situation est sous contrôle » ; leitmotiv de plus en plus dérisoire.
Le bateau penche maintenant de près de 20 degrés à bâbord. Finalement le capitaine décide de déclencher l’alerte générale. Les passagers doivent se rassembler sur le pont pour embarquer sur les canots, mais ils n’ont pas tous eu l’occasion de faire un exercice d’évacuation. Alors qu’arrive-t-il ? Les gens commencent à courir dans tous les sens, à avoir vraiment peur. Ce qui est inquiétant, c’est le visage des membres de l’équipage, totalement choqués : manifestement ils sont dépassés par les événements. Quelque chose ne tourne pas rond. Personne ne s’attendait à une chose pareille. Un si beau paquebot, si grand, si fier d’allure, si solide…
Les techniciens et certains membres de l’équipage eux savent que c’est grave, qu’il va falloir évacuer très vite. Les messages dans les hauts parleurs invitent les passagers à rejoindre le pont 4, on répète en boucle que la situation est sous contrôle. La brèche s’étend sur trois compartiments. L’eau s’engouffre et on ne peut plus rien faire. Le pont zéro est inondé, ce qui signifie que le bateau est en train de couler. L’eau pénètre maintenant sur les ponts ouverts au public, au niveau du sol pour le moment mais c’est effrayant.
C’est alors que le navire va heurter le fond une seconde fois, à 22 h 48. Le bateau de 300 mètres de long vient de se poser sur un récif. Et il n’en bougera plus jamais. Au moment du choc, le bâtiment bascule violemment vers tribord. A 22 H 58, l’appel résonne : il faut évacuer. Un vent de panique souffle aussitôt. Abandonner un navire peut être très dangereux. Monter à bord des canots de sauvetage, faire monter les passagers, descendre les embarcations, c’est toujours très compliqué en situation réelle.
Pendant ce temps, les garde-côtes envoient deux hélicoptères de sauvetage sur place. Temps de vol estimé : cinquante minutes.
Il fait complètement noir dans le bateau, tout le monde crie, on pense au Titanic, qui n’a pas vu ce film ? La panique commence quand on ouvre les portes pour atteindre les canots de sauvetage. Entre temps, le navire s’est penché encore plus fort, dans la direction opposée. Des centaines de personnes commencent à s’entasser dans les canots, se bousculent.
Les premières embarcations sont à la mer, mais des milliers de personnes toujours à bord. Quand un bateau penche autant, mettre des canots à l’eau est extrêmement difficile. Ils sont conçus pour descendre jusqu’à un angle de vingt degrés, angle largement dépassé ici. Aussi, en descendant, ils heurtent la balustrade du pont, augmentant la frayeur.
Certaines personnes ne peuvent pas les atteindre, appellent leurs proches par téléphone, pour leur dire au revoir, au cas où ils ne les reverraient jamais. Le navire lentement s’enfonce dans l’eau.
A 23 H 30, les deux hélicoptères s’approchent de l’île de Giglio. Ils s’attendaient à voir un navire un peu penché, tous feux allumés, qui continue à avancer. Ils ont beau s’approcher, fouiller du regard l’horizon avec leurs lunettes à infrarouge, rien ! Quand ils le découvrent enfin, stupeur : le Costa Concordia est presque couché dans l’eau et complètement échoué.
A l’intérieur, des centaines de passagers cherchent toujours une issue, plus aucun canot de sauvetage n’est utilisable. Les gens glissent, tombent partout, c’est l’épouvante maintenant. Manifestement l’évacuation n’est pas coordonnée du tout, les passagers ont complètement perdu confiance, c’est la pire situation. Ils voient le niveau de l’eau monter sans cesse. On entend le bruit de l’acier qui se déchire. Des passagers, comprenant qu’il n’y a pas d’autre issue, sautent à la mer. 
L’eau atteint le pont 3 à cause de l’inclinaison du bateau. Les hélicos tournent autour. Ils aperçoivent deux passagers qui sont montés le plus haut possible du bateau pour échapper aux flots. Un des membres de l’équipage descend à l’aide d’un treuil et réussit à les sauver en les remontant.
Il est 1 H 46 du matin, quatre heures se sont écoulées depuis que le Concordia a heurté le premier rocher. Des centaines de passagers sont toujours à bord. A Livourne, De Falco, le commandant des garde-côtes appelle le capitaine par radio. Mais Schettino n’est pas sur le pont, il est sur un canot de sauvetage !
– Ici De Falco, je vous appelle de Livourne, suis-je en train de parler au Capitaine ?
- Oui bonsoir, commandant De Falco.
- Donnez-moi votre nom ?
- Je suis le capitaine Schettino, commandant.
- Ecoutez Schettino, il y a des gens bloqués à bord. Donc, avec votre canot de sauvetage, vous devez rejoindre la proue du côté tribord. Là il y a une échelle de corde. Vous grimpez à cette échelle et vous remontez à bord. Et vous me direz combien de personnes se trouvent toujours là. Est-ce clair ? J’enregistre la conversation, capitaine Schettino.
- Commandant, laissez-moi vous dire quelque chose.
- Parlez plus fort !
La voix du capitaine devient inaudible. De Falco commence à s’énerver en demandant à nouveau à son interlocuteur de parler devant le micro. Schettino répond enfin :
- Pour l’instant le bateau est en train de pencher.
- Je comprends. Ecoutez, il y a des gens qui descendent de la proue par l’échelle de corde. Vous devez monter par cette échelle, retourner sur le bateau et me dire le nombre exact de personnes dans chaque catégorie. Est-ce clair ? Vous devez me dire s’il y a des enfants, des femmes ou des gens qui ont besoin d’assistance. Ecoutez Schettino, vous avez peut-être sauvé votre vie, mais je ne vois vraiment pas ça d’un très bon oeil. Je vais vous faire payer ça. Remontez à bord !
Interrogé plus tard, Nick Bates, ancien capitaine du Queen Elizabeth II, dira : « pendant toute ma carrière en mer, jamais je n’ai entendu une personne parler à un capitaine de cette façon. Mais je pense que le type des garde-côtes s’est rendu compte que le capitaine était peut-être sur le point de craquer ; la pression, la tension étaient telles qu’il fallait lui parler d’une manière extrêmement ferme et positive, pour le faire réagir. »
La conversation qui a été enregistrée donc, continue :
- Que faites-vous capitaine ?
- Je suis ici pour coordonner les secours.
- Que coordonnez-vous là ? Remontez à bord ! Coordonnez les secours depuis le bateau. Refusez-vous de le faire ?
- Non, je ne refuse pas.
- Refusez-vous de remonter à bord, capitaine ? Pouvez-vous me dire pour quelle raison vous n’y allez pas ?
- Je n’y vais pas parce que l’autre canot de sauvetage est arrêté.
- Remontez à bord, c’est un ordre ! Ne cherchez pas d’autres excuses. Vous avez annoncé l’abandon du navire. Maintenant, c’est moi qui commande. Vous remontez à bord. Est-ce clair ? Et appelez-moi quand vous y êtes. Mon équipe de secours aérien est là.
- Où sont vos secouristes ?
- Ils sont sur la proue. Allez-y ! Il y a déjà des corps, Schettino, allez-y !
- Combien de corps y-a-t-il ?
- Je ne sais pas. J’ai entendu parler... Vous êtes la personne qui devez me dire combien il y en a, bon sang !
- Mais vous réalisez qu’il fait noir ici et qu’on ne voit rien ?
- Et alors Schettino, vous voulez rentrer à la maison ?
Le commandant De Falco fulmine, il réitère ses instructions une dernière fois. Mais rien ne prouvera ensuite que le capitaine Schettino ait tenté de remonter à bord. Au petit matin, après cette conversation, sur l’île de Giglio, il prend un taxi jusqu’à un hôtel où il donne une interview à une télévision italienne. Il y affirme avoir quitté le navire en dernier et que « pratiquement » tous les passagers ont été sauvés.
Mais pendant ce temps, des centaines de personnes risquent toujours leur vie. Il est 4 h 35 du matin. Echoué sur son récif, le Costa Concordia est presque à l’horizontale. A l’aube, les premières lueurs du jour permettent aux équipes de secours d’entrer dans le bateau. Des plongeurs vont explorer la partie engloutie du navire. Ils découvrent un chaos inimaginable, des objets éparpillés partout.
Le capitaine est arrêté. Son employeur, les croisières Costa, rejettent immédiatement toute la responsabilité de la catastrophe sur lui. Les avocats du capitaine affirment eux que c’est la compagnie qui a demandé à Schettino de faire un salut devant l’île, une sorte de manœuvre publicitaire.
Les procédures judiciaires sont en cours. La tragédie a fait 30 morts, et deux corps n’ont toujours pas été retrouvés. Et quantité de survivants resteront à jamais traumatisés par ce qu’ils ont vécu dans ce « temple du luxe et du divertissement ».
Raymond Alcovère
Extrait de "Histoires vraies en mer Méditerranée", Papillon Rouge éditions, 2013
03:55 Publié dans Histoires vraies en Mer Méditerranée | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costa concordia, histoires vraies en mer méditerranée
samedi, 16 mai 2020
Paul Valéry, « il avait tué la marionnette »
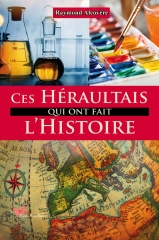 Paul Valéry s'excusait : « Je vous reçois un peu débraillé. C'est que j'étais en train de réfléchir. » Tous les jours, pendant près de cinquante ans, de 4 heures à 7 heures du matin, il écrit ses Cahiers, que Roger Nimier appelle « le grand travail matinal de toute sa vie ». Selon Paul Claudel, il n'était pas un « pur intellectuel » mais « avant tout un voluptueux ». Alors qu'en est-il de ce personnage complexe, un des plus grands esprits de son temps ?
Paul Valéry s'excusait : « Je vous reçois un peu débraillé. C'est que j'étais en train de réfléchir. » Tous les jours, pendant près de cinquante ans, de 4 heures à 7 heures du matin, il écrit ses Cahiers, que Roger Nimier appelle « le grand travail matinal de toute sa vie ». Selon Paul Claudel, il n'était pas un « pur intellectuel » mais « avant tout un voluptueux ». Alors qu'en est-il de ce personnage complexe, un des plus grands esprits de son temps ?
« Je suis né dans un de ces endroits où j'aurais aimé naître. » Paul Valéry ne tarit pas d'éloges sur Sète, l'île singulière où il voit le jour le 30 octobre 1871. La mer, près de laquelle il est né, le hantera toute sa vie : « Il n'est pas de spectacle pour moi qui vaille ce que l'on voit d'une terrasse ou d'un balcon bien placé au-dessus d'un port. » Il rêvera d'être marin, et toute sa vie, adorera nager.
Son père, d'origine corse, est vérificateur principal des douanes, et sa mère, génoise, fille du consul d'Italie. Il entame ses études chez les Dominicains, les poursuit au lycée de Montpellier puis s’inscrit à la faculté de Droit en 1889. Passionné par les mathématiques et la musique, il écrit aussi de la poésie ; ses premiers poèmes sont publiés dans la Revue maritime de Marseille.
Il devient l'ami de Pierre Louÿs, futur auteur de La Femme et le Pantin, qui lui fait connaître André Gide ; tous les trois se promènent à Palavas et au Jardin des Plantes de Montpellier, où on peut lire encore les mots du poète : « Nous irons doucement par les ruelles fort pierreuses et tortueuses de cette vieille ville à cet antique jardin où tous les gens à pensées, à soucis et à monologues descendent vers le soir. »
C’est alors qu’il va connaître sa fameuse Nuit de Gênes, du 4 au 5 octobre 1892 : une nuit d’orages et d’insomnie qui le bouleverse et dont il sort résolu à « répudier les idoles de la littérature, de l’amour et de l’imprécision. » Désormais, il se consacrera essentiellement à « la vie de l'esprit ».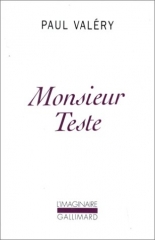
En 1894, il s’installe à Paris où il travaille comme rédacteur au Ministère de la Guerre. Mais c’est à Montpellier, au 9 rue de la Vieille intendance, « dans une chambre où Auguste Comte a passé ses premières années » qu’il écrit Monsieur Teste. Pour Borges, ce personnage est «peut-être la plus extraordinaire invention des lettres contemporaines.» Même s’il l’a souvent nié, Valéry n'a jamais pu se défendre d'avoir peint un autoportrait. Sa créature, en effet, l'a accompagné toute sa vie.
En 1900, il épouse Jeannine Gobillard, nièce de Berthe Morisot. Trois enfants naissent, qui le montrent bon père et bon époux. Autre changement, il trouve un emploi de secrétaire particulier auprès du publiciste Édouard Lebey, directeur de l’agence Havas où il restera plus de vingt ans. Il semble s'être éloigné de la littérature mais a déjà commencé la rédaction de ces Cahiers qui ne seront publiés qu’après sa mort. Il y consigne quotidiennement l’évolution de sa conscience et de ses rapports au temps, au rêve et au langage.
Depuis toujours admirateur de Mallarmé, Paul Valéry devient un des fidèles des « mardis » du poète. Lui-même revient à la poésie seulement en 1917, sous l’influence d’André Gide notamment, avec la publication de La Jeune Parque, dont le succès est immédiat ; suivront ses autres grands poèmes (Le Cimetière marin, en 1920) ou recueils poétiques (Charmes, en 1922).
Ces années coïncident avec ce que Cocteau appellera une première « grêlée d'honneurs ». Il multiplie les conférences, voyages officiels et communications de toute sorte ; en 1924, il remplace Anatole France à la présidence du Pen Club français, puis lui succède à l’Académie française où il est élu le 19 novembre 1925.
Ses centres d’intérêt sont multiples ; l'art sous toutes ses formes, en particulier la peinture et la danse, mais aussi la science exercent sur lui une véritable fascination. Il fréquente assidûment les grands savants de son temps, visite leurs laboratoires, se tient informé des recherches de pointe dans toutes les disciplines. Avec toujours cet objectif : mieux connaître le fonctionnement de l'esprit humain, parvenir à analyser les opérations mentales qui sont à l'origine de la création littéraire, artistique et scientifique.
Le Journal de Gide est amusant, on y trouve ce genre de notations : « Après-midi avec P.V. Longue conversation qui me laisse fourbu. » « Paul m’invite à dîner. Rentré très tard, épuisé. » « Plaisir intense de revoir V., entre deux trains. Mais je repars brisé, la tête en feu. »
Cet homme en apparence froid et réservé qui a écrit « nos plus importantes pensées sont celles qui contredisent nos sentiments. » vit une folle histoire d’amour avec Jeanne Loviton, dite Jean Voilier : entreprenante et libre, elle est aussi une grande séductrice. Dominique Bona décrit ainsi Valéry : « Fragile, anxieux, désespéré et sombre, tout entier dépendant de celle qu'il appelle « Mon terrible toi, mon amour », l'auteur des innombrables Cahiers, exercices d'intelligence, archétypes de l'esprit de raison, de volonté et de maîtrise, avait donc un cœur et il suffit de lire les extraits des quelque mille lettres que Valéry a écrites à Jean Voilier pour comprendre que ce cœur battait. Encore plus fort que pour Catherine Pozzi, son précédent amour, car sa passion pour Jean Voilier est aussi la dernière. « Tu sais bien que tu étais entre la mort et moi. Mais hélas il paraît que j'étais entre la vie et toi. »
Avec Valéry - sa poésie en témoigne - le cérébral ne s'éloigne jamais de la matière, du corps, du cœur, ils s'accordent. Toute sa vie, il s'attachera à l'intention qui le gouverne : tous les jours créer, se créer, s'arracher au nombre, aux fluctuations de la mode. Pour lui, l'art modifie la perception du monde et contribue à la création de soi, comme la lecture des grands livres. Il s'invente sans cesse, faisant de l'écriture l'instrument principal pour atteindre une grande liberté intérieure. Et il adorait les pirouettes, les pieds-de-nez comme : « Un homme sérieux a peu d'idées. Un homme à idées n'est jamais sérieux. » Ou encore : « Je suis aussi sociable en surface, et facile en relation, que séparatiste en profondeur. »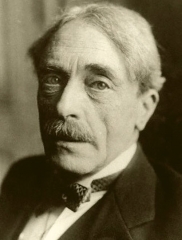
Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, Paul Valéry s’oppose vivement à la proposition d’Abel Bonnard qui voulait que l’Académie adresse ses félicitations au maréchal Pétain pour sa rencontre avec Hitler à Montoire. Directeur de l’Académie en 1941, il prononce l’éloge funèbre de Bergson et son discours est salué par tous comme un acte de courage et de résistance. Refusant de collaborer, Paul Valéry perd sous l’Occupation son poste d’administrateur du centre universitaire de Nice. Il meurt le 20 juillet 1945, la semaine même où s’ouvre, dans la France libérée, le procès Pétain. Après des funérailles nationales, il est inhumé à Sète, au cimetière marin. Il avait écrit : « La mort enlève tout sérieux à la vie. »
Le 30 mai 1945, il consignait ses dernières impressions: « Je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut être désormais que du temps perdu. Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais assez bien mon esprit. (...) Je connais my heart aussi. » La vie de Monsieur Teste se terminait sur le mot cœur.
Fruttero et Lucentini, dans La Prédominance du crétin, lui consacrent un superbe texte qui clôt le recueil : « Monsieur Teste n’est pas un symbole commode, un héros triomphant que l’on peut suivre en rangs, en entonnant des slogans. En un certain sens, il a toujours été vaincu. Mais à intervalles assez longs, quand les trottoirs hurlants se sont momentanément vidés, on peut toujours, si on le désire, entendre son pas nocturne, régulier, imperturbablement solitaire. »
Raymond Alcovère, : un des 50 portraits de "Ces Héraultais qui ont fait l'Histoire", éditions Papillon Rouge, 2018
01:26 Publié dans Ces Héraultais qui ont fait l'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, ces héraultais qui ont fait l'histoire
vendredi, 15 mai 2020
Je me demande comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui

Au volant de ma voiture, aujourd'hui, entre chien et loup. L'autoroute est rectiligne, presque personne, la musique bourdonne, gobe les kilomètres. “Got a sweet black angel “. J’ai peur aujourd'hui, peur d'être devenu un homme efficace, rationnel, posé, méticuleux. Chacun est à sa place, je le vois bien, il y a une logique dans les choses, si peu de folie. La décrépitude doucement, déjà quelques signes avant-coureurs. Peut-être ai-je déjà atteint le sommet, le début de la pente descendante. Maintenant tout va s'effilocher, doucement s'évanouir. C'est biologique. “Got upon my heart”... Insensible accélération de la vitesse, du volume sonore. Je suis en pleine possession de mes moyens.

Ce rêve, une nuit qui n’en finit pas, ne se termine pas par une aurore vague, le grand réveil de la vie, matutinale, fébrile, industrieuse... Plutôt rouler, toujours plus vite, avec la musique, légère ou opaque, peu importe. Jauge près de zéro. Plus envie de m'arrêter. Au loin, comme une station orbitale, une station-service, tous feux allumés dans la nuit vide, ouverte. Est-ce le début ou la fin ?
Au lieu de ralentir, j'accélère encore, fonce dans sa direction. Les allées de voitures sont désertes, je vise les pompes à essence, ça va être un grand feu d'artifice, la féerie, enfin !
- Au secours ! Freinez ! Vite !
Je lève le pied, freine sec. Elle a basculé de la banquette arrière. Tombée comme un paquet de linge juste à côté de moi. Je pile juste avant la station. Le pompiste est sorti de sa cahute, je lui fais signe que tout va bien.
- Ça va, vous n’avez rien ?
- Ah, la peur de ma vie, c’est tout !
Elle a dix-huit ans peut-être... Des yeux longs qui lancent des éclairs. Tourneboulée, affolée. Elle s’assoit, retrouve son calme. Très pâle, livide, à peine un instant. Elle se rajuste, reprend des couleurs.
- Je suis désolé, vous allez bien ?
- Oui, oui, ça ira, merci !
- Qu’est-ce que vous faisiez là ?

Raymond Alcovère, Extrait de "Fugue baroque", éditions n & b, 1998, , prix de la ville de Balma(début du roman)
Photos : Gildas Pasquet
00:01 Publié dans Fugue baroque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fugue baroque
jeudi, 14 mai 2020
Blanc, bleu gris, soleil voilé
 Blanc, bleu gris, soleil voilé. Un peu plus tard, à Sainte-Marie, au bord de l’Océan Indien. Mer miroitante, bleu plus léger des vagues, ombre du ciel sur la mer. Mes pensées enlacées, nous ne faisons qu’un.
Blanc, bleu gris, soleil voilé. Un peu plus tard, à Sainte-Marie, au bord de l’Océan Indien. Mer miroitante, bleu plus léger des vagues, ombre du ciel sur la mer. Mes pensées enlacées, nous ne faisons qu’un.
Blanc, bleu gris, presque infini et toujours renouvelé. Tout revient toujours à son point de départ. Aujourd’hui, le vent balaye le monde et disperse la brume. Place à la nouveauté. Une vérité émerge. Je vais rendre les armes. Passer outre.
Le ciel est gris de nuages. L’océan s’en mêle. L’horizon, profond et immense, est subjugué, défait, anéanti.
Je suis heureux, touché par cette éternelle beauté qui affleure partout. Ici au bout du monde, je l’ai trouvée. Je n’ai fait que découvrir des bouts du monde. Ils sont au centre. La vérité toujours dissimulée, y éclate en pleine lumière. À présent, le flux va se dérouler sans hâte. Mon rôle est de raconter. Par le dessin, la peinture. Les rencontres sont métaphysiques et l’art en est une manifestation. Dans le temps.
Le bonheur, la chose la plus étonnante, la plus vraie, arrive quand on ne l’attend plus. Ma mort est là, juste à côté de moi. Tout autour, les anges veillent, j’entends le frôlement de leurs ailes. Ils me disent : repousse-la, envoie-la au diable, qui lui est bien vivant. Tu le peux, la force de résister est inscrite dans tes cellules, au plus profond. Une fois cette certitude acquise, la mort s’effiloche, se dissout, le diable s’effondre dans sa chute.
Les vieux textes indiens ne me quittent plus : « Dès qu’on s’attache au Soi suprême, ne serait-ce qu’un instant, on consume entièrement ses fautes, comme l’étincelle de feu une montagne de bois». Ce Soi suprême, c’est soi et le monde, une seule et même dimension. Tout est fini, c'est-à-dire commence. Me voici débarrassé de mes vieux démons. Chassés les faux prophètes.
« Fini d’être consumés par le feu, nous sommes le feu lui-même ». Là est notre liberté. Feu qui couve et flammes, en même temps.
Au loin passe une voile, grand silence autour, tissé de ces millions de vies, si éloignées de la mienne, et pourtant… Contre la force des vagues, les gestes des piroguiers, immuables. Je suis heureux, là, au milieu de ce royaume de la pluie et du vent, je me revois – et tous les instants sont les mêmes – sur ce cargo au retour du Mexique. J’ai aimé ce navire, la sensation de posséder l’univers entier, accoudé au bastingage, à regarder les reflets changeants de la mer et cette avancée imperturbable du bateau. Et sur cette île battue par les vents, qui n’intéresse personne, je suis plus près d’une certaine vérité, du néant, cette dimension négligée, pourtant si présente.
De temps à autre, un surgissement. Il en est de même dans l’Histoire ; sombre et chaotique, elle s’épanouit en de rares moments, des orgasmes du temps. Parfois un grand artiste, un penseur, un homme politique ou un inventeur de génie apparaît improbable, de même dans nos vies, des instants de grâce.
Pourquoi une histoire ? La rose est sans pourquoi. Le vent s’est calmé. L’Océan Indien est là, il frémit, les vagues frissonnent, caressent la plage, ces millions de grains, coquillages qui lentement s’amenuisent, se dispersent, reviennent. L’histoire s’arrête mais en réalité continue. Je t’ai aimée Laure, et je t’aimerai encore.
« Le fini s’anéantit en présence de l’infini et devient un pur néant ». Où que je sois dans le monde maintenant, je revois cette terre rouge, les montagnes pelées, ces rizières, ces femmes, hommes, enfants, qui suivent inlassablement les zébus, depuis la nuit des temps. Cette terre rouge de Madagascar que j’aimais regarder du ciel. Ainsi je l’avais vue d’avion la première fois, tout droit sortie de mes rêves de gamin.
Parfois rien ne peut m’apporter la paix, seulement ton image Laure, hors de tout désir conscient, et miracle, c’est en rêve que je la trouve. J’ai hâte de dormir pour rêver de toi. Là je caresse tes cheveux sans fin, tu me parles, tes yeux illuminent tout, je bois ton visage. Il rayonne en moi comme partout où ton regard se pose. Tout à l’heure je dormirai et pourvu que je te rejoigne…
 Nous serons à Lisbonne, dans les rues sombres descendant vers le Tage, au milieu d’ombres erratiques, avec cette lumière blanche qui baigne la ville et à l’Hôtel Borges on fera l’amour encore, on ne verra pas le soleil mais aucune importance, avec cet air humide qu’on ne trouve que là-bas, les immeubles délabrés, cette atmosphère anglaise et surannée, Fernando Pessoa, son chapeau, son parapluie seul dans la nuit grise, ici on perd tout sentiment de la réalité. L’œuvre de Pessoa est nocturne et je dessine la nuit. Je ne suis allé qu’une fois à Lisbonne mais c’est comme si j’y étais toujours.
Nous serons à Lisbonne, dans les rues sombres descendant vers le Tage, au milieu d’ombres erratiques, avec cette lumière blanche qui baigne la ville et à l’Hôtel Borges on fera l’amour encore, on ne verra pas le soleil mais aucune importance, avec cet air humide qu’on ne trouve que là-bas, les immeubles délabrés, cette atmosphère anglaise et surannée, Fernando Pessoa, son chapeau, son parapluie seul dans la nuit grise, ici on perd tout sentiment de la réalité. L’œuvre de Pessoa est nocturne et je dessine la nuit. Je ne suis allé qu’une fois à Lisbonne mais c’est comme si j’y étais toujours.
Le temps s’y étend, se dissout, on ne voit que le ciel, il habite tout, mêlé de mer, comme à Venise et ce sont peut-être les deux seules villes habitables avec Paris.
Je bois ton regard Laure, me fous du monde entier, si aujourd’hui plus personne n’ose aimer l’autre, ose se nier au point de l’accueillir, quelle importance. Ils ignorent les délices qui les attendent, quand je me noie dans ton sourire si fin et l’harmonie qui s’en dégage, ce ciel au fond de tes yeux, la toile qui accompagnera ma vie jusqu’au bout.
Le réel me faisait peur, je refusais de voir le versant lumineux de ma vie. Il est là, les grands artistes nous le montrent. Ils ont vraiment existé, vécu, aimé, créé, leur art a occupé tout leur être ; Homère, Tchouang-Tseu, Titien, Montaigne, Bach, Mozart, Rimbaud, Cézanne, Nietzsche, ces corps ont engendré ces œuvres, rien n’est plus réel. C’est vers elles qu’il faut se retourner, en permanence. La beauté du monde, cette illumination constante, est sous nos yeux, peu importe les époques. Ces éclairs ont laissé des traces indélébiles, je n’ai qu’un désir, m’y attarder et entrer dans cette gratuité. 
Toute ma vie j’ai cherché l’inaccessible étoile, dont tu n’es peut-être, qu’un nom, l’autre visage, bienheureux. Ce visage je l’ai approché, caressé, aimé. Je n’en demande pas plus.
Aujourd’hui du temps est passé et je me laisse peu à peu guider par le vide, source de toute joie. Au-delà d’un certain point, rien n’est plus explicable. J’ai envie de m’allonger près de toi, Laure, sentir ta chaleur et attendre. J’ai tout. Tout.
Tout revient toujours à sa vérité première, pas de fin, éternel recommencement. Demain, je pars pour le Mexique. Lumière d’or. Faire le vide qui est la vie. Frémissante, celle des arbres, de la pluie insistante et d’un éternel soleil. Je me réveille, là, à cet instant, et tout s’illumine.
Raymond Alcovère, extrait du roman "Le bonheur est un drôle de serpent", 2009, Lucie éditions.
Photos : Ni Houzel Bellapia, Eric Frey, Carole Alignan
00:01 Publié dans Le Bonheur est un drôle de serpent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le bonheur est un drôle de serpent
mercredi, 13 mai 2020
Mémoires de Saint-Simon
 Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »
Ses Mémoires sont un fleuve qui vous emporte, un des sommets de notre langue. Ses portraits sont terribles, implacables. Voici le prince de Conti : « C’était un très bel esprit, lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture infinie, qui n’oubliait rien, qui possédait les histoires générales et particulières, galant avec toutes les femmes, amoureux de plusieurs, bien traité de beaucoup. » Et tout de suite après : « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n’aimait rien. Il avait et voulait des amis comme on veut et qu’on a des meubles. » Et la princesse de Montauban : « Rien de si effronté, de si débordé, de si avare de si étrangement méchant, que cette espèce de monstre, avec beaucoup d'esprit, et du plus mauvais, et toutefois de l'agrément quand elle voulait plaire. » Mlle de Séry : « C’était une jeune fille de condition sans aucun bien, jolie, piquante, d’un air vif, mutin, capricieux et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu’il promettait. » En plus ramassé encore : « Il était sans esprit aucun, et gueux comme un rat d'église. » ou « Outre qu'il était méchant, il était malin encore, et persécutait jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens. » ou : « Une physionomie vive, ouverte, sortante, et véritablement un peu folle. » Ou encore : « Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. » Voici le cardinal Dubois : « Tous les vices combattaient en lui à qui en deviendrait le maître. L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, le servage ses moyens ; l’impiété parfaite son repos (…) Il finit sa vie dans le plus grand désespoir, et dans la rage de la quitter. »  Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.
Il arrive que l’éloge soit sans blâme : « C’était un homme d’infiniment d’esprit qui, avec une imagination qui le rendait toujours neuf et de la plus excellente compagnie, avait toute la lumière et le sens des grandes affaires et des plus solides et des meilleurs conseils. » Dans La littérature ou le nerf de la guerre, Philippe Sollers explique la fascination qu’il inspire : « Ouvrez n’importe quel volume, et vous allez être absolument passionné par la description de l’époque. Je ne parle pas de ceux qui imitent Saint-Simon pour décrire aujourd’hui la situation politico-mondaine dans laquelle nous sommes plongés, je parle de Saint-Simon lui-même. Et si vous lui aviez dit, au duc de Saint-Simon : « Alors, vous faites de la littérature, vous êtes écrivain ? », il vous aurait regardé avec un air de profonde stupéfaction : « Écrivain ? Je ne suis pas écrivain ! » Il s’excuse même de son style, alors que c’est le plus brillant qui ait jamais existé en français, le plus remarquable, le plus pointu… « Je n’ai jamais su être un sujet académique, je n’ai jamais pu me défaire d’écrire rapidement. Je ne comprends pas ce que vous dites, je ne suis pas écrivain, je suis le duc de Saint-Simon, j’écris mes Mémoires. De la littérature ! Mais de quoi parlez-vous ? J’écris la vérité, la vérité à la lumière du Saint-Esprit. » Là, tout à coup, le concept de littérature explose. Nous pénétrons dans ce que le langage peut dire à un moment comme vérité. La vérité pour Saint-Simon, c’est quelque chose de tout à fait saisissant : tout est mensonge, corruption, chaos, la mort est là toutes les trois pages, les intrigues n’arrêtent pas, c’est un brasier de complots, l’être humain a l’air de passer comme une ombre, attaché à tout ce qu’il peut y avoir de plus sordide, de plus inquiétant. Lisez, par exemple, son portrait du duc d’Orléans, et vous serez saisi d’admiration.  Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »
Vous êtes devant quelque chose qu’un universitaire vous dira être de la littérature et, évidemment, c’est tout autre chose: c’est une position métaphysique très particulière, quelqu’un qui écrit en fonction de ce qu’il veut dire comme vérité. » Jean Cocteau a écrit à son propos : « Personne, sauf Montaigne, n’a eu cette lame en pointe, cette encre noire. La plume de notre duc trouait la feuille. Il assenait (le terme est de lui) ces regards. » Voici ce que Saint-Simon écrit dans son avant-propos : « Ecrire l’histoire de son pays et de son temps, c’est repasser dans son esprit avec beaucoup de réflexion tout ce qu’on a vu, manié, ou su d’original sans reproche, qui s’est passé sur le théâtre du monde, les diverses machines, souvent les riens apparents qui ont mû les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite, et qui en ont enfanté d’autres; c’est se montrer à soi-même pied à pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux; c’est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses, et de la vie des hommes; c’est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l’a été, et que la félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas; c’est mettre en évidence que, s’il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l’avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l’entrée de leur vie, et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions; et que, de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu’ils s’étaient proposé, n’a fait qu’augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches, et rend pour eux comme non avenu tout ce que à quoi ils étaient parvenus. » Et puis : « Je ne fus jamais un sujet académique, je n’ai pu me défaire d’écrire rapidement. »
Raymond Alcovère
00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : saint-simon, mémoires
mardi, 12 mai 2020
Madame Edwarda (Georges Bataille)
 Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »
Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’ouvrir un livre de Bataille ; après, on ne sera plus exactement le même. Il s’est attaqué aux sujets les plus difficiles, les plus dangereux. Philippe Sollers : « À côté des récits de Bataille, la plupart des romans paraissent fades, lâches, timides, apeurés, lourds, lents, économiques, et surtout prudes jusque dans leur laborieuse pornographie. » Bataille se plaît à tout bousculer mais chez lui le substrat est plus que solide : « Contrairement aux philosophes qui continuent à jouer le jeu de l’idéologie (lesquelles sont toutes, aujourd’hui, résorbées dans le médiatique), Bataille parle et pense en homme des carrefours : il n’a pas de limites, il est capable de penser Lascaux et Sade à la fois – de s’ouvrir à la remise en jeu qu’une telle rencontre provoque. Une « conciliation amicale, et pleine d’angoisse, entre les nécessités incompatibles » ; ainsi définit-il la fête – ainsi pourrait-on définir son lieu. » : Yannick Haenel. Il pense ensemble la religion et l’érotisme : : « Ce qui est en jeu dans l’érotisme, c’est toujours une dissolution des formes constituées. » Et :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. » Bataille ne cesse de questionner Dieu : « Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites. » Dans Madame Edwarda, il représente Dieu sous la forme d’une prostituée. « Ce que j’ai à dire est tel que son expression est plus importante pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu, mais je fais appel, pour ma part, davantage à la sensibilité qu’à l’intelligence et, dès ce moment, c’est l’expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D’ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune manière s’exprimer dans une forme qui ne soit pas sensible : il n’en resterait absolument rien. »  « Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. »
« Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien (…) Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. » Comment penser et dire l’excès ? Voilà la question de Bataille, il s’y livre par « des mots qui réintroduisent – en un point – le souverain silence qu’interrompt le langage articulé ». Il n’hésite pas à tordre la langue, à provoquer des glissements, des dissonances : « Je tremblais l’acceptant, mais de l’imaginer, je devins fou » ; Ce qui fit dire à Marguerite Duras : « On peut donc dire de Georges Bataille qu’il n’écrit pas du tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous désapprend la littérature ». Dans ses textes il mêle érotisme, philosophie, anthropologie, religion et politique, et l’écriture y passe par des éclairs, des fulgurances : « La vie s’étire en moi comme un chant modulé dans la gorge d’un soprano » ou « Je pense comme une fille enlève sa robe ». Il laisse au lecteur l’intuition qu’il a été plus loin que les autres : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. » En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »
En 1939, dans le dernier numéro de la revue Acéphale qu’il avait créée, il écrira : « Je suis moi-même la guerre ». Rompant avec les formes traditionnelles de la composition, il a souvent recours au fragment, aux digressions, variations. Le rire est pour lui un thème central : « Il ne faudrait jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. » Dans le dernier entretien donné un an avant sa mort, il déclara : « Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes, c’est-à-dire d’avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit religieux le plus profond ». Mort à propos de laquelle il a écrit : « Le seul élément qui relie l’existence au reste est la mort : qui conçoit la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des proches, il se rend aux libres jeux du ciel. »
Raymond Alcovère
02:16 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, madame edwarda
lundi, 11 mai 2020
Les Fables de La Fontaine
 Commençons par tordre le cou à une légende. Comme le souligne Patrick Dandrey : « Les animaux ne forment qu’un tiers, à peu près, des quatre cents personnages des Fables. Les deux cent quarante Fables ne constituent qu’une part, imposante mais relative, de la production d’un poète, qui composa aussi : soixante-quatre contes, un roman mêlé de prose et de vers, une idylle héroïque, deux livrets d’opéra, deux tragédies (l’une lyrique et inachevée), deux comédies, un ballet comique, les fragments d’un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques en vers, un poème chrétien, deux paraphrases de textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, odes, ballades, madrigaux, chansons, épithalames, épigrammes, un pastiche, des traductions de vers latins, les lettres, beaucoup de vers de circonstances et de pièces perdues… Bilan estimable pour un paresseux. » Chateaubriand le considérait comme son dieu et il avait raison. La Fontaine, c’est l'andidote idéal, quand on est accablé, après avoir été obligé de lire mauvais livres, notes, rapports ou articles horriblement écrits. Sans doute aucun écrivain français n’est arrivé à ce sens du raccourci, de l’épure et de l’harmonie. Il dit en deux vers ce que beaucoup peinent à exprimer en de longues pages et même volumes. Goût pour le bonheur, individualisme, sagesse, esprit pénétrant, imagination, tout y est. En relisant les Fables, on est étonné d’y trouver autant d’expressions encore utilisées aujourd’hui.
Commençons par tordre le cou à une légende. Comme le souligne Patrick Dandrey : « Les animaux ne forment qu’un tiers, à peu près, des quatre cents personnages des Fables. Les deux cent quarante Fables ne constituent qu’une part, imposante mais relative, de la production d’un poète, qui composa aussi : soixante-quatre contes, un roman mêlé de prose et de vers, une idylle héroïque, deux livrets d’opéra, deux tragédies (l’une lyrique et inachevée), deux comédies, un ballet comique, les fragments d’un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques en vers, un poème chrétien, deux paraphrases de textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, odes, ballades, madrigaux, chansons, épithalames, épigrammes, un pastiche, des traductions de vers latins, les lettres, beaucoup de vers de circonstances et de pièces perdues… Bilan estimable pour un paresseux. » Chateaubriand le considérait comme son dieu et il avait raison. La Fontaine, c’est l'andidote idéal, quand on est accablé, après avoir été obligé de lire mauvais livres, notes, rapports ou articles horriblement écrits. Sans doute aucun écrivain français n’est arrivé à ce sens du raccourci, de l’épure et de l’harmonie. Il dit en deux vers ce que beaucoup peinent à exprimer en de longues pages et même volumes. Goût pour le bonheur, individualisme, sagesse, esprit pénétrant, imagination, tout y est. En relisant les Fables, on est étonné d’y trouver autant d’expressions encore utilisées aujourd’hui.  On peut mesurer son génie en comparant avec l’original dont il s’est inspiré : ici, La Cigale et les fourmis, version Ésope (6e siècle avant J.-C.) : « Pendant l’hiver, leur blé étant humide, les fourmis le faisaient sécher. La cigale, mourant de faim, leur demandait de la nourriture. Les fourmis lui répondirent : – Pourquoi en été n’amassais-tu pas de quoi manger ? – Je n’étais pas inactive, dit celle-ci, mais je chantais mélodieusement. Les fourmis se mirent à rire. – Eh bien, si en été tu chantais, maintenant que c’est l’hiver, danse. Cette fable montre qu’il ne faut pas être négligent en quoi que ce soit, si l’on veut éviter les chagrins et les dangers. » Ses contes et tout ce qu’il a écrit sont touchés par la grâce. S’il ne fallait retenir que quelques joyaux de notre langue, on y trouverait sans doute : « Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste… » Et : « J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n’est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. » Ou le merveilleux : « Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'approfondir cette science. »
On peut mesurer son génie en comparant avec l’original dont il s’est inspiré : ici, La Cigale et les fourmis, version Ésope (6e siècle avant J.-C.) : « Pendant l’hiver, leur blé étant humide, les fourmis le faisaient sécher. La cigale, mourant de faim, leur demandait de la nourriture. Les fourmis lui répondirent : – Pourquoi en été n’amassais-tu pas de quoi manger ? – Je n’étais pas inactive, dit celle-ci, mais je chantais mélodieusement. Les fourmis se mirent à rire. – Eh bien, si en été tu chantais, maintenant que c’est l’hiver, danse. Cette fable montre qu’il ne faut pas être négligent en quoi que ce soit, si l’on veut éviter les chagrins et les dangers. » Ses contes et tout ce qu’il a écrit sont touchés par la grâce. S’il ne fallait retenir que quelques joyaux de notre langue, on y trouverait sans doute : « Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste… » Et : « J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n’est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique. » Ou le merveilleux : « Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'approfondir cette science. »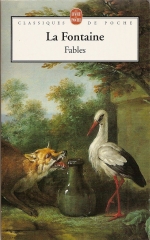 Ou encore : « Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d’épuiser une matière, on n’en doit prendre que la fleur. » Et les fleurs sont encore présentes ici : « Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; je vais de fleur en fleur ; et d’objet en objet… » Mais aussi : « Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands » En appendice à son Siècle de Louis XIV, Voltaire, dans son Catalogue des écrivains, écrit : « Dans la plupart de ses fables, il est infiniment au-dessus de tous ceux qui ont écrit avant et après lui, en quelque langue que ce puisse être ». Laissons-lui le mot de la fin : « Les Sages quelquefois, ainsi que l’écrevisse, marchant à reculons, tournent le dos au port. C’est l’art des matelots. C’est aussi l’artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. »
Ou encore : « Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d’épuiser une matière, on n’en doit prendre que la fleur. » Et les fleurs sont encore présentes ici : « Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; je vais de fleur en fleur ; et d’objet en objet… » Mais aussi : « Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands » En appendice à son Siècle de Louis XIV, Voltaire, dans son Catalogue des écrivains, écrit : « Dans la plupart de ses fables, il est infiniment au-dessus de tous ceux qui ont écrit avant et après lui, en quelque langue que ce puisse être ». Laissons-lui le mot de la fin : « Les Sages quelquefois, ainsi que l’écrevisse, marchant à reculons, tournent le dos au port. C’est l’art des matelots. C’est aussi l’artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. »
Raymond Alcovère
04:10 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la fontaine, fables
dimanche, 10 mai 2020
Le Sourire de Cézanne

Il le tue symboliquement dans L’Œuvre, ce roman qui provoquera la rupture, où Cézanne découvre son portrait déformé. Après avoir lu le livre, il écrit sa dernière lettre à Zola et termine par ses mots : Tout à toi sous l’impulsion des temps écoulés. La vie de l’écrivain était devenue de plus en plus publique, celle du peintre retirée. Au début, c’était le contraire.
Tout avait commencé avec les pommes. Zola adolescent chétif, renfermé, italien par son père et parisien par son accent, est mal accepté ; il est mis en quarantaine par les autres. Un jour, Cézanne, plutôt solide, bien dans son corps et de deux ans son aîné, transgresse l’interdit : “ Je ne pouvais m’empêcher de lui parler quand même ”. Il reçoit une raclée de toute la cour, petits et grands. Le lendemain, pour le remercier, Zola lui offre un plateau de pommes. Lesquelles reviendront constamment dans sa peinture. Leur amitié venait de naître, elle ne cesserait pas. Malgré la rupture, l’éloignement, quand il apprendra sa mort, bien des années plus tard, Cézanne, fou de douleur, s’enfermera dans sa chambre.
Toute sa vie il peindra des pommes.

Des arbres, un coin de ciel safran, des branches de pins se balancent dans l’air doré, corps suspendus flottant au dessus du vide, vert sauge de la végétation, baigneurs, baigneuses, chaque tableau fait partie de l’unité du monde, une parcelle de l’univers, détachée afin de mieux le rejoindre. Il y a toujours une relation d’amour, de fusion dans sa composition." C’est comme si chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres", écrira Rilke à propos de La Femme au gilet rouge, Madame Cézanne. "Les sensations formant le fond de mon affaire, je crois être impénétrable." A la question, écrivez une de vos pensées ou une citation dont vous approuvez le sens, Cézanne a répondu ces vers de Vigny : "Seigneur, vous m’avez fait puissant et solitaire. Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre." Le véritable vers est : "Hélas ! Je suis, Seigneur, puissant et solitaire..."

Elle l’imagine, se levant de bon matin, préparer ses pinceaux et son chevalet, partir d’un bon pas, l’esprit en ébullition, ou très placide peut-être, à travers la campagne aixoise, tenter d’en saisir le mystère, le regard fixé sur la Sainte-Victoire. "Regardez cette Sainte-Victoire, quel élan, quelle soif impérieuse de soleil et quelle mélancolie le soir, quand toute cette pesanteur retombe. Les blocs étaient du feu. Il y a du feu encore en eux. L’ombre, le jour a l’air de reculer en frissonnant, d’avoir peur d’eux."
 La dernière Sainte-Victoire de Cézanne : une assomption, sombre, crépusculaire, en bleu, vert, marron et noir. Il a tout concentré, teintes de blocs soyeux, masses terrifiantes agglutinées, taches blanches disséminées. L’existence est inachevée, ce que nous en décelons reste partiel. Une autre est son propre reflet dans une eau glauque, une eau de nuit, un vitrail.
La dernière Sainte-Victoire de Cézanne : une assomption, sombre, crépusculaire, en bleu, vert, marron et noir. Il a tout concentré, teintes de blocs soyeux, masses terrifiantes agglutinées, taches blanches disséminées. L’existence est inachevée, ce que nous en décelons reste partiel. Une autre est son propre reflet dans une eau glauque, une eau de nuit, un vitrail.
Il s’est vite détaché des impressionnistes, la bande impressionniste à qui il manque un maître, des idées, comme il l’écrira plus tard. Ce n’est pas l’impression d’ensemble, l’atmosphère du tableau qui l’intéresse mais le ressort intime des choses, leur structure, la relation secrète. Pourtant grâce à eux, et Pissaro, l’humble et colossal Pissaro, le premier qui l’aidera à éclaircir sa palette, il fera une découverte déterminante : "La matière j’ai voulu la copier, je n’arrivais pas, mais j’ai été content de moi lorsque j’ai découvert qu’il fallait la représenter par autre chose... par de la couleur. La nature n’est pas en surface, elle est en profondeur. Les couleurs sont l’expression, à cette surface, de cette profondeur, elles montent des racines du monde."

Raymond Alcovère, extraits de "Le Sourire de Cézanne", roman, éditions n&b, 2007
02:47 Publié dans Le Sourire de Cézanne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cezanne, le sourire de cézanne
samedi, 09 mai 2020
Journal de Kafka
 Milena Jesenská, dans une lettre à Max Brod, écrit : « Nous sommes tous en apparence capables de vivre parce que nous avons eu un jour ou l’autre recours au mensonge, à l’aveuglement, à l’enthousiasme, à l’optimisme, à une conviction ou à une autre, au pessimisme ou à quoi que ce soit. Mais lui est incapable de mentir, tout comme il est incapable de s’enivrer. Il est sans le moindre refuge, sans asile. C’est pourquoi il est exposé, là où nous sommes protégés. Il est comme un homme nu au milieu de gens habillés. C’est une manière d’être qui est déterminée, qui existe en elle-même, débarrassée de tout l’accessoire, de tout ce qui pourrait l’aider à qualifier la vie – beauté ou misère, peu importe. Et son ascétisme est totalement dépourvu d’héroïsme, ce qui le rend, à vrai dire, plus grand et plus noble. Tout héroïsme est mensonge et lâcheté. Ce n’est pas un homme qui construit son ascétisme comme un moyen d’accéder à un but, c’est un homme qui est contraint à l’ascétisme par sa terrible lucidité, par sa pureté, par son incapacité à accepter le compromis». Le Journal de Kafka est le témoignage inouï de cette lucidité, celle d’un des plus grands magiciens de la littérature et d’un métaphysicien. « Je suis une mémoire devenue vivante. » « La littérature : un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. » Et : « Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd toujours aussi, mais en gagne parfois une autre. »
Milena Jesenská, dans une lettre à Max Brod, écrit : « Nous sommes tous en apparence capables de vivre parce que nous avons eu un jour ou l’autre recours au mensonge, à l’aveuglement, à l’enthousiasme, à l’optimisme, à une conviction ou à une autre, au pessimisme ou à quoi que ce soit. Mais lui est incapable de mentir, tout comme il est incapable de s’enivrer. Il est sans le moindre refuge, sans asile. C’est pourquoi il est exposé, là où nous sommes protégés. Il est comme un homme nu au milieu de gens habillés. C’est une manière d’être qui est déterminée, qui existe en elle-même, débarrassée de tout l’accessoire, de tout ce qui pourrait l’aider à qualifier la vie – beauté ou misère, peu importe. Et son ascétisme est totalement dépourvu d’héroïsme, ce qui le rend, à vrai dire, plus grand et plus noble. Tout héroïsme est mensonge et lâcheté. Ce n’est pas un homme qui construit son ascétisme comme un moyen d’accéder à un but, c’est un homme qui est contraint à l’ascétisme par sa terrible lucidité, par sa pureté, par son incapacité à accepter le compromis». Le Journal de Kafka est le témoignage inouï de cette lucidité, celle d’un des plus grands magiciens de la littérature et d’un métaphysicien. « Je suis une mémoire devenue vivante. » « La littérature : un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. » Et : « Quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance, quand je la note, elle la perd toujours aussi, mais en gagne parfois une autre. » 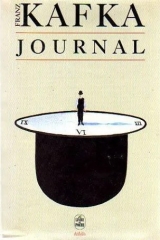 Dès le premier jour, Kafka pose les règles de son Journal : « Il faut qu’une ligne au moins soit braquée chaque jour sur moi comme on braque aujourd’hui un télescope sur les comètes. » Rien d’évident là dedans : « Connais-toi toi-même ne signifie pas : observe-toi. Observe-toi est le mot du serpent. Cela signifie : transforme-toi en maître de tes actes. Or, tu l’es déjà, tu es maître de tes actes. Le mot signifie donc : Méconnais-toi ! Détruis-toi ! C’est-à-dire quelque chose de mauvais, et c’est seulement si l’on se penche très bas que l’on entend aussi ce qu’il a de bon, qui s’exprime ainsi : afin de te transformer en celui que tu es. » Il va très loin : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi ». Et encore : « Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. »
Dès le premier jour, Kafka pose les règles de son Journal : « Il faut qu’une ligne au moins soit braquée chaque jour sur moi comme on braque aujourd’hui un télescope sur les comètes. » Rien d’évident là dedans : « Connais-toi toi-même ne signifie pas : observe-toi. Observe-toi est le mot du serpent. Cela signifie : transforme-toi en maître de tes actes. Or, tu l’es déjà, tu es maître de tes actes. Le mot signifie donc : Méconnais-toi ! Détruis-toi ! C’est-à-dire quelque chose de mauvais, et c’est seulement si l’on se penche très bas que l’on entend aussi ce qu’il a de bon, qui s’exprime ainsi : afin de te transformer en celui que tu es. » Il va très loin : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi ». Et encore : « Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde, qu’on l’invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. » Le 17 décembre 1910, première année du Journal qu’il poursuivra jusqu’en 1923, il note : « Je ne quitterai plus ce Journal. C’est là qu’il me faut être tenace, car je ne puis l’être que là. Comme j’aimerais exprimer le sentiment de bonheur qui m’habite de temps à autre, maintenant par exemple. C’est véritablement quelque chose de mousseux qui me remplit entièrement de tressaillements légers et agréables, et me persuade que je suis doué de capacités dont je peux à tout instant, et même maintenant, me convaincre en toute certitude qu’elles n’existent pas. » Et plus loin : « Plus profond l’on creuse son fossé, plus ça devient tranquille, moins on a peur, plus ça devient tranquille. » Il a écrit à Milena : « Je t’aime, comme la mer aime le gravier de ses profondeurs. »
Le 17 décembre 1910, première année du Journal qu’il poursuivra jusqu’en 1923, il note : « Je ne quitterai plus ce Journal. C’est là qu’il me faut être tenace, car je ne puis l’être que là. Comme j’aimerais exprimer le sentiment de bonheur qui m’habite de temps à autre, maintenant par exemple. C’est véritablement quelque chose de mousseux qui me remplit entièrement de tressaillements légers et agréables, et me persuade que je suis doué de capacités dont je peux à tout instant, et même maintenant, me convaincre en toute certitude qu’elles n’existent pas. » Et plus loin : « Plus profond l’on creuse son fossé, plus ça devient tranquille, moins on a peur, plus ça devient tranquille. » Il a écrit à Milena : « Je t’aime, comme la mer aime le gravier de ses profondeurs. »
Raymond Alcovère
03:04 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 08 mai 2020
Moby Dick (Herman Melville)
I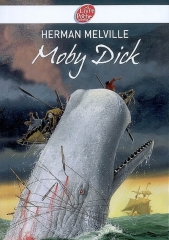 mmense roman métaphysique, aux résonances infinies ; il y a bien sûr son incipit hypnotique : « Appelons-moi Ismaël. Il y a quelque temps – le nombre exact des années n’a aucune importance – n’ayant que peu ou point d’argent en poche et rien qui me retînt spécialement à terre, l’idée me vint et l’envie me prit de naviguer quelque peu et de m’en aller visitant les étendues marines de ce monde. C’est un remède à moi ; c’est une manière que j’ai de me sortir du noir et de redonner du tonus à la circulation de mon sang. Oui, chaque fois que je me sens la lèvre amère et dure ; chaque fois qu’il bruine et vente dans mon âme et qu’il y fait un novembre glacial ; chaque fois que, sans préméditation aucune, je me trouve planté devant la vitrine des marchands de cercueils ou emboîtant le pas aux funèbres convois que je rencontre ; et surtout, oui, surtout chaque fois que je sens en moi les mauvaises humeurs l’emporter à ce point qu’il me faille le puissant secours des principes moraux pour me retenir d’aller courir les rues à seule fin de jeter bas, fort méthodiquement, le chapeau des gens, alors, oui, je considère qu’il est grand temps pour moi de filer en mer au plus vite. C’est ce qui me tient lieu de pistolet et de plomb. Caton se jette sur son glaive, non sans emphase et sans grandiloquence philosophiques ; je gagne moi, bien plus discrètement, le bord de quelque voilier. Et il n’y a rien là qui soit fait pour me surprendre : tous les hommes, ou presque, à un moment ou à un autre de leur existence, nourrissent ou ont nourri, à un degré quelconque, des sentiments fort voisins des miens à l’égard de la mer. » Tout le livre est parsemé, de perles, de phares : « Quoique je sois né sur la terre, j'ai été nourri par les mamelles des mers, et malgré le sein maternel des vallées et des collines, je suis le frère de lait de toutes les vagues de l'eau. » Ou : « Un calme intense, cuivré comme un lotus jaune, déployait peu à peu ses feuilles de silence sur l’infini de la mer. » Ou encore : « Ainsi pour moi-même, au cœur de l’Atlantique tourmenté de mon être, il m’arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l’étincelle de ma joie. » Et l’extraordinaire baleine bien sûr : « ô homme ! Admire la baleine, efforce-toi de lui ressembler ; toi aussi, reste chaud parmi les glaces, sache vivre dans un monde autre que le tien ; sois frais sous l’Équateur ; que ton sang, au Pôle, demeure liquide… Comme le grand dôme de Saint-Pierre, et comme la grande baleine, garde en toute saison ta chaleur personnelle. »
mmense roman métaphysique, aux résonances infinies ; il y a bien sûr son incipit hypnotique : « Appelons-moi Ismaël. Il y a quelque temps – le nombre exact des années n’a aucune importance – n’ayant que peu ou point d’argent en poche et rien qui me retînt spécialement à terre, l’idée me vint et l’envie me prit de naviguer quelque peu et de m’en aller visitant les étendues marines de ce monde. C’est un remède à moi ; c’est une manière que j’ai de me sortir du noir et de redonner du tonus à la circulation de mon sang. Oui, chaque fois que je me sens la lèvre amère et dure ; chaque fois qu’il bruine et vente dans mon âme et qu’il y fait un novembre glacial ; chaque fois que, sans préméditation aucune, je me trouve planté devant la vitrine des marchands de cercueils ou emboîtant le pas aux funèbres convois que je rencontre ; et surtout, oui, surtout chaque fois que je sens en moi les mauvaises humeurs l’emporter à ce point qu’il me faille le puissant secours des principes moraux pour me retenir d’aller courir les rues à seule fin de jeter bas, fort méthodiquement, le chapeau des gens, alors, oui, je considère qu’il est grand temps pour moi de filer en mer au plus vite. C’est ce qui me tient lieu de pistolet et de plomb. Caton se jette sur son glaive, non sans emphase et sans grandiloquence philosophiques ; je gagne moi, bien plus discrètement, le bord de quelque voilier. Et il n’y a rien là qui soit fait pour me surprendre : tous les hommes, ou presque, à un moment ou à un autre de leur existence, nourrissent ou ont nourri, à un degré quelconque, des sentiments fort voisins des miens à l’égard de la mer. » Tout le livre est parsemé, de perles, de phares : « Quoique je sois né sur la terre, j'ai été nourri par les mamelles des mers, et malgré le sein maternel des vallées et des collines, je suis le frère de lait de toutes les vagues de l'eau. » Ou : « Un calme intense, cuivré comme un lotus jaune, déployait peu à peu ses feuilles de silence sur l’infini de la mer. » Ou encore : « Ainsi pour moi-même, au cœur de l’Atlantique tourmenté de mon être, il m’arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l’étincelle de ma joie. » Et l’extraordinaire baleine bien sûr : « ô homme ! Admire la baleine, efforce-toi de lui ressembler ; toi aussi, reste chaud parmi les glaces, sache vivre dans un monde autre que le tien ; sois frais sous l’Équateur ; que ton sang, au Pôle, demeure liquide… Comme le grand dôme de Saint-Pierre, et comme la grande baleine, garde en toute saison ta chaleur personnelle. »  Ce roman appelle de multiples interprétations : Yannick Haenel et François Meyronnis en font le point de départ de leur remarquable essai : Prélude à la délivrance : « Nous montrerons quel dieu se dissimule dans ce que Melville lui-même nommait une étrange sorte de livre – et pourquoi, autant que d’un roman, il s’agit d’une bonne nouvelle – d’une annonce où le narrateur explique comment il a ressuscité d’entre les morts, et comment il est possible de vaincre le macabre depuis ses gouffres les plus ténébreux. Car le livre de Melville n’est pas écrit comme il est raconté. Il tourbillonne autour d’un espace vacant, que symbolise quelque chose de mystérieux, d’ineffable, qui désespère l’entendement, à savoir la blancheur de la Baleine : une blancheur vide, dit le texte – colorée par l’absence de Dieu. A cet égard, la chasse tourmentée d’un cachalot, même si on présente celui-ci comme un fantôme démoniaque, ne manifeste qu’un leurre. Ce qui scintille dans cet espace vacant, en dehors de la voie lactée, c’est la possibilité d’une délivrance au cœur de l’abîme. » Et c’est bien une délivrance que raconte Moby Dick par la voix de Ismaël (en hébreu : Dieu entend), un voyage initiatique. Le capitaine Achab incarne le mal, la violence sacrificielle du meurtre de cette baleine qui l’obsède ; il veut la posséder, mais c’est elle qui le possède. François Meyronnis : « Le problème d’Achab se résume facilement : il ne pense pas, alors que quelque chose de trop grand pour lui le tient des pieds à la tête (…) Ainsi, davantage il se démène, et plus il est lié – c’est ce lien, pour finir, qui l’étrangle comme un lacet sacrificiel. » Ismaël lui, au cœur des ténèbres, ne laisse pas le feu le posséder, il est dans l’indemne (non damné). « La littérature c’est un manteau d’annonciations voilées. » ajoute Yannick Haenel.
Ce roman appelle de multiples interprétations : Yannick Haenel et François Meyronnis en font le point de départ de leur remarquable essai : Prélude à la délivrance : « Nous montrerons quel dieu se dissimule dans ce que Melville lui-même nommait une étrange sorte de livre – et pourquoi, autant que d’un roman, il s’agit d’une bonne nouvelle – d’une annonce où le narrateur explique comment il a ressuscité d’entre les morts, et comment il est possible de vaincre le macabre depuis ses gouffres les plus ténébreux. Car le livre de Melville n’est pas écrit comme il est raconté. Il tourbillonne autour d’un espace vacant, que symbolise quelque chose de mystérieux, d’ineffable, qui désespère l’entendement, à savoir la blancheur de la Baleine : une blancheur vide, dit le texte – colorée par l’absence de Dieu. A cet égard, la chasse tourmentée d’un cachalot, même si on présente celui-ci comme un fantôme démoniaque, ne manifeste qu’un leurre. Ce qui scintille dans cet espace vacant, en dehors de la voie lactée, c’est la possibilité d’une délivrance au cœur de l’abîme. » Et c’est bien une délivrance que raconte Moby Dick par la voix de Ismaël (en hébreu : Dieu entend), un voyage initiatique. Le capitaine Achab incarne le mal, la violence sacrificielle du meurtre de cette baleine qui l’obsède ; il veut la posséder, mais c’est elle qui le possède. François Meyronnis : « Le problème d’Achab se résume facilement : il ne pense pas, alors que quelque chose de trop grand pour lui le tient des pieds à la tête (…) Ainsi, davantage il se démène, et plus il est lié – c’est ce lien, pour finir, qui l’étrangle comme un lacet sacrificiel. » Ismaël lui, au cœur des ténèbres, ne laisse pas le feu le posséder, il est dans l’indemne (non damné). « La littérature c’est un manteau d’annonciations voilées. » ajoute Yannick Haenel. Bartleby est tout aussi stupéfiant, déroutant et énigmatique ; un texte court, limpide et d’une grande force : Comment une seule personne, par son refus, peut gripper la machine, sans violence, par la force et la profondeur de son désir. Bartleby pose la question du sens. D’ailleurs Melville ne livre pas le sens de sa nouvelle, et c’est justement cette absence de sens qui grippe la machine, qui rend la vie et le monde impossible. Ismaël lui, écrit : « Ainsi pour moi-même, au cœur de l’Atlantique tourmentée de mon être, il m’arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l’étincelle de ma joie. » et : « L’âme de l’homme renferme une île tahitienne où règnent la paix et la joie, mais cernée par les mille horreurs du monde à demi inconnu. » Du vivant de Melville, Moby Dick s’est vendu à 4 000 exemplaires.
Bartleby est tout aussi stupéfiant, déroutant et énigmatique ; un texte court, limpide et d’une grande force : Comment une seule personne, par son refus, peut gripper la machine, sans violence, par la force et la profondeur de son désir. Bartleby pose la question du sens. D’ailleurs Melville ne livre pas le sens de sa nouvelle, et c’est justement cette absence de sens qui grippe la machine, qui rend la vie et le monde impossible. Ismaël lui, écrit : « Ainsi pour moi-même, au cœur de l’Atlantique tourmentée de mon être, il m’arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l’étincelle de ma joie. » et : « L’âme de l’homme renferme une île tahitienne où règnent la paix et la joie, mais cernée par les mille horreurs du monde à demi inconnu. » Du vivant de Melville, Moby Dick s’est vendu à 4 000 exemplaires.
Raymond Alcovère
00:05 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : herman melville, moby dick
jeudi, 07 mai 2020
Mémoires d'outre-tombe (Chateaubriand)
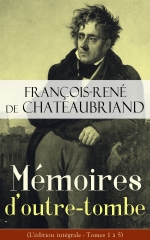 Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. »
Jamais peut-être la prose française n’a atteint cet équilibre parfait, rythme, musicalité et force... Son utilisation des temps est stupéfiante, ici dans les Mémoires : « Voici venir cette lame embrassant la largeur de la passe, roulant haut sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs, au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de la mort. Le navire touchait et talonnait ; il se fit un silence profond ; tous les visages blêmirent. La houle arrive : au moment où elle nous attaque, le matelot donne le coup de barre ; le vaisseau, près de tomber sur le flanc, présente l’arrière et la lame qui paraît nous engloutir, nous soulève. » Chateaubriand est excellent dans les scènes d’action (il a beaucoup bourlingué) mais également dans la contemplation et la nostalgie, partout présente : « Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi : le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes : on se sent mieux à l’abri des hommes. Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine possession des sympathies de ma nature (…) Je m’applaudissais d’avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaine (…) La nuit descendait ; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poules d’eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voies de l’automne sortaient des marais et des bois (…) Le murmure de la pluie m’invitait au sommeil sur le sein d’une femme (…) L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’une toile préparée pour recevoir les futures créations d’un grand peintre. » 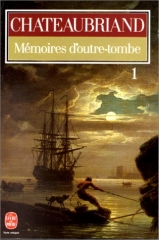 Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»
Trop de talent ! Il a été et est encore détesté ("Je crois à la haine inconsciente du style" écrira Flaubert un peu plus tard). Robert Dantzig : « Chateaubriand n’est pas l’homme des sentiments directs : il se voit les éprouvant. » Il continue : « Talleyrand à qui on fit remarquer sous la Restauration : « M. de Chateaubriand devient sourd » répondit : « C’est qu’il n’entend plus parler de lui. » Et encore : « La moitié de sa vie a été vécue en prévision de ce livre. » Roberto Calasso est particulièrement féroce : « Le Chateaubriand qui a persécuté tant d’élèves des lycées français : celui qui trouve toujours le cadre juste où se placer, dispose adroitement les objets sur la scène, règle les lumières et puis se lance dans une de ses méditations avec la facilité d’un employé de bureau qui, à la pause-café, expose à ses collègues la performance de sa voiture. » Stendhal lui-même a la dent dure : « En le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier : « Juste ciel ! Que tout cela est faux ! Mais que c’est bien écrit ! » Tout cela est en grande partie injuste, car, entre autres, le regard sur l’Histoire de l’auteur des Mémoires ne manque pas de finesse (à méditer peut-être aujourd’hui) : « Lorsqu’avant la Révolution, je lisais l’histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d’être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m’a fait comprendre cette possibilité d’existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues rentrés pour un moment dans l’état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu’il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. » Ou encore, sur les journées révolutionnaires de juillet 1830 : « Dans tous les quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément et sans arrière-pensée : l’étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous ; la gloire a, pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue…»  Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »
Sa virtuosité et son côté Génie du Christianisme ont irrité : Sartre est allé à Saint-Malo pisser sur sa tombe, on ne pouvait rêver plus bel hommage ! Chateaubriand est juste quand il écrit : « Des auteurs français de ma date, je suis le seul dont la vie ressemble à ses ouvrages. » Les Mémoires le prouvent. Le final est sublime : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient ; on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. » (magnifique déferlement de voyelles dans «j’aperçois la lune pâle et élargie » Il a répondu d’avance à tous ses détracteurs : « Ma vie n’est qu’un accident, je sens que je ne devais pas naître : acceptez de cet accident la passion, la rapidité et le malheur. » Et ces rappel utiles : « Les annales humaines se composent de beaucoup de fables mêlées à quelques vérités. » Et puis : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. »
Raymond Alcovère
02:09 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, mémoires d'outre-tombe
mercredi, 06 mai 2020
Discours de Suède (Albert Camus)
 Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.
Le Discours de Suède, parabole lumineuse sur le rôle de l’artiste, est un texte fondateur : « Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est nécessaire au contraire, c’est qu’il ne me sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous (…) L’artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. » Balayée l’image de l’artiste, seul dans sa tour d’ivoire, contemplant rêveur et distant le reste de l’humanité. Le voici au contraire au cœur du monde. Et ce positionnement, c’est la raison qui l’impose : « C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. » Ce qui amène, bien sûr, au politique : « Le rôle de l’écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent (…) Le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d’hommes possible, elle ne peut s’accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. » L’artiste quitte une solitude choisie pour lutter contre une solitude subie par d’autres, intéressant aller-retour. L’écrivain ou l’artiste, – Camus ne fait pas de différence entre les deux notions –, dont la nature l’amène à être « toujours partagé entre la douleur et la beauté », doit poursuivre « autant qu’il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de la vérité et celui de la liberté. » Chemins, bien sûr, balisés de chausses trappes : « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d’avance de nos défaillances sur un si long chemin. » Les premiers textes de Camus, Noces, suivi de L’Été, débordent de poésie et de sensualité : « Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent autour des cils. L’odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. » On y trouve aussi ceci : « Aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Son souci constant de rigueur et de justice, le détache dans ce siècle de bruit et de fureur.  Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »
Il a écrit, dans L’Envers et l’endroit : « Je ne sais pas posséder. » Et aussi : « J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d’un bonheur royal. » Michel Onfray, dans son essai L’ordre libertaire, parle à son propos de ligne claire. Son approche privilégie toujours l’homme, « cette force, écrivait-il, qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. » Son refus de la capitulation, inspiré de la Résistance, il l’a exprimé par : « La vertu de l’homme est de se maintenir en face de tout ce qui le nie. » Qu’il déclinait ensuite en quatre commandements : d’abord la lucidité, qui suppose la résistance aux entraînements de la haine et au culte de la fatalité. Ensuite, le refus de servir le mensonge. Puis l’ironie, une arme sans précédent contre les trop puissants. Enfin l’obstination. Avec cette injonction : « Il faut essayer une méthode encore toute nouvelle qui serait la justice et la générosité. » Et cette présence de la lumière : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par fidélité à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. » Dans Noces encore : « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. » Et : « Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. »
Raymond Alcovère
00:00 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, discours de suède
mardi, 05 mai 2020
Le Temps retrouvé (Marcel Proust)
 La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;
La phrase qui résume le mieux Proust est sans doute : « il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. » Et c’est grâce à la littérature : « La littérature a pour but de découvrir la réalité en énonçant des choses contraires aux vérités usuelles. » Au-delà ne veut pas dire à l’extérieur de nous-mêmes : « Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. » Il est l’écrivain qui a le plus plongé dans l’âme humaine. Ce qui rend sa lecture difficile, ce n’est pas la longueur des phrases, leur complexité : simple gymnastique, au début on a du mal, mais on s’habitue très vite ; ce qui rend sa lecture difficile, douloureuse parfois, c’est qu’il creuse là où ça fait mal ; il décrit la cruauté comme personne. Antoine Compagnon : « Les gens ont raison d’avoir peur de La Recherche, car on ressort autre de sa lecture. » Certaines de ses phrases sont des aphorismes lumineux : « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Il est un immense poète, personne n’a possédé la langue française comme lui, il en connaît tous les ressorts, toute la force et la subtilité avec laquelle il joue à loisir. Sa façon d’empiler les adjectifs est extraordinaire : « Le tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette. Voilà, c’était Combray. » Ou encore : « Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. » Beaucoup d’humour dans la Recherche, notamment avec ce personnage étonnant : Legrandin, dont il se moque tout en lui attribuant des mots sublimes : « Ces fleurs sont d’un rose céleste, je veux dire couleur de ciel rose. Car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. » La Recherche fourmille de personnages fascinants, extraordinaires ;  parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. »
parmi lesquels se détache Françoise, la bonne, la gouvernante, qui lui a été inspiré par Céleste Albaret, cette jeune lozérienne, qui n’avait pas quitté son village jusqu’à l’âge de 22 ans et qui va devenir son amie, sa confidente, l’aidera à arranger, ordonner ses fameuses « paperolles », les ajouts, corrections qu’il ne cessait de faire. Il lui dédicacera un des volumes ainsi : « A ma chère Céleste, ma fidèle amie depuis huit ans, mais en réalité tellement présente dans mes pensées que j’oserais la nommer amie de toujours. » Il lui répétait : « Personne ne me connaît mieux que vous. Vous savez tout de moi, je vous dis tout. » Et puis, il y a ce moment où, à la fin de la Recherche, après presque deux mille pages lues, où l’on est passé par tous les états d’âme possibles et imaginables, où tout ce que l’on pensait ou croyait a été bouleversé ou réduit à néant maintes fois, où la poésie et le génie de la langue française ont atteint des sommets, le moment où l’on comprend que chaque phrase, chaque détail n’était pas là par hasard mais avait été posé là précisément, à la bonne place, où tout donc dans ce Grand œuvre était en correspondance et aboutissait à cette fin-là, ce moment donc où l’on comprend qu’on se trouvait dans une cathédrale, qui à la différence des cathédrales que l’on connaît, est absolument parfaite, sans défaut, ajout ou reconstruction. Il a écrit lui-même : « Il n'y a pas un détail qui n'en annonce un autre dans le même volume ou dans les volumes suivants. » Lucide avant tout, il pense à ses lecteurs : « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray ; mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même). » Bien sûr, c’est la question du temps, du temps retrouvé, qui est au centre La Recherche. Par le saut dans la parole, dans l’écriture, le narrateur retrouve le temps : « cette grande dimension du Temps, suivant laquelle la vie se réalise. » Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»
Avec ce final extraordinaire : « Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, — entre lesquelles tant de jours sont venus se placer — dans le Temps. » Jacques Rivière lui a écrit : « N’oubliez pas la force dont votre œuvre est pleine. Vous aurez beau faire, vous êtes trop dru, trop positif, trop vrai pour ces gens-là. Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas vous comprendre, leur sommeil est trop profond. » Il voulait écrire « ce livre essentiel, le seul livre vrai » et il y est parvenu. Et il indique la méthode : « Un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Et : «Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix.»
Raymond Alcovère
00:07 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, a la recherche du tems perdu, le temps retrouvé
lundi, 04 mai 2020
Les Trois Mousquetaires (Alexandre Dumas)
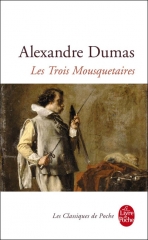
Les Trois Mousquetaires est le livre idéal pour fuir notre époque artificielle : bain de jouvence garanti. L’esprit français dans ce qu’il a de meilleur : fronde, énergie, humour et générosité. Quelle merveilleuse trouvaille que ces trois qui font quatre ; Aramis hésite sans cesse entre le sabre et le goupillon, et les aventures galantes et finalement choisit les trois « c’était un homme, comme on a déjà pu s’en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne » ; Porthos, cet Obélix avant la lettre et Athos, noble, taiseux, énigmatique ; on comprend vite qu’une blessure profonde le taraude à jamais ; voilà ce qui lui confère ce détachement et ce charme si particulier ; la vie lui importe peu, il est prêt à tous les risques, toutes les aventures, et surtout pour défendre ou aider ses amis. D’Artagnan a cette répartie magnifique à son propos : « Vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. » D’Artagnan lui (l’étroit mousquetaire ?), fier, bête et rusé en même temps, c’est la jeunesse éternelle ; son sens du devoir et sa fougue lui font le plus souvent oublier mesure et raison, mais avec lui on ne s’ennuie jamais et c’est l’essentiel ! Et il y a l’étonnant Tréville : « Avec un rare génie d'intrigue, qui le rendait l'égal des plus forts intrigants, il était resté honnête homme. » (tout est politique n’est-ce pas ?) Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »
Comme le remarque Patrick Cauvin dans son Dictionnaire amoureux des héros, malgré plus de trois cent adaptations des Trois Mousquetaires au cinéma, le livre n’a jamais été bien servi. C’est peut-être mieux ainsi, il reste maître de la situation. C’est finalement une adaptation américaine qui surnage, avec le bondissant Gene Kelly, crédible en D’Artagnan, et Lana Turner, sublime Milady : encore un beau personnage féminin de Dumas : la scène où elle retourne son geôlier est parfaite : « Avant de se coucher elle avait déjà commenté, analysé, retourné sur toutes leurs faces, examiné sous tous les points, les paroles, les pas, les gestes, les signes et jusqu’au silence de ces geôliers, et de cette étude profonde, habile et savante, il était résulté que Felton était, à tout prendre, le plus vulnérable de ses deux persécuteurs. » Cette façon de mêler l’histoire vraie et le roman est subtile ; on a bien l’impression d’être au cœur de l’Histoire, la vraie. Dumas a vécu trois ans à Naples, cette ville qui lui allait si bien. À plus de soixante ans, il partira aider Garibaldi en Sicile. Et lui amener des armes. Il était quarteron, et fut souvent victime du racisme de ses contemporains. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin (qu'il défendait), quelqu’un lui dit : – Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ? – Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. » Vengeance ? Il eut recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet, particulièrement efficace. Il avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Dans sa production très vaste, les chercheurs ont établi que les grands romans portent surtout la marque de Dumas. Il avait de la répartie et aussi du bon sens : « La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des imbéciles. Cela doit tenir à l'éducation. »
Raymond Alcovère
00:04 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre dumas, les trois mousquetaires
dimanche, 03 mai 2020
Le vieil homme et la mer (Hemingway)
 Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »
Il avait un corps étonnant, qu’il a usé, jusqu’au coup de carabine fatal de 1961 quand il s’est senti diminué. Sa vie a été aventureuse, il s’est mis en scène, a été cabotin même, mais c’était aussi pour se dissimuler. Car il a beaucoup écrit, et mûrement, avec toujours un désir de vérité, d’être au plus près de la vie : « Ce qu’il faut c’est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ses dialogues sont un modèle de justesse et d’efficacité (il les rédigeait à la machine à écrire, à cause de la frappe saccadée des touches). Georges Bataille, dans Hemingway à la lumière de Hegel (1953) écrit : « Je veux parler de cette exactitude dans l'expression sensible de la vérité, que nul autre que lui ne me semble avoir atteint. C'est peu de dire que, sous sa plume, la vérité devient saisissante (...) Est souverain celui n'est qui n'est pas lui-même une chose... Il n'y a pas dans son œuvre de tricherie, ni de concession à la lâcheté qui porte à dominer les autres comme les choses. » Le vieil homme et la mer m’a inspiré un jour ce court texte : « Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi. Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas. Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise. Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence. Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et ainsi il se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et il est un formidable joueur en plus. Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force. Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil. » Hemingway a donné dix conseils aux jeunes écrivains : « 1 soyez amoureux. 2 crevez-vous à écrire. 3 regardez le monde. 4 fréquentez les écrivains du bâtiment. 5 ne perdez pas votre temps. 6 écoutez la musique et regardez la peinture. 7 lisez sans cesse. 8 ne cherchez pas à vous expliquer. 9 écoutez votre bon plaisir. 10 taisez-vous. »  Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».
Le début de Paris est une fête est superbe : « Et puis il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain, à la fin de l’automne. Il fallait alors fermer les fenêtres. La nuit, pour empêcher la pluie d’entrer, et le vent froid arrachait les feuilles des arbres, sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées, sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts, au terminus, et le Café des Amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. » Dans Les vertes Collines d’Afrique : « Tout passe et tout lasse, les nations, les individus qui les composent, autant en emporte le vent… Il ne reste que la beauté, transmise par les artistes. » Ou encore : « Tous les bons livres ont en commun d’être plus vrais que la réalité et, après les avoir lus, vous avez l’impression que tout cela s’est produit, que tout cela vous est arrivé et vous appartient à jamais : le bonheur et le malheur, le bien et le mal, la joie et la peine, la nourriture, le vin, les lits, les gens et le temps qu’il faisait. Quand on peut apporter cela à un lecteur, alors on est un véritable écrivain. Et puis : « Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation».
Raymond Alcovère
01:24 Publié dans Grands textes, Histoire littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hemingway


















