Jean-Jacques Marimbert et Bernard Collet présenteront à la galerie Duplex plusieurs de leurs films.
certains "livres-films" de Bernard Collet sont déjà visibles sur le site du cinéma de la littérature : http://www.lecinemadelalitterature.com/
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
04:18 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-jacques marimbert
10:35 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jean-jacques marimbert, hubert le chameau
 Une goutte d’encre est un lac où un ange a chu si brillamment que la corolle noire de l’impact a le poli de la bakélite, la gracile élégance d’une ombelle fraîchement vernissée, en son centre, — en son ventre où disparaît, engloutie, l’aile agile et frêle du messager divin à jamais immergé dans une obscurité liquide et sirupeuse, collant aux plumes,tenant de l’huile usée et du goudron sécrétés par les soutes d’un jadis si majestueux paquebot, éclatant de blancheur lisse, étoilée, rehaussée du sourire perlé des coquillages servis dans des grands plats d’argent sur le rebord desquels, parmi les algues et les poissons en incrustation d’émail, les guirlandes électriques multicolores bercées par la brise mystérieuse, les lèvres nacrées des femmes en vison, les cols satinés des smokings et les épaulettes d’or des uniformes d’apparat se pressaient, s’agglutinaient et s’évanouissaient en un chapelet de reflets, jouant déjà la scène du naufrage, du fatal destin des lourdes chaloupes au chargement livide, — les coquilles, jetées par-dessus bord depuis le pont des cuisines, attendant patiemment leurs nouveaux hôtes, et légèrement les corps s’enfonçant, se frayant un chemin vertical, hésitant et nécessaire, enrobés d’une solitude qui est celle des astres, auréolés d’un lent nuage verdâtre de poussière marine, impalpable et fuyant suaire de leur déliquescence, premier signe de l’inéluctable entropie dont la pierre renferme les strates, ces cris oppressés de la matière qui, en se disloquant, s’affine et, sur la berge, alanguie, s’étale, poudre de nacre scintillante, pure, et conserve un instant l’empreinte incertaine et fugace de l’aile d’un ange imprudent, tandis que les corps rongés et mous, un à un, gonflés d’un ironique besoin de s’élever, remontent à la surface et jouent dans les vagues.
Une goutte d’encre est un lac où un ange a chu si brillamment que la corolle noire de l’impact a le poli de la bakélite, la gracile élégance d’une ombelle fraîchement vernissée, en son centre, — en son ventre où disparaît, engloutie, l’aile agile et frêle du messager divin à jamais immergé dans une obscurité liquide et sirupeuse, collant aux plumes,tenant de l’huile usée et du goudron sécrétés par les soutes d’un jadis si majestueux paquebot, éclatant de blancheur lisse, étoilée, rehaussée du sourire perlé des coquillages servis dans des grands plats d’argent sur le rebord desquels, parmi les algues et les poissons en incrustation d’émail, les guirlandes électriques multicolores bercées par la brise mystérieuse, les lèvres nacrées des femmes en vison, les cols satinés des smokings et les épaulettes d’or des uniformes d’apparat se pressaient, s’agglutinaient et s’évanouissaient en un chapelet de reflets, jouant déjà la scène du naufrage, du fatal destin des lourdes chaloupes au chargement livide, — les coquilles, jetées par-dessus bord depuis le pont des cuisines, attendant patiemment leurs nouveaux hôtes, et légèrement les corps s’enfonçant, se frayant un chemin vertical, hésitant et nécessaire, enrobés d’une solitude qui est celle des astres, auréolés d’un lent nuage verdâtre de poussière marine, impalpable et fuyant suaire de leur déliquescence, premier signe de l’inéluctable entropie dont la pierre renferme les strates, ces cris oppressés de la matière qui, en se disloquant, s’affine et, sur la berge, alanguie, s’étale, poudre de nacre scintillante, pure, et conserve un instant l’empreinte incertaine et fugace de l’aile d’un ange imprudent, tandis que les corps rongés et mous, un à un, gonflés d’un ironique besoin de s’élever, remontent à la surface et jouent dans les vagues.
Jean-Jacques Marimbert, texte paru dans la revue Encres Vagabondes en juin 1999.
Image : d'après une photo de Gildas Pasquet
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-jacques marimbert
10:45 Publié dans Le Bonheur est un drôle de serpent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le bonheur est un drôle de serpent, jean-jacques marimbert, encres vagabondes
 Je me disais, n'y va pas. Tu n'en reviendras pas, trop loin, de tout, de tes mots, de tes chemins. Tu cours les yeux fermés, n'y va pas. Je me disais aussi : ce sont des chemins trop anciens, beaucoup trop, tu vas t'y casser le nez. D'un haussement d'épaule j'ai fait le fier, celui qui a lu Conrad, Bouvier ou je ne sais qui, quand je dis lu, bouffé oui, vite mâché, sans voir que le fil tendu entre les pages me piégeait, me ligotait les pieds. N'y va pas. Tu n'es pas bien ici ? La Garonne, les briques, le tremble au fond du jardin, trois oiseaux, le puits, tari mais un puits, des iris, l'été finissant. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Partir, le verbe a toujours bourdonné, partir. Filer. Vers quoi ? qui ? Un nom, une sonorité, l'ombre d'un nid, le cri d'une chouette : Cotonou. N'y va pas. Reste et rêve, si tu veux, c'est mieux, tu arrêtes tout quand tu veux, tu fermes les yeux et repars quand tu veux ; mais une fois quitté ici, une fois là-bas -- je n'ose même pas t'imaginer là-bas -- que feras-tu ? C'est décidé : tout noter. Ce refus de sauter, je le note. Cotonou. Tu t'attaches trop aux sons. Tu es matérialiste, dans ton genre. Pour un vieux, c'est douteux. Poésie à trois sous, un enfant aurait honte, rirait de toi. Justement, enfant, tu n'es qu'un enfant. Tu m'avais déjà fait le coup. C'est à peine si tu savais lire... Himalaya et hop, tu t'étalais en plein ciel, te vautrais, tout blanc, et l'écho, plus tard tu disais que l'écho habitait le nom comme une salle vide. Himalaya, un cri lointain et long écho, i...a...a...a..., sur à-pic blancs, rochers pointus, turlututu ! Pareil avec Istanbul, Valparaiso, Médines et des tas, des tas de villes. Même pas. De la musique ? Rien que de la musique ? Tu as beau accélérer le pas, tu vas rater l'avion, il le faut. Tu sais rater un avion, tu l'as déjà fait, tu les as tous ratés jusqu'à présent, alors un de plus... Tu peux tirer ta valoche, pas usée par les soutes des longs courriers, ça non ! Et puis tu es vieux ! Penses-y : dans trois fois rien septante ! Avant, passe encore, brin de folie, le regard vacillant devant une photo, nez collé à la vitrine d'une agence de voyages, cocotiers, paquebots, châteaux forts, casbahs, ces noms, même pas les lieux, les noms. Une vraie collection sur tes cahiers, pas classés, au hasard. Preuve, tu n'as jamais été bon en géo. Mais qui te parle de géographie ? Je veux seulement savoir ce qu'il y a dans ce nom. C'est la terre qui importe. La terre ou la Terre ? La géo c'est de la couture, voyage immobile sur un bâti, et moi je désorganisais, je glissais toujours au-delà des faufils, longs pointillés pour préparer la guerre, on connaît, ailleurs c'était mieux, et une fois là, je prenais n'importe quelle route, une ligne de dénivelé, un fleuve, j'évitais les villes, je sautais les reliefs, je planais sur les Océans ! La Terre. Tu fermais les yeux, tu disais : "la Terre !" Un enfant, ça se comprend, mais tu as mal aux os, arthrose, tu craques de partout, tu oublies... La terre m'a toujours ému. J'aurais aimé être vigie et crier "Terre !" après des mois de mer, de solitude, de soleil à n'en plus pouvoir. C'est ton côté stylite ! Grimper à la grand'hune du monde et rêvasser, faire d'un nid de pie ton territoire, ta patrie, à deux pas du divin pour ainsi dire. "Terre !" Libération ! Déflagration ! La mer est là, le ciel immense, quel vent!, naseaux salés, tout tangue et roule, "Terre !" L'air expulsé, jusque-là confiné par un coup de glotte tétanisé, précieux viatique en vue de ce seul moment où libéré il te coupe le sifflet ! Avec la mer, mouillé, avec le fer, feu. Mais terre, c'est solide, le sol tremble sous le talon, juste avant la douceur de l'air, à poumons fermés. Souffle inouï, d'emblée scindé, sifflé, empêché, murmuré, rauque. Air vague ou tassé, feulé, toujours teinté, aux couleurs du temps. L'air du temps, voilà la terre, rouge ici, brune, ocre jaune, noire, pâleur de nacre au fond d'un ravin, et c'est de l'eau qui coule, irrigue, inonde, recouvre. Et sous le terre, terre encore, tôt ou tard enfouie, tassée, aussi noire que lait dessous, là où tout se joue, tes os, dans le secret des odeurs musquées, d'invisibles copulations moléculaires au hasard d'ondulations symphoniques, déplacement mathématique des astres. N'y va pas. Tu rentreras déglingué, perclus de symptômes bizarres dont personne ici ne saura quoi te dire. Croûte latéritique des régions tropicales, alumine, oxyde de fer. Latérite, sang de brique d'où sourd l'humide ambiguïté, le bois parfait, totémique. N'y va pas. À Cotonou, tu ne connais personne. Justement. Tu te vois en Afrique ? Désert, ou bien indescriptible fouillis végétal et humain, au choix ! Entre les deux, des zones inclassables, des acacias avec des épines grandes comme ça, à peine de bois tordu, pâle, calciné par le sable, pour faire cuire des riens, quelques chèvres, un puits tous les..., des chameaux qui se dandinent en blatérant ! Toi tu veux aller plus loin, encore plus loin, là où tout est enchevêtré, inextricable ? Il paraît que tout pousse à une allure folle, que l'humidité, parlons-en, l'humidité n'est pas qu'un mot ! Et ça grouille, bestioles, insectes, racines, les villages bouffés au termites, les enfants faméliques, les yeux traversés de filaires et... Qu'est-ce que tu me chantes ! Je tire ma valise. J'emporte trop de trucs. À tous les coups je vais avoir un excédent de bagages. N'y va pas. J'ai peur. Ouf ! De justesse, la voilà dans la file sur le tapis roulant. Toujours glacé, ces aéroports, illisibles ces billets d'embarquement. Monde fou. Si j'avais pu y aller en bateau ! Porte 48, immédiat. Il fait un froid de canard dans ce coucou ! Une revue, papier glacé, dossier sur la Suède, je sors mon pull et ma carte : Afrique de l'Ouest. Je regarde cette épaule de l'Océan et ne vois rien. Lanières multicolores des pays découpés dans la chair, galons d'une uniforme de carnaval. C'est bon, on vole. La clim' me fait claquer des dents. Toute la nuit comme ça ! Le plaid est minuscule, on va finir gelés. Vers l'avant, un écran muet où s'agite une fille et un gars qui s'engueulent, non, ils rigolent, ne savent pas ce qu'ils veulent, je mets le casque, anglais, j'appuie, allemand, le fil se débranche, ils s'embrassent à bouche goulue, ma voisine sors un masque de décontraction, il fait de plus en plus froid. Je cale mon regard entre Togo et Nigeria, fais le Yo-Yo du nord au sud, accroche çà et là des syllabes vides, rejoins le sud, l'eau, Cotonou, bleu atlantique, ocre béninois. L'atmosphère se stabilise entre vibration et relative apesanteur. Je me lève pour dérouiller mes poulies, manque rester pour l'éternité dans le cercueil des toilettes, décide de dormir jusqu'aubout du voyage. L'écran est mort. Ma voisine est livide, légèrement bleutée. Ici et là, des corps affalés. La carlingue fonce dans la nuit. Je sonne l'hôtesse, superbe métisse type antilope. Je finis par somnoler en suçotant un armagnac parcimonieux. Plus que six heures ! Une ribambelle hétéroclite d'impressions, des images par vagues molles cheminent derrière mes paupières. Je recompose à tâtons l'itinéraire qui m'a mené à ce siège étroit, dur, inconfortable. La pêche est maigre. Toujours revient une fascination ancienne, indatable, détachée de tout souvenir d'enfance, cependant étrangère à aucun. Un mélange pâteux m'envahit, où germe, incertaine puis évidente, la nécessité de ne pas mourir sans avoir vu la Côte des Esclaves.
Je me disais, n'y va pas. Tu n'en reviendras pas, trop loin, de tout, de tes mots, de tes chemins. Tu cours les yeux fermés, n'y va pas. Je me disais aussi : ce sont des chemins trop anciens, beaucoup trop, tu vas t'y casser le nez. D'un haussement d'épaule j'ai fait le fier, celui qui a lu Conrad, Bouvier ou je ne sais qui, quand je dis lu, bouffé oui, vite mâché, sans voir que le fil tendu entre les pages me piégeait, me ligotait les pieds. N'y va pas. Tu n'es pas bien ici ? La Garonne, les briques, le tremble au fond du jardin, trois oiseaux, le puits, tari mais un puits, des iris, l'été finissant. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Partir, le verbe a toujours bourdonné, partir. Filer. Vers quoi ? qui ? Un nom, une sonorité, l'ombre d'un nid, le cri d'une chouette : Cotonou. N'y va pas. Reste et rêve, si tu veux, c'est mieux, tu arrêtes tout quand tu veux, tu fermes les yeux et repars quand tu veux ; mais une fois quitté ici, une fois là-bas -- je n'ose même pas t'imaginer là-bas -- que feras-tu ? C'est décidé : tout noter. Ce refus de sauter, je le note. Cotonou. Tu t'attaches trop aux sons. Tu es matérialiste, dans ton genre. Pour un vieux, c'est douteux. Poésie à trois sous, un enfant aurait honte, rirait de toi. Justement, enfant, tu n'es qu'un enfant. Tu m'avais déjà fait le coup. C'est à peine si tu savais lire... Himalaya et hop, tu t'étalais en plein ciel, te vautrais, tout blanc, et l'écho, plus tard tu disais que l'écho habitait le nom comme une salle vide. Himalaya, un cri lointain et long écho, i...a...a...a..., sur à-pic blancs, rochers pointus, turlututu ! Pareil avec Istanbul, Valparaiso, Médines et des tas, des tas de villes. Même pas. De la musique ? Rien que de la musique ? Tu as beau accélérer le pas, tu vas rater l'avion, il le faut. Tu sais rater un avion, tu l'as déjà fait, tu les as tous ratés jusqu'à présent, alors un de plus... Tu peux tirer ta valoche, pas usée par les soutes des longs courriers, ça non ! Et puis tu es vieux ! Penses-y : dans trois fois rien septante ! Avant, passe encore, brin de folie, le regard vacillant devant une photo, nez collé à la vitrine d'une agence de voyages, cocotiers, paquebots, châteaux forts, casbahs, ces noms, même pas les lieux, les noms. Une vraie collection sur tes cahiers, pas classés, au hasard. Preuve, tu n'as jamais été bon en géo. Mais qui te parle de géographie ? Je veux seulement savoir ce qu'il y a dans ce nom. C'est la terre qui importe. La terre ou la Terre ? La géo c'est de la couture, voyage immobile sur un bâti, et moi je désorganisais, je glissais toujours au-delà des faufils, longs pointillés pour préparer la guerre, on connaît, ailleurs c'était mieux, et une fois là, je prenais n'importe quelle route, une ligne de dénivelé, un fleuve, j'évitais les villes, je sautais les reliefs, je planais sur les Océans ! La Terre. Tu fermais les yeux, tu disais : "la Terre !" Un enfant, ça se comprend, mais tu as mal aux os, arthrose, tu craques de partout, tu oublies... La terre m'a toujours ému. J'aurais aimé être vigie et crier "Terre !" après des mois de mer, de solitude, de soleil à n'en plus pouvoir. C'est ton côté stylite ! Grimper à la grand'hune du monde et rêvasser, faire d'un nid de pie ton territoire, ta patrie, à deux pas du divin pour ainsi dire. "Terre !" Libération ! Déflagration ! La mer est là, le ciel immense, quel vent!, naseaux salés, tout tangue et roule, "Terre !" L'air expulsé, jusque-là confiné par un coup de glotte tétanisé, précieux viatique en vue de ce seul moment où libéré il te coupe le sifflet ! Avec la mer, mouillé, avec le fer, feu. Mais terre, c'est solide, le sol tremble sous le talon, juste avant la douceur de l'air, à poumons fermés. Souffle inouï, d'emblée scindé, sifflé, empêché, murmuré, rauque. Air vague ou tassé, feulé, toujours teinté, aux couleurs du temps. L'air du temps, voilà la terre, rouge ici, brune, ocre jaune, noire, pâleur de nacre au fond d'un ravin, et c'est de l'eau qui coule, irrigue, inonde, recouvre. Et sous le terre, terre encore, tôt ou tard enfouie, tassée, aussi noire que lait dessous, là où tout se joue, tes os, dans le secret des odeurs musquées, d'invisibles copulations moléculaires au hasard d'ondulations symphoniques, déplacement mathématique des astres. N'y va pas. Tu rentreras déglingué, perclus de symptômes bizarres dont personne ici ne saura quoi te dire. Croûte latéritique des régions tropicales, alumine, oxyde de fer. Latérite, sang de brique d'où sourd l'humide ambiguïté, le bois parfait, totémique. N'y va pas. À Cotonou, tu ne connais personne. Justement. Tu te vois en Afrique ? Désert, ou bien indescriptible fouillis végétal et humain, au choix ! Entre les deux, des zones inclassables, des acacias avec des épines grandes comme ça, à peine de bois tordu, pâle, calciné par le sable, pour faire cuire des riens, quelques chèvres, un puits tous les..., des chameaux qui se dandinent en blatérant ! Toi tu veux aller plus loin, encore plus loin, là où tout est enchevêtré, inextricable ? Il paraît que tout pousse à une allure folle, que l'humidité, parlons-en, l'humidité n'est pas qu'un mot ! Et ça grouille, bestioles, insectes, racines, les villages bouffés au termites, les enfants faméliques, les yeux traversés de filaires et... Qu'est-ce que tu me chantes ! Je tire ma valise. J'emporte trop de trucs. À tous les coups je vais avoir un excédent de bagages. N'y va pas. J'ai peur. Ouf ! De justesse, la voilà dans la file sur le tapis roulant. Toujours glacé, ces aéroports, illisibles ces billets d'embarquement. Monde fou. Si j'avais pu y aller en bateau ! Porte 48, immédiat. Il fait un froid de canard dans ce coucou ! Une revue, papier glacé, dossier sur la Suède, je sors mon pull et ma carte : Afrique de l'Ouest. Je regarde cette épaule de l'Océan et ne vois rien. Lanières multicolores des pays découpés dans la chair, galons d'une uniforme de carnaval. C'est bon, on vole. La clim' me fait claquer des dents. Toute la nuit comme ça ! Le plaid est minuscule, on va finir gelés. Vers l'avant, un écran muet où s'agite une fille et un gars qui s'engueulent, non, ils rigolent, ne savent pas ce qu'ils veulent, je mets le casque, anglais, j'appuie, allemand, le fil se débranche, ils s'embrassent à bouche goulue, ma voisine sors un masque de décontraction, il fait de plus en plus froid. Je cale mon regard entre Togo et Nigeria, fais le Yo-Yo du nord au sud, accroche çà et là des syllabes vides, rejoins le sud, l'eau, Cotonou, bleu atlantique, ocre béninois. L'atmosphère se stabilise entre vibration et relative apesanteur. Je me lève pour dérouiller mes poulies, manque rester pour l'éternité dans le cercueil des toilettes, décide de dormir jusqu'aubout du voyage. L'écran est mort. Ma voisine est livide, légèrement bleutée. Ici et là, des corps affalés. La carlingue fonce dans la nuit. Je sonne l'hôtesse, superbe métisse type antilope. Je finis par somnoler en suçotant un armagnac parcimonieux. Plus que six heures ! Une ribambelle hétéroclite d'impressions, des images par vagues molles cheminent derrière mes paupières. Je recompose à tâtons l'itinéraire qui m'a mené à ce siège étroit, dur, inconfortable. La pêche est maigre. Toujours revient une fascination ancienne, indatable, détachée de tout souvenir d'enfance, cependant étrangère à aucun. Un mélange pâteux m'envahit, où germe, incertaine puis évidente, la nécessité de ne pas mourir sans avoir vu la Côte des Esclaves.
Latérite : Jean-Jacques Marimbert (texte paru dans la revue L'instant du Monde).
00:17 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-jacques marimbert, bona mangangu
 J’ai connu Manuel Portales. C’est le fait du hasard. Enfin, je ne suis plus sûr de rien. J’invoque le hasard par lâcheté intellectuelle, peut-être.
J’ai connu Manuel Portales. C’est le fait du hasard. Enfin, je ne suis plus sûr de rien. J’invoque le hasard par lâcheté intellectuelle, peut-être.
Certaines nuits, tiré de mon lit par l’idée qu’une puissance se jouerait de nous, je me précipite dans la salle de bains et, agrippé au lavabo, je plante mon regard dans la glace mouchetée de dentifrice. J’interroge mon visage, au cœur, pleines pupilles. Je scrute mon front, mes joues, mes paupières et sous le néon hollywoodien, me frayant un chemin spirituel entre la mousse hypoallergénique et la brosse échevelée, tel un idiot épris de métaphysique, je suis à l’affût. Rien jamais ne se passe, bien sûr, pas le moindre frémissement hormis l’agacement ironique des commissures, pas le plus petit signe d’un au-delà circulant dans mes rides, à moins de considérer que cette esquisse au coin des lèvres… Balivernes ! N’empêche. Une fois, perdu dans cette contemplation stupide, hagard à force de benzodiazépine, j’ai basculé de la lisière des cils au désert de dunes frangé de touffes sèches au nord du Sahara et, manque de sommeil ou larmoiement blafard, je me suis retrouvé à la sortie d’El Golea une fin d’après-midi. Soleil déclinant, j’ai vingt-cinq ans face à l’horizon de sable aux allures de mer rouge, ou mieux, m’étais-je dit appuyé sur l’aile cabossée de ma 2CV, d’océan asséché, me remémorant le fond sablonneux d’une plage de mon enfance tangéroise, quand par le hublot du masque, dans le crachottement salé du tuba, j’observais la tôle ondulée où venaient fondre de pâles rayons habités d’algues et de plancton. Je n’ai opposé aucune résistance au phénomène, trop heureux de pouvoir justifier ma lubie. Par jeu plus que par conviction, je m’engouffrai dans l’hallucination pour nourrir des idées du genre “tout est dans tout”, “le temps ne s’écoule pas sinon il s’écoulerait en lui-même”, “l’éternité est l’implosion du temps”, et autres absurdités qu’aussitôt remis sur rails je balayai d’un café serré. Profitant tout de même de l’entre-deux qui blanchit le ciel, je revisitai ce coin paisible de l’oasis d’El Golea, œil creusé en bordure de l’erg, au moment où, de la palmeraie, le parfum des tomates et des orangers fait de l’espace un écrin de roseaux. De là à admettre que notre vie ne tiendrait qu’à un fil agité par je ne sais quoi ou qui, Destin, Dieu ou Génie, toutes ces sottises de bibliothèque médiévale et de chapelle bourdonnante, il y a loin. Pourtant, qui a connu Manuel Portales comprendra mes doutes et mon inquiétude. Je rapporte ce qui suit pour les autres, tout autant que pour moi, je l’avoue.
À l’hôpital, nous étions voisins de chambre. Moi, pour une hernie ombilicale. Lui, je n’ai jamais su avec certitude. Il attendait des résultats d’examens qui, à ma connaissance, ne lui ont jamais été communiqués. J’ai alors su ce qu’attendre veut dire. Mieux vaut se pendre ou partir en courant.
Jean-Jacques Marimbert
Photo de Nicolas Bouvier
05:33 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jean-jacques marimbert
Départ, le retour. 16 min, 2006.
Réalisation et texte inédit : Jean-Jacques Marimbert
Texte : Départ, Editions La Renarde Rouge, 2002
21:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : départ, jean-jacques marimbert
 ô balançoire ! ô lys ! Clysopompes d'argent !
ô balançoire ! ô lys ! Clysopompes d'argent !
Dédaigneux des travaux, dédaigneux des famines !
L'aurore vous emplit d'un amour détergent !
Une douceur de ciel beurre vos étamines !
Rimbaud, Album zutique
Photo de Jean-Jacques Marimbert, Cathédrale d'Albi
00:15 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, rimbaud, album zutique, lys, jean-jacques marimbert
 Lecture-Film le vendredi 21 novembre à 20h, à Toulouse.
Lecture-Film le vendredi 21 novembre à 20h, à Toulouse.Jean-Jacques Marimbert et Bernard Collet présenteront à la galerie Duplex plusieurs de leurs films.
certains "livres-films" de Bernard Collet sont déjà visibles sur le site du cinéma de la littérature : http://www.lecinemadelalitterature.com/
00:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, littérature, jean-jacques marimbert, bernard collet
 Je ne rêve pas, c’est bien Harlem. Des néons clignotent, Minton's Playhouse, halo vanille-sang rogné par le soleil levant. Depuis quand suis-je là, au bord du temps ? Un bail, à croire mon corps pétri jusqu’à la moelle par la jam et le gin qui toute la nuit ont coulé sur le zinc mythique.
Je ne rêve pas, c’est bien Harlem. Des néons clignotent, Minton's Playhouse, halo vanille-sang rogné par le soleil levant. Depuis quand suis-je là, au bord du temps ? Un bail, à croire mon corps pétri jusqu’à la moelle par la jam et le gin qui toute la nuit ont coulé sur le zinc mythique.
Dès l’enfance, le jazz m’a initié aux syncopes du monde, aux ruades de l’âme, dans une famille d’Italiens musiciens, chassés de la botte par la faim, via Nice, jusqu’au Maroc de Lyautey où, un demi-siècle plus tard, les Américains ont débarqué avec les galettes de Softly As In A Morning Sunrise et Sentimental Journey. Sur le Pleyel de la grand-mère, le glissando du Boléro au boogie s’est fait naturellement. Du Pô au Mississippi, la mandoline s’est muée en une six-cordes caressée par Skip James. Le bel canto s’est mis à mâcher le chewing-gum existentiel sous un soleil sans vibrato, exilé dans une capsule de bière collée sous la semelle. Allez, Lightin’, tape du pied! I got something to tell you, Make the hair rise on your head, Well I got a new way of loving, Make the springs scrinch on your bed ! Cheveux dressés sur ma cervelle en marmelade, j'ose à peine touiller ma vie intérieure. Comment j’ai fait pour me retrouver sur le trottoir du Minton's, faudrait le demander au Grand Horloger, mais exit Newton, le temps c’est pipeau et contrebasse, l’espace tient dans un harmonica trituré par Sonny Boy Williamson. Mon magnéto en bandoulière est brûlant, gonflé à bloc de noires et de blanches crochetées dans une fumée d’extase, le brouhaha d’esprits électrisés par Charlie Christian. Immémorial Stompin’ At The Savoy !
Encore sonné, je flotte. À ma droite, guitare sur l’épaule, Charlie a des yeux de lapin ouverts sur le dedans. Pas frais le génie du be-bop, tout rongé, mais du feu sous la peau. Le pianiste nous rejoint, blues au bec. Nous voilà partis vers l’hôtel, à deux pas, mais le film saute.
Coup de canon, il est midi. Je suis à la terrasse d’un café, marché aux Fleurs à Nice. Phébus tape allègrement. Devant moi, un vieux black hilare. Tout me revient en rafale. Hier soir, du beau monde à la Parade du Jazz, Cimiez noir de monde, B.B. King aux Arènes pour les étoiles et puis le trou. Je rate le dernier bus, traîne en coulisse. La bibine circule. Le batteur de Slam Stewart m’emmène, veut faire la Grande Corniche, vider une bouteille face à la mer. On grimpe à Saint-Michel, féérique. Il pleure de joie, fredonne un Spiritual et, scrutant l’horizon tracé par un cargo métaphysique, déroule sa vie dans une langue pâteuse. Il a connu Duke, Parker, Monk, Miles, Coltrane… Le soleil s’impatiente et tire un trait sur la nuit. Il me raconte le Minton's, quand Charlie brodait sur Stompin’ At The Savoy, en mai 41. Non, il ne se souvient pas du pianiste.
Il met son chapeau et se lève. Allez, au lit ! Faut pas trop chahuter les planètes, sinon on perd la boule.
Jean-Jacques Marimbert
Notes sur l'auteur : Né au Maroc au milieu du XXe siècle. Médecin quelques années à l'hôpital, dans la région toulousaine ; mission en 1980 avec MSF dans un camp de réfugiés en Somalie. PRAG de philosophie à l'Université de Toulouse-Le Mirail depuis 2001. Écrit et publie depuis 1995. Dernier livre paru : Le Corps de l’océan, coll. Carnets des Sept collines, Éd. J.-P. Huguet, 2007.
Jazz en vrac : tableau de Ginette Ayral, voir ici son site
00:15 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, musique, jazz, jean-jacques marimbert, ginette ayral

 Parution de : "Analyse d'une oeuvre : la mort aux trousses"
Parution de : "Analyse d'une oeuvre : la mort aux trousses"
Sous la direction de Jean-Jacques Marimbert, éditions Vrin
00:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, philosophie, hitchcock, jean-jacques marimbert, vrin, la mort aux trousses
 A très bientôt...
A très bientôt...
Photo de Jean-Jacques Marimbert, Valras Plage
10:28 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : photo, jean-jacques marimbert, valras
 USINE SAINTE MARTHE, LE PRÉ BATTOIR 42220 SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE
USINE SAINTE MARTHE, LE PRÉ BATTOIR 42220 SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE
Samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2008
Jean-Jacques Marimbert y présentera son film :
Le corps de l’océan ( 12’30) 2008 Texte et voix Jacques Marimbert. Extrait de : Le corps de l’océan Editions Jean-Pierre Huguet Carnet des 7 collines. 2007
(Images extraites du film)
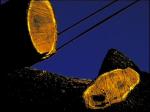
09:35 Publié dans Evénements | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, littérature, jean-jacques marimbert
 Je me disais, n'y va pas. Tu n'en reviendras pas, trop loin, de tout, de tes mots, de tes chemins. Tu cours les yeux fermés, n'y va pas. Je me disais aussi : ce sont des chemins trop anciens, beaucoup trop, tu vas t'y casser le nez. D'un haussement d'épaule j'ai fait le fier, celui qui a lu Conrad, Bouvier ou je ne sais qui, quand je dis lu, bouffé oui, vite mâché, sans voir que le fil tendu entre les pages me piégeait, me ligotait les pieds. N'y va pas. Tu n'es pas bien ici ? La Garonne, les briques, le tremble au fond du jardin, trois oiseaux, le puits, tari mais un puits, des iris, l'été finissant. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Partir, le verbe a toujours bourdonné, partir. Filer. Vers quoi ? qui ? Un nom, une sonorité, l'ombre d'un nid, le cri d'une chouette : Cotonou. N'y va pas. Reste et rêve, si tu veux, c'est mieux, tu arrêtes tout quand tu veux, tu fermes les yeux et repars quand tu veux ; mais une fois quitté ici, une fois là-bas -- je n'ose même pas t'imaginer là-bas -- que feras-tu ? C'est décidé : tout noter. Ce refus de sauter, je le note. Cotonou. Tu t'attaches trop aux sons. Tu es matérialiste, dans ton genre. Pour un vieux, c'est douteux. Poésie à trois sous, un enfant aurait honte, rirait de toi. Justement, enfant, tu n'es qu'un enfant. Tu m'avais déjà fait le coup. C'est à peine si tu savais lire... Himalaya et hop, tu t'étalais en plein ciel, te vautrais, tout blanc, et l'écho, plus tard tu disais que l'écho habitait le nom comme une salle vide. Himalaya, un cri lointain et long écho, i...a...a...a..., sur à-pic blancs, rochers pointus, turlututu ! Pareil avec Istanbul, Valparaiso, Médines et des tas, des tas de villes. Même pas. De la musique ? Rien que de la musique ? Tu as beau accélérer le pas, tu vas rater l'avion, il le faut. Tu sais rater un avion, tu l'as déjà fait, tu les as tous ratés jusqu'à présent, alors un de plus... Tu peux tirer ta valoche, pas usée par les soutes des longs courriers, ça non ! Et puis tu es vieux ! Penses-y : dans trois fois rien septante ! Avant, passe encore, brin de folie, le regard vacillant devant une photo, nez collé à la vitrine d'une agence de voyages, cocotiers, paquebots, châteaux forts, casbahs, ces noms, même pas les lieux, les noms. Une vraie collection sur tes cahiers, pas classés, au hasard. Preuve, tu n'as jamais été bon en géo. Mais qui te parle de géographie ? Je veux seulement savoir ce qu'il y a dans ce nom. C'est la terre qui importe. La terre ou la Terre ? La géo c'est de la couture, voyage immobile sur un bâti, et moi je désorganisais, je glissais toujours au-delà des faufils, longs pointillés pour préparer la guerre, on connaît, ailleurs c'était mieux, et une fois là, je prenais n'importe quelle route, une ligne de dénivelé, un fleuve, j'évitais les villes, je sautais les reliefs, je planais sur les Océans ! La Terre. Tu fermais les yeux, tu disais : "la Terre !" Un enfant, ça se comprend, mais tu as mal aux os, arthrose, tu craques de partout, tu oublies... La terre m'a toujours ému. J'aurais aimé être vigie et crier "Terre !" après des mois de mer, de solitude, de soleil à n'en plus pouvoir. C'est ton côté stylite ! Grimper à la grand'hune du monde et rêvasser, faire d'un nid de pie ton territoire, ta patrie, à deux pas du divin pour ainsi dire. "Terre !" Libération ! Déflagration ! La mer est là, le ciel immense, quel vent!, naseaux salés, tout tangue et roule, "Terre !" L'air expulsé, jusque-là confiné par un coup de glotte tétanisé, précieux viatique en vue de ce seul moment où libéré il te coupe le sifflet ! Avec la mer, mouillé, avec le fer, feu. Mais terre, c'est solide, le sol tremble sous le talon, juste avant la douceur de l'air, à poumons fermés. Souffle inouï, d'emblée scindé, sifflé, empêché, murmuré, rauque. Air vague ou tassé, feulé, toujours teinté, aux couleurs du temps. L'air du temps, voilà la terre, rouge ici, brune, ocre jaune, noire, pâleur de nacre au fond d'un ravin, et c'est de l'eau qui coule, irrigue, inonde, recouvre. Et sous le terre, terre encore, tôt ou tard enfouie, tassée, aussi noire que lait dessous, là où tout se joue, tes os, dans le secret des odeurs musquées, d'invisibles copulations moléculaires au hasard d'ondulations symphoniques, déplacement mathématique des astres. N'y va pas. Tu rentreras déglingué, perclus de symptômes bizarres dont personne ici ne saura quoi te dire. Croûte latéritique des régions tropicales, alumine, oxyde de fer. Latérite, sang de brique d'où sourd l'humide ambiguïté, le bois parfait, totémique. N'y va pas. À Cotonou, tu ne connais personne. Justement. Tu te vois en Afrique ? Désert, ou bien indescriptible fouillis végétal et humain, au choix ! Entre les deux, des zones inclassables, des acacias avec des épines grandes comme ça, à peine de bois tordu, pâle, calciné par le sable, pour faire cuire des riens, quelques chèvres, un puits tous les..., des chameaux qui se dandinent en blatérant ! Toi tu veux aller plus loin, encore plus loin, là où tout est enchevêtré, inextricable ? Il paraît que tout pousse à une allure folle, que l'humidité, parlons-en, l'humidité n'est pas qu'un mot ! Et ça grouille, bestioles, insectes, racines, les villages bouffés au termites, les enfants faméliques, les yeux traversés de filaires et... Qu'est-ce que tu me chantes ! Je tire ma valise. J'emporte trop de trucs. À tous les coups je vais avoir un excédent de bagages. N'y va pas. J'ai peur. Ouf ! De justesse, la voilà dans la file sur le tapis roulant. Toujours glacé, ces aéroports, illisibles ces billets d'embarquement. Monde fou. Si j'avais pu y aller en bateau ! Porte 48, immédiat. Il fait un froid de canard dans ce coucou ! Une revue, papier glacé, dossier sur la Suède, je sors mon pull et ma carte : Afrique de l'Ouest. Je regarde cette épaule de l'Océan et ne vois rien. Lanières multicolores des pays découpés dans la chair, galons d'une uniforme de carnaval. C'est bon, on vole. La clim' me fait claquer des dents. Toute la nuit comme ça ! Le plaid est minuscule, on va finir gelés. Vers l'avant, un écran muet où s'agite une fille et un gars qui s'engueulent, non, ils rigolent, ne savent pas ce qu'ils veulent, je mets le casque, anglais, j'appuie, allemand, le fil se débranche, ils s'embrassent à bouche goulue, ma voisine sors un masque de décontraction, il fait de plus en plus froid. Je cale mon regard entre Togo et Nigeria, fais le Yo-Yo du nord au sud, accroche çà et là des syllabes vides, rejoins le sud, l'eau, Cotonou, bleu atlantique, ocre béninois. L'atmosphère se stabilise entre vibration et relative apesanteur. Je me lève pour dérouiller mes poulies, manque rester pour l'éternité dans le cercueil des toilettes, décide de dormir jusqu'aubout du voyage. L'écran est mort. Ma voisine est livide, légèrement bleutée. Ici et là, des corps affalés. La carlingue fonce dans la nuit. Je sonne l'hôtesse, superbe métisse type antilope. Je finis par somnoler en suçotant un armagnac parcimonieux. Plus que six heures ! Une ribambelle hétéroclite d'impressions, des images par vagues molles cheminent derrière mes paupières. Je recompose à tâtons l'itinéraire qui m'a mené à ce siège étroit, dur, inconfortable. La pêche est maigre. Toujours revient une fascination ancienne, indatable, détachée de tout souvenir d'enfance, cependant étrangère à aucun. Un mélange pâteux m'envahit, où germe, incertaine puis évidente, la nécessité de ne pas mourir sans avoir vu la Côte des Esclaves.
Je me disais, n'y va pas. Tu n'en reviendras pas, trop loin, de tout, de tes mots, de tes chemins. Tu cours les yeux fermés, n'y va pas. Je me disais aussi : ce sont des chemins trop anciens, beaucoup trop, tu vas t'y casser le nez. D'un haussement d'épaule j'ai fait le fier, celui qui a lu Conrad, Bouvier ou je ne sais qui, quand je dis lu, bouffé oui, vite mâché, sans voir que le fil tendu entre les pages me piégeait, me ligotait les pieds. N'y va pas. Tu n'es pas bien ici ? La Garonne, les briques, le tremble au fond du jardin, trois oiseaux, le puits, tari mais un puits, des iris, l'été finissant. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Partir, le verbe a toujours bourdonné, partir. Filer. Vers quoi ? qui ? Un nom, une sonorité, l'ombre d'un nid, le cri d'une chouette : Cotonou. N'y va pas. Reste et rêve, si tu veux, c'est mieux, tu arrêtes tout quand tu veux, tu fermes les yeux et repars quand tu veux ; mais une fois quitté ici, une fois là-bas -- je n'ose même pas t'imaginer là-bas -- que feras-tu ? C'est décidé : tout noter. Ce refus de sauter, je le note. Cotonou. Tu t'attaches trop aux sons. Tu es matérialiste, dans ton genre. Pour un vieux, c'est douteux. Poésie à trois sous, un enfant aurait honte, rirait de toi. Justement, enfant, tu n'es qu'un enfant. Tu m'avais déjà fait le coup. C'est à peine si tu savais lire... Himalaya et hop, tu t'étalais en plein ciel, te vautrais, tout blanc, et l'écho, plus tard tu disais que l'écho habitait le nom comme une salle vide. Himalaya, un cri lointain et long écho, i...a...a...a..., sur à-pic blancs, rochers pointus, turlututu ! Pareil avec Istanbul, Valparaiso, Médines et des tas, des tas de villes. Même pas. De la musique ? Rien que de la musique ? Tu as beau accélérer le pas, tu vas rater l'avion, il le faut. Tu sais rater un avion, tu l'as déjà fait, tu les as tous ratés jusqu'à présent, alors un de plus... Tu peux tirer ta valoche, pas usée par les soutes des longs courriers, ça non ! Et puis tu es vieux ! Penses-y : dans trois fois rien septante ! Avant, passe encore, brin de folie, le regard vacillant devant une photo, nez collé à la vitrine d'une agence de voyages, cocotiers, paquebots, châteaux forts, casbahs, ces noms, même pas les lieux, les noms. Une vraie collection sur tes cahiers, pas classés, au hasard. Preuve, tu n'as jamais été bon en géo. Mais qui te parle de géographie ? Je veux seulement savoir ce qu'il y a dans ce nom. C'est la terre qui importe. La terre ou la Terre ? La géo c'est de la couture, voyage immobile sur un bâti, et moi je désorganisais, je glissais toujours au-delà des faufils, longs pointillés pour préparer la guerre, on connaît, ailleurs c'était mieux, et une fois là, je prenais n'importe quelle route, une ligne de dénivelé, un fleuve, j'évitais les villes, je sautais les reliefs, je planais sur les Océans ! La Terre. Tu fermais les yeux, tu disais : "la Terre !" Un enfant, ça se comprend, mais tu as mal aux os, arthrose, tu craques de partout, tu oublies... La terre m'a toujours ému. J'aurais aimé être vigie et crier "Terre !" après des mois de mer, de solitude, de soleil à n'en plus pouvoir. C'est ton côté stylite ! Grimper à la grand'hune du monde et rêvasser, faire d'un nid de pie ton territoire, ta patrie, à deux pas du divin pour ainsi dire. "Terre !" Libération ! Déflagration ! La mer est là, le ciel immense, quel vent!, naseaux salés, tout tangue et roule, "Terre !" L'air expulsé, jusque-là confiné par un coup de glotte tétanisé, précieux viatique en vue de ce seul moment où libéré il te coupe le sifflet ! Avec la mer, mouillé, avec le fer, feu. Mais terre, c'est solide, le sol tremble sous le talon, juste avant la douceur de l'air, à poumons fermés. Souffle inouï, d'emblée scindé, sifflé, empêché, murmuré, rauque. Air vague ou tassé, feulé, toujours teinté, aux couleurs du temps. L'air du temps, voilà la terre, rouge ici, brune, ocre jaune, noire, pâleur de nacre au fond d'un ravin, et c'est de l'eau qui coule, irrigue, inonde, recouvre. Et sous le terre, terre encore, tôt ou tard enfouie, tassée, aussi noire que lait dessous, là où tout se joue, tes os, dans le secret des odeurs musquées, d'invisibles copulations moléculaires au hasard d'ondulations symphoniques, déplacement mathématique des astres. N'y va pas. Tu rentreras déglingué, perclus de symptômes bizarres dont personne ici ne saura quoi te dire. Croûte latéritique des régions tropicales, alumine, oxyde de fer. Latérite, sang de brique d'où sourd l'humide ambiguïté, le bois parfait, totémique. N'y va pas. À Cotonou, tu ne connais personne. Justement. Tu te vois en Afrique ? Désert, ou bien indescriptible fouillis végétal et humain, au choix ! Entre les deux, des zones inclassables, des acacias avec des épines grandes comme ça, à peine de bois tordu, pâle, calciné par le sable, pour faire cuire des riens, quelques chèvres, un puits tous les..., des chameaux qui se dandinent en blatérant ! Toi tu veux aller plus loin, encore plus loin, là où tout est enchevêtré, inextricable ? Il paraît que tout pousse à une allure folle, que l'humidité, parlons-en, l'humidité n'est pas qu'un mot ! Et ça grouille, bestioles, insectes, racines, les villages bouffés au termites, les enfants faméliques, les yeux traversés de filaires et... Qu'est-ce que tu me chantes ! Je tire ma valise. J'emporte trop de trucs. À tous les coups je vais avoir un excédent de bagages. N'y va pas. J'ai peur. Ouf ! De justesse, la voilà dans la file sur le tapis roulant. Toujours glacé, ces aéroports, illisibles ces billets d'embarquement. Monde fou. Si j'avais pu y aller en bateau ! Porte 48, immédiat. Il fait un froid de canard dans ce coucou ! Une revue, papier glacé, dossier sur la Suède, je sors mon pull et ma carte : Afrique de l'Ouest. Je regarde cette épaule de l'Océan et ne vois rien. Lanières multicolores des pays découpés dans la chair, galons d'une uniforme de carnaval. C'est bon, on vole. La clim' me fait claquer des dents. Toute la nuit comme ça ! Le plaid est minuscule, on va finir gelés. Vers l'avant, un écran muet où s'agite une fille et un gars qui s'engueulent, non, ils rigolent, ne savent pas ce qu'ils veulent, je mets le casque, anglais, j'appuie, allemand, le fil se débranche, ils s'embrassent à bouche goulue, ma voisine sors un masque de décontraction, il fait de plus en plus froid. Je cale mon regard entre Togo et Nigeria, fais le Yo-Yo du nord au sud, accroche çà et là des syllabes vides, rejoins le sud, l'eau, Cotonou, bleu atlantique, ocre béninois. L'atmosphère se stabilise entre vibration et relative apesanteur. Je me lève pour dérouiller mes poulies, manque rester pour l'éternité dans le cercueil des toilettes, décide de dormir jusqu'aubout du voyage. L'écran est mort. Ma voisine est livide, légèrement bleutée. Ici et là, des corps affalés. La carlingue fonce dans la nuit. Je sonne l'hôtesse, superbe métisse type antilope. Je finis par somnoler en suçotant un armagnac parcimonieux. Plus que six heures ! Une ribambelle hétéroclite d'impressions, des images par vagues molles cheminent derrière mes paupières. Je recompose à tâtons l'itinéraire qui m'a mené à ce siège étroit, dur, inconfortable. La pêche est maigre. Toujours revient une fascination ancienne, indatable, détachée de tout souvenir d'enfance, cependant étrangère à aucun. Un mélange pâteux m'envahit, où germe, incertaine puis évidente, la nécessité de ne pas mourir sans avoir vu la Côte des Esclaves.
Latérite : Jean-Jacques Marimbert (texte paru dans la revue L'instant du Monde). Dernier livre paru : "Le Corps de l'océan" : Carnet des Sept Collines, éditions Jean-Pierre Huguet
Bona Mangangu, huile sur toile
13:55 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Jean-Jacques Marimbert, Bona Mangangu
 Dense et puissant, tel est ce court récit de Jean-Jacques Marimbert, paru aux Carnets des Sept Collines. Une vaste et profonde méditation. Au début, un personnage découvre un cadavre décomposé, qui flotte sur la mer. Il hésite puis finalement va à sa rencontre pour le ramener au rivage. Et c'est à ses propres interrogations, ses propres doutes, que ce corps mort va le conduire. Il revoit Marie, qu'il vient de rencontrer, Marie le renvoie à Myriam, qui le hante toujours. Ils ont rendez-vous dans une exposition de peinture, entament une conversation sur le baroque : "Eugénio d'Ors dit en gros que le baroque ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai, moi je dirais qu'il ne veut pas ce qu'il sait, voilà, question de volonté. (...) Elle le fixe. Ca me plaît, moi, d'être dangereux après tout, de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre position, c'est militaire, c'est mortifère, non ?" Et Jean-Jacques Marimbert nous emporte, par paliers, dans sa méditation. Voici L'Echelle de Jacob : "Je n'admettais pas cette image. Pour moi l'échelle n'était appuyée sur rien. Ce qu'elle touchait, c'était de l'air et rien d'autre. Jacob est un être multiple, incernable, une sorte de Pessoa, de Ricardo Reis..." Il lui préfère Abraham : "Voilà quelqu'un ! Jusqu'au bout il est lui-même, jusqu'à risquer la prunelle de ses yeux ! Mais au moins c'est droit, c'est total, et son fils l'a échappé belle." Et les dévoilements progressifs du récit nous conduisent, à la découverte, bouleversante pour le personnage deven narrateur, de ce fameux tableau de Rembrandt : "J'étais effrayé. Tout le reste de la visite, je voyais les murs se tordre, des escaliers se profiler, des trappes s'ouvrir où s'engouffraient mes pensées hélicoïdales. Voilà. C'est ça, le baroque : sables mouvants où une échelle est dressée vers l'espace infini et qui "touche" le ciel, s'y appuie, dans une éternelle imprécision. Je sais maintenant ce que j'y ai vu : une image qu'aucun miroir jamais n'a pu me renvoyer, une image exacte de moi-même, de mon être et, je le réalise en le disant, de mon désir d'extase. L'attirance pour tout ce qui, en pleine lumière, s'offre au déguisement." Déguisement qui renvoie à celui de ce corps mort, en putréfaction, à l'origine de ce récit troublant...
Dense et puissant, tel est ce court récit de Jean-Jacques Marimbert, paru aux Carnets des Sept Collines. Une vaste et profonde méditation. Au début, un personnage découvre un cadavre décomposé, qui flotte sur la mer. Il hésite puis finalement va à sa rencontre pour le ramener au rivage. Et c'est à ses propres interrogations, ses propres doutes, que ce corps mort va le conduire. Il revoit Marie, qu'il vient de rencontrer, Marie le renvoie à Myriam, qui le hante toujours. Ils ont rendez-vous dans une exposition de peinture, entament une conversation sur le baroque : "Eugénio d'Ors dit en gros que le baroque ne sait pas ce qu'il veut. C'est vrai, moi je dirais qu'il ne veut pas ce qu'il sait, voilà, question de volonté. (...) Elle le fixe. Ca me plaît, moi, d'être dangereux après tout, de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre position, c'est militaire, c'est mortifère, non ?" Et Jean-Jacques Marimbert nous emporte, par paliers, dans sa méditation. Voici L'Echelle de Jacob : "Je n'admettais pas cette image. Pour moi l'échelle n'était appuyée sur rien. Ce qu'elle touchait, c'était de l'air et rien d'autre. Jacob est un être multiple, incernable, une sorte de Pessoa, de Ricardo Reis..." Il lui préfère Abraham : "Voilà quelqu'un ! Jusqu'au bout il est lui-même, jusqu'à risquer la prunelle de ses yeux ! Mais au moins c'est droit, c'est total, et son fils l'a échappé belle." Et les dévoilements progressifs du récit nous conduisent, à la découverte, bouleversante pour le personnage deven narrateur, de ce fameux tableau de Rembrandt : "J'étais effrayé. Tout le reste de la visite, je voyais les murs se tordre, des escaliers se profiler, des trappes s'ouvrir où s'engouffraient mes pensées hélicoïdales. Voilà. C'est ça, le baroque : sables mouvants où une échelle est dressée vers l'espace infini et qui "touche" le ciel, s'y appuie, dans une éternelle imprécision. Je sais maintenant ce que j'y ai vu : une image qu'aucun miroir jamais n'a pu me renvoyer, une image exacte de moi-même, de mon être et, je le réalise en le disant, de mon désir d'extase. L'attirance pour tout ce qui, en pleine lumière, s'offre au déguisement." Déguisement qui renvoie à celui de ce corps mort, en putréfaction, à l'origine de ce récit troublant...
Rembrandt, Le Philosophe en méditation
12:00 Publié dans Critique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jean-Jacques Marimbert, Le Corps de l'océan, Rembrandt
 Voilà Raphaëlle, tu es à Florence, avec des gens, à un concert où je vais interpréter les plus belles mélodies pour toi. Où es-tu exactement ? Ici ? Ailleurs ? Nulle part. En toi ? Même pas. De toute façon, je vais t’emmener encore plus loin. Sais-tu qu’il y a un lieu tout proche auquel nous n’accédons jamais ? Une sorte de point aveugle de notre existence, vois-tu ? Il nous habite, nous n’y pouvons rien, c’est ainsi, nous lui appartenons, c’est notre bulle, et pourtant, faibles, nous nous tenons au dehors, le plus souvent.
Voilà Raphaëlle, tu es à Florence, avec des gens, à un concert où je vais interpréter les plus belles mélodies pour toi. Où es-tu exactement ? Ici ? Ailleurs ? Nulle part. En toi ? Même pas. De toute façon, je vais t’emmener encore plus loin. Sais-tu qu’il y a un lieu tout proche auquel nous n’accédons jamais ? Une sorte de point aveugle de notre existence, vois-tu ? Il nous habite, nous n’y pouvons rien, c’est ainsi, nous lui appartenons, c’est notre bulle, et pourtant, faibles, nous nous tenons au dehors, le plus souvent.
Jean-Jacques Marimbert, Raphaëlle, éd du Ricochet, 2000
Photo : Jean-Luc Aribaud
08:55 Publié dans Grands textes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, art, photo, Florence, Jean-Luc Aribaud, Jean-Jacques Marimbert, Raphaëlle
 A Florence, on étouffe toujours un peu, c’est écrasant à force, on baigne dans le liquide épais de l’imagination (…) Elle se sent protégée par l’histoire qui émane des palais, des fenêtres à lamelles, du ciel bleu lui-même qui glisse sur l’Arno en un reflet couleur terre.
A Florence, on étouffe toujours un peu, c’est écrasant à force, on baigne dans le liquide épais de l’imagination (…) Elle se sent protégée par l’histoire qui émane des palais, des fenêtres à lamelles, du ciel bleu lui-même qui glisse sur l’Arno en un reflet couleur terre.
Jean-Jacques Marimbert, Raphaëlle, éd du Ricochet, 2000
Photo : Jean-Luc Aribaud
08:06 Publié dans Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, art, photo, Florence, Jean-Luc Aribaud, Jean-Jacques Marimbert, Raphaëlle
 Le soleil est enturbanné de longues mèches oranges, rouges, aux extrémités violettes posées sur l’océan, mi-pansement sale, mi-effilé de châle indien. Ciel d’arrière-saison. Il ralentit le pas. Non, ce n’est pas un tronc. Un ramassis hétéroclite menaçant de se disloquer au moindre remous un peu trop fort, qui s’étale, se resserre, s’étale, respiration de l’entrelacs des courants affolés par l’imminence du littoral. Il a un pressentiment. Il jette ses tennis vers le sable sec, s’avance dans l’eau jusqu’à mi-cuisse, reste ainsi quelques minutes. Ses pieds s’enfoncent dans le sable. Il finit par ne plus sentir ses jambes, ses genoux. Le froid remonte, atteint son sexe, son ventre, mais il ne peut détacher ses yeux de ce qui mollement flotte vers lui. À ce moment, en un dérisoire sursaut de fierté, le soleil enflamme le ciel. Il fait volte-face, court jusqu’au sable, ses jambes remontent mécaniquement la dune. Non, pas de ça, quelqu’un d’autre passera par là, plus tard, il sera loin.
Le soleil est enturbanné de longues mèches oranges, rouges, aux extrémités violettes posées sur l’océan, mi-pansement sale, mi-effilé de châle indien. Ciel d’arrière-saison. Il ralentit le pas. Non, ce n’est pas un tronc. Un ramassis hétéroclite menaçant de se disloquer au moindre remous un peu trop fort, qui s’étale, se resserre, s’étale, respiration de l’entrelacs des courants affolés par l’imminence du littoral. Il a un pressentiment. Il jette ses tennis vers le sable sec, s’avance dans l’eau jusqu’à mi-cuisse, reste ainsi quelques minutes. Ses pieds s’enfoncent dans le sable. Il finit par ne plus sentir ses jambes, ses genoux. Le froid remonte, atteint son sexe, son ventre, mais il ne peut détacher ses yeux de ce qui mollement flotte vers lui. À ce moment, en un dérisoire sursaut de fierté, le soleil enflamme le ciel. Il fait volte-face, court jusqu’au sable, ses jambes remontent mécaniquement la dune. Non, pas de ça, quelqu’un d’autre passera par là, plus tard, il sera loin.
Jean-Jacques Marimbert
Extrait de : "Le corps de l'océan"
17:00 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, Jean-Jacques Marimbert, Le corps de l'océan
03:30 Publié dans littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, Jean-Jacques Marimbert, Le corps de l'océan

De temps en temps, un appel, une plainte, un cri en provenance d’une chambre voisine, suivis du clic-clac nerveux des Scholl de l’infirmière, me tordaient les boyaux. J’ai fini par me laisser tomber sur le bord du lit, exténué de n’avoir qu’à patienter, projeté dans une sorte de vide où mon ego ne gesticulait même plus. Je me suis surpris à sourire en pensant que, au sens littéral, j’étais le nombril du monde, d’un monde mou et sans contour.
Soudain, Manuel Portalès s’est tourné dans ce que je croyais être son sommeil. La lumière tamisée par le volet entrouvert découpait un profil d’oiseau rejeté en arrière sur l’oreiller. Un visage tout en os.
Une fois ingurgitée la prémédication, je me suis mis au lit avec le sentiment de m’allonger pour toujours. La veilleuse de porte a transformé ma nuit en un long tunnel onirique bleuté. Au réveil, la bouche en manque de café, de pain beurré, de miel, je me suis mollement précipité sous la douche histoire de me donner une contenance. C’est tout juste si j’osais déglutir. En réalité, je n’avais rien ni à avaler ni à cracher. J’étais au plus près de mon squelette, accroché au branchage osseux comme chemise au fil, séchant dans le vent du désert. Je ne sais pourquoi l’image des bergers du sahel m’est apparue alors que j’attrapais ma serviette, leur maigre silhouette flottant à contre-jour dans un pagne vaguement noué, dominant le troupeau épars sur une terre ocre et galeuse, leur fière silhouette bravant le soleil et la chaleur, la soif, la lumière. Pour ma part, je n’étais pas fier, pas fier du tout.
Le brancardier m’ayant aidé à me hisser sur son outil de travail, je me souviens d’avoir traversé le service à l’horizontale, passé des sas interdits au commun des mortels et d’être parvenu au bloc si bien nommé. Là j’aurais aimé être escargot, hérisson, huître ou palourde, qui ont l’intelligence de rentrer en eux-mêmes à l’approche du danger, mais je n’ai su faire que l’autruche. Un masque portant lunettes d’écaille et calotté de vert m’a murmuré que tout allait bien se passer, les yeux rivés sur la veine de mon bras qu’il tâtait avec un soupçon d’érotisme. Je n’ai pas eu le temps de lui répondre que l’idée du “tout”, à elle seule, me donnait le vertige. Dans le hall immense et vide de mon crâne résonnait déjà la voix du chirurgien racontant le dernier épisode de Six feet under avec un cheveu sur la langue.
Jean-Jacques Marimbert
Photo : Gildas Pasquet gildaspasquet@gmail.com
00:15 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, inédit, Jean-Jacques Marimbert